Auteur : kerbratasmp
Conférence de ZUO Xuejin, vice-président de l’Académie des Sciences sociales de Shanghaï (lundi 12 juin 2017)
Croissance économique et inégalité en Chine
Traduction HUANG Ping et Edmond LISLE
Merci à l’Académie des Sciences morales et politiques, merci à la Fraternité d’Abraham de m’avoir invité à participer à cette série de conférences intitulée « Ethique et Economie ». Merci à Monsieur Bernard Esambert, l’auteur du texte fondamental de cette série de conférence et à Monsieur l’Académicien Bertrand Collomb de m’avoir adressé la lettre d’invitation officielle. Merci à vous tous d’être venus pour m’écouter, je sais combien votre temps est précieux. J’ai appris que je suis le seul intervenant de Chine dans cette série de conférences, ce dont je me sens très honoré. A travers mon exposé, j’espère pouvoir vous donner une idée sur la pensée chinoise, la politique élaborée et les mesures employées concernant la croissance économique et l’égalité sociale en Chine.
D’abord, je voudrais rappeler les pensées de la Chine ancienne sur ces questions de l’éthique et l’économie, ensuite j’évoquerai la question de la croissance et de l’inégalité dans la société chinoise et les politiques menées depuis plus d’un demi siècle. Je tracerai brièvement l’évolution de la question de l’égalité et de l’efficacité lors de la transformation de l’économie planifiée en une économie de marché. Enfin, après ces analyses, je parlerai du choix des politiques basées sur la pensée qui sous-tend ces politiques. Vos commentaires et vos questions seront les bienvenus, je serai ravi de discuter avec vous.
I- La pensée Confucéenne sur « l’éthique et l’économie »
Le Confucianisme sur l’éthique et l’économie met l’accent sur « la bienveillance du souverain » et insiste sur l’importance des conditions de vie du peuple et sur une répartition équitable des revenus. Mais si on regarde l’histoire de la Chine, on constate que la pratique de certains souverains dans toutes les dynasties était contraire à ces principes. Dans l’histoire de la Chine, les changements de dynastie sont fréquents. Les raisons principales de ces changements sont des impôts trop lourds, la cruauté de la perception des impôts et la forte inégalité sociale : les terres et les biens se concentraient dans les mains de quelques milieux sociaux privilégiés, les paysans et le peuple au dernier échelon de la société vivaient dans une grande pauvreté. Catastrophes naturelles et grandes famines venaient ajouter du gel sur la neige. Les crises intérieures provoquaient émeutes et soulèvements et invitaient les minorités nomades du Nord à nous envahir, provoquant les changements de dynastie.
La pensée et l’enseignement du grand philosophe Confucius (551-479 av. J.-C) insistent sur « la voie du milieu » et « Excès ou insuffisance se valent ». La première doctrine consiste à réagir avec un raisonnement bien fondé sans aller d’un extrême à l’autre, la deuxième enseigne qu’en faire trop est aussi mauvais que ne rien faire. Ces deux principes nous incitent à prendre des mesures justes, à ne pas aller trop loin ni ne pas aller assez loin.
Confucius prête aussi beaucoup d’importance aux conditions de vie du peuple et s’oppose à la tyrannie. Confucius dit : « Nous devrions plus nous soucier de l’inégalité que de l’insuffisance ». Il dit : « La tyrannie est pire que les tigres » signifiant par là qu’une fiscalité accablante est bien pire que les tigres mangeurs d’hommes.
Un autre grand penseur est le philosophe Mencius ou Meng Zi (372-289 av. J.-C), dont la pensée est dans la filiation de celle de Confucius. La pensée principale de Mencius est illustrée par cette phrase: « Le peuple est le plus important ; ensuite l’état ; enfin le souverain ». Cela signifie que par ordre d’importance le peuple vient en premier, puis l’état, le souverain en dernier. Son raisonnement est que l’état ou le souverain peuvent être remplacés, mais pas le peuple. De sorte que c’est le peuple qui est le plus important. Ces propositions expriment la pensée de Mencius que le peuple est le fondement de l’état et du souverain. Bien des monarques n’ont pas apprécié la pensée de Mencius, par exemple, le premier empereur ZHU Yuanzhang, de la dynastie de Ming (1368 -1644). Il n’appréciait pas du tout l’enseignement et la diffusion de la pensée de Mencius.
Bien que l’humanité ait connu plus de 2 500 ans de changements sociaux et de progrès techniques depuis la naissance de la pensée de Confucius, cette pensée illumine encore par la raison et la sagesse l’éthique contemporaine et le raisonnement économique. Souvent, dans la société contemporaine, les gens s’opposent sur la mondialisation et la justice sociale, avec parfois la montée d’opinions extrêmes. Selon la doctrine Confucéenne de la voie du milieu et que « l’excès et l’insuffisance se valent », les opinions et les pratiques des extrêmistes ne conviennent pas. Nous devons plutôt trouver un bon équilibre entre ces extrêmes et éviter tout autant « l’excès que l’insuffisance ». Par exemple, sur les questions entre l’inégalité et l’efficacité, entre le rôle du gouvernement et la loi du marché, entre la protection des travailleurs et la flexibilité du marché du travail, nous devons trouver le point d’équilibre et juste entre ces éléments en évitant de trop pencher vers un élément en négligeant l’autre.
J’examinerai aujourd’hui la question de l’efficacité et de l’inégalité dans la croissance de l’économie chinoise. Le Confucianisme insiste sur la nécessité de rester dans la voie du milieu, c’est à dire de trouver un équilibre entre l’inégalité et l’efficacité. Cela ne veut pas dire qu’il faille privilégier l’égalité en négligeant l’efficacité ou l’inverse. J’évoquerai ensuite le glissement des priorités entre l’équité et l’efficacité lors du passage de l’économie planifiée à l’économie de marché avant d’esquisser l’orientation future de l’économie chinoise.
II- L’Evolution de l’inégalité et de l’efficacité dans la réforme de l’économie chinoise
Il existe quantité de recherches et de publications analysant la relation entre la croissance économique et l’équité. Simon Kuznets par exemple a effectué des recherches basées sur les statistiques collectées et indiquait en 1955 que la courbe de la croissance économique et de l’inégalité sociale avait la forme d’une lettre U renversée. C’est à dire qu’au début de l’industrialisation l’inégalité des revenus augmente avec la croissance économique puis, après avoir atteint un pic, l’inégalité retombe avec la poursuite du développement de l’économie. Dans les études économétriques l’indicateur du développement économique est généralement représenté par la croissance du revenu par tête, comme dans la figure ci-après.
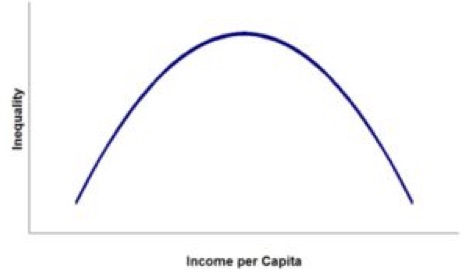
L’Evolution de relations entre la croissance du revenu par tête et l’inégalité
Dans son Best-Seller « Le Capital au 20è siècle », l’économiste français Thomas Piketty analyse les donnée empiriques sur l’évolution de l’inégalité du revenu et de la fortune en Europe et aux Etats Unis depuis le 18è siècle. Il en conclut que le retour sur le capital investi est plus élevé que le taux de la croissance économique à long terme ce qui se traduit par une plus grande concentration de la fortune. Cette répartition inégale de la fortune provoque à son tour une instabilité socio-économique. Il préconise donc un impôt progressif sur la fortune afin de prévenir l’appropriation de la richesse par une infime minorité.
La réforme économique en Chine est une évolution et une procédure d’ajustement constant entre l’inégalité et l’efficacité. Lorsque l’économie chinoise était une économie planifiée, l’égalité des revenus était largement respectée, mais la productivité était très basse et le revenu moyen était très faible. Lorsque la Chine a lancé la réforme économique en direction de l’économie de marché en 1978, le développement économique a fait un grand bond en avant, la productivité et le revenu par tête ont augmenté, cependant que l’égalité de la répartition des revenus s’est mise à décroître au point de devenir excessive (au sens de Confucius). La réforme en Chine qui va venir doit viser à trouver un nouvel équilibre entre l’équité et l’efficacité. Mais cela ne veut pas dire qu’il faille simplement faire demi tour et revenir à l’économie planifiée. L’orientation sage serait, dans le cadre de l’économie socialiste de marché, de rehausser l’équité, tout en minimisant la perte d’efficacité voire même en rehaussant celle-ci.

L’Evolution de l’inégalité pendant le passage d’une économie planifiée à une économie de marché
Evoquons maintenant les questions de l’équité et de l’efficacité pendant deux différentes époques en Chine : celle de l’économie planifiée et celle de l’économie de marché.
Pendant l’époque de l’économie planifiée, l’égalité sociale en Chine était relativement élevée. L’estimation de la Banque mondiale montre qu’en 1978 en Chine, soit au début de la réforme, le coefficient de Gini en ville était de 0,16, il était de 0,31 à la campagne. Compte tenu de la grande différence de niveau de vie entre les villes et la campagne, le coefficient de Gini pour l’ensemble du pays était de 0,33.
Selon les normes internationales, la Chine à l’époque était une société très égalitaire mais de très faible productivité économique, dans l’industrie et l’agriculture. Cette situation s’explique, au niveau micro-économique, par l’absence de tout lien entre le revenu des travailleurs et leurs efforts, auquel s’ajoutait la structure déséquilibrée et parfois contre-productive du système, au niveau macro-économique. La pratique égalitariste se résume ainsi : « Les bonnes et les mauvaises performances au travail engendrent le même revenu » ou encore : « tout le monde se nourrit au même bol de riz ». Pareilles pratiques se traduisaient par l’absence d’incitation à travailler et, évidemment, une productivité et un revenu moyen faibles. En 1978 le PNB chinois par tête était d’environ CNY385 soit moins de $260 par an même au taux de change officiel. Dans les régions rurales environ 260 millions d’habitants vivaient en situation de pauvreté absolue, soit environ un tiers de la population rurale totale.
Au niveau macro-économique la politique de l’Etat, pendant l’époque de l’économie planifiée, était de donner la priorité au développement de l’industrie, principalement l’industrie lourde et la chimie.
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement pratiquait la politique dite « des ciseaux» : sous-payer les prix des produits agricoles et surpayer les prix des produits industriels. Des bénéfices gigantesques ont ainsi été transférés de la campagne vers les villes. Il en est résulté une grande différence des revenus et du niveau de vie entre la campagne et les villes. Pour éviter le flux de la population rurale vers les villes, l’immigration rurale en ville était interdite sauf cas particuliers.
Après la réforme et l’ouverture, l’une des dispositions clefs pour promouvoir la réforme et la transition de l’économie planifiée à l’économie de marché a été de permettre à certaines régions et catégories de population à être les premières à s’enrichir, entrainant à leur suite la prospérité de tous. Le point de départ de la réforme rurale a été de permettre aux ménages ruraux de louer des terres aux autorités territoriales, d’être plus libres de décider combien et comment produire et de vendre au gouvernement à des prix d’achat plus élevés. La grande réussite de la réforme rurale a été une forte augmentation du produit de l’agriculture et une augmentation plus rapide du revenu des ménages agricoles comparés aux ménages urbains. La conséquence de la réforme agricole a donc été de rehausser aussi bien l’efficacité de l’économie que l’égalité de la répartition des revenus
Après 1984, le centre de gravité de la réforme économique s’est déplacée de la campagne vers les villes. L’inégalité des revenus en villes augmentait progressivement avec l’évolution vers l’économie de marché. Dans le même temps le fait que le pays restait administré en deux secteurs distincts (villes et campagnes) maintenait une forte inégalité entre la campagne et les villes.
Pendant une vingtaine d’années, entre 1980 et les années 2010, l’inégalité n’a cessé de s’aggraver. Au début du 3è millénaire, le coefficient de Gini s’établissait à près de 0,5, ce qui faisait de la Chine l’un des pays les plus inégaux dans le monde. Au cours de la dernière décennie, grâce à certaines politiques, notamment la suppression des taxes agricoles, l’augmentation du financement de l’éducation obligatoire à la campagne la rendant vraiment gratuite, ainsi que le financement par le gouvernement central et les gouvernements locaux de l’assurance santé et de l’assurance vieillesse à la campagne, tout cela a contribué à stabiliser, voire même à légèrement réduire, le coefficient de Gini à l’échelle nationale.

Coefficient Gini en Chine, 2003 – 2012. Source : National Statistical Bureau of China
III- Les causes de la forte inégalité des revenus depuis mi-1980
La cause principale provient du maintien de deux systèmes parallèles de gouvernance. Presque la moitié de l’inégalité en Chine résulte de la différence entre la campagne et les régions urbaines. Les revenus dans les régions urbaines sont près de 3 fois plus élevés que ceux dans les régions rurales, soit l’écart le plus fort du monde.
Tableau 1. Revenu par tête: urbain et rural 1978-2015
| Year | Urban Income | Rural Income | U/R Ratio |
| 1978 | 343 | 134 | 2.57 |
| 1980 | 478 | 191 | 2.50 |
| 1985 | 739 | 398 | 1.86 |
| 1986 | 900 | 424 | 2.12 |
| 1987 | 1002 | 463 | 2.17 |
| 1988 | 1181 | 545 | 2.17 |
| 1989 | 1374 | 602 | 2.28 |
| 1990 | 1510 | 686 | 2.20 |
| 1991 | 1701 | 709 | 2.40 |
| 1992 | 2027 | 784 | 2.58 |
| 1993 | 2577 | 922 | 2.80 |
| 1994 | 3496 | 1221 | 2.86 |
| 1995 | 4283 | 1578 | 2.71 |
| 1996 | 4839 | 1926 | 2.51 |
| 1997 | 5160 | 2090 | 2.47 |
| 1998 | 5425 | 2162 | 2.51 |
| 1999 | 5854 | 2210 | 2.65 |
| 2000 | 6280 | 2253 | 2.79 |
| 2001 | 6860 | 2366 | 2.90 |
| 2002 | 7703 | 2476 | 3.11 |
| 2003 | 8472 | 2622 | 3.23 |
| 2004 | 9422 | 2936 | 3.21 |
| 2005 | 10493 | 3255 | 3.22 |
| 2006 | 11759 | 3587 | 3.28 |
| 2007 | 13786 | 4140 | 3.33 |
| 2008 | 15781 | 4761 | 3.31 |
| 2009 | 17175 | 5153 | 3.33 |
| 2010 | 19109 | 5919 | 3.23 |
| 2011 | 21810 | 6977 | 3.13 |
| 2012 | 24565 | 7917 | 3.10 |
| 2013 | 26467 | 9430 | 2.81 |
| 2014 | 28844 | 10489 | 2.75 |
| 2015 | 31195 | 11422 | 2.73 |
| 2016 | 33616 | 12363 | 2.72 |
Source : Annuaire du National Statistics Bureau of China
Nous pouvons ainsi analyser l’évolution de l’inégalité sociale en Chine en fonction des causes suivantes.
Premièrement, comme nous l’avons précédemment indiqué, l’économie planifiée et la stratégie visant à développer rapidement l’industrialisation a entrainé un fort écart entre les revenus urbains et ruraux et la segmentation du marché du travail entre les zones rurales et urbaines. Depuis la réforme économique le gouvernement a progressivement levé les restrictions aux migrations entre les zones rurales et urbaines. Les travailleurs ruraux ont pu ainsi partir à la recherche d’emplois dans les zones urbaines et notamment dans les villes côtières.
Ces trente dernières années, la contribution des travailleurs paysans au développement économique de la Chine est énorme. Dans le rapport intitulé « Rapport de l’économie et du développement social et statistiques 2016 », publié par le National Statistics Bureau of China, on dénombrait en 2016 281,71 millions de travailleurs paysans, dont 169,34 millions avaient émigré pour travailler ailleurs que dans leur pays natal. Mais si les travailleurs paysans peuvent enfin se déplacer pour chercher du travail ailleurs, les obstacles administratifs sont encore nombreux avant qu’ils ne soient reconnus comme travailleurs urbains à part entière.
L’obstacle principal provient du système d’enregistrement des ménages et du cadre administratif correspondant, le Hukou. Le Hukou est un système d’enregistrement et de contrôle de la population instauré progressivement dans les années 1950 pour servir le projet de développement. Interdisant à l’origine toute mobilité sociale et spatiale – séparant strictement ruraux et urbains.
A l’époque de l’économie planifiée, le système d’enregistrement familial (Hukou) restreignait fortement, voire même interdisait, toute mobilité géographique ou sociale, de la population rurale. Le système d’enregistrement familial divisait les citoyens en deux catégories selon leur lieu d’enregistrement. Après l’introduction de la réforme économique, les paysans ont pu émigrer vers les villes pour y trouver un emploi, mais ils ne peuvent en général pas y obtenir leur enregistrement en qualité de résident urbain. Ils peuvent seulement obtenir un permis de résidence temporaire, tout en conservant leur enregistrement familial dans leur village d’origine. Du point de vue de l’administration ils ne sont donc pas considérés comme citoyens urbains. Les travailleurs migrants /paysans et leur famille ne peuvent pas bénéficier des services fournis par l’Etat, notamment l’instruction obligatoire de leurs enfants, la sécurité sociale et la protection de l’emploi. Après de longues années de travail en ville, ces travailleurs paysans sont toujours considérés comme « paysans » et restent une communauté marginalisée en ville.
Actuellement, la « population urbaine » est officiellement définie comme comprenant tous ceux ayant vécu six mois ou plus en ville au moment du recensement ou de l’enquête. Bien qu’un nombre important de travailleurs paysans et leurs familles résidant en ville soient comptabilisés comme population urbaine, ils n’ont pas le statut de citadin et donc n’ont pas les mêmes droits que ceux qui ont le statut de citadin. Les compter avec la population urbaine enregistrée comme telle revient donc à surestimer l’urbanisation en Chine. Certains spécialistes appellent cela « semi-urbanisation » ou « urbanisation creuse ».
Fin 2015, la Chine comptait 1 374 milliards d’habitants. Si l’on compte la population comprenant les travailleurs paysans résidant dans les régions urbaines, l’urbanisation s’élève à 56,1% ; si l’on compte selon le lieu d’enregistrement administratif, ce chiffre tombe à 39,9%, soit une différence de 16,2%, l’équivalent d’une population de 22,7 millions. Le gouvernement a pris la décision de transformer, au cours du 13è quinquennat (2016-2020), le statut des travailleurs migrants en statut de citadin. Cela concerne une population de 100 millions d’habitants qui obtiendraient les mêmes droits que les citoyens urbains. Le gouvernement a en outre projeté d’aider 70 millions de personnes de quitter la pauvreté en cinq ans.
Deuxièmement, l’éducation élémentaire et obligatoire et la santé ont été trop « commercialisées » depuis la réforme. En Chine, certains ont pensé que le mécanisme du marché était parfait et pouvait résoudre tous les problèmes. En prenant les bons côtés de l’économie de marché dans l’organisation des ressources, on a négligé le revers de la médaille : lorsque le marché échoue, quelles sont les conséquences ? Par exemple, beaucoup de gens pensaient que l’éducation et la santé pouvaient être gérées comme on gère l’offre de n’importe quels autres biens et services, et que le financement de l’éducation et de la santé pouvaient être assuré par le marché. Donc, le gouvernement devait moins s’impliquer dans ces domaines.
Le cas des « Coopératives Médicales Rurales » et des « médecins aux pieds nus » est un bon exemple. Les médecins aux pieds nus sont des agriculteurs enregistrés administrativement (Hukou) à la campagne qui n’ont pas reçu une formation médicale formelle mais sont autorisés à pratiquer les soins dans les villages. Les médecins aux pieds nus ont beaucoup contribué à l’accès aux soins médicaux de base à la campagne. Financés et rémunérés par l’économie collective, les médecins aux pieds nus fournissent des soins gratuits. Avec souvent un diplôme du collège ou du lycée, les médecins aux pieds nus sont apparus pendant la révolution culturelle.
A l’époque de l’économie planifiée, les médecins aux pieds nus soignaient les malades à la campagne à un coût très bas. C’est un système exemplaire pour les pays en voie de développement. Mais au début des années 1980, l’économie collective s’effondrait. 90% des « Coopératives Médicales Rurales » ont été dissoutes. Désormais, les paysans devaient payer eux-mêmes la totalité des frais de soins médicaux. En parallèle, les unités de soins et de pharmacie à tous les échelons devaient se financer par leurs services de soins et par la vente des médicaments. La conséquence pour les habitants ruraux est sérieuse : la difficulté de l’accès aux soins et le coût excessif des soins, ces deux raisons conduisent les familles des malades à la ruine et à la pauvreté. Lorsqu’en 2010 un nouveau système de « Coopératives Médicales » a été étendu à l’ensemble du pays, la situation s’est améliorée.
Un autre exemple concerne l’éducation. Le financement de l’instruction obligatoire provient essentiellement des gouvernements locaux. Etant donné que certains gouvernements locaux n’ont pas assez de moyens pour financer les écoles primaires, une partie de ce financement provient des frais de scolarité et frais annexes payés par les familles. Cette mesure pousse les enfants ruraux des familles pauvres à quitter l’école, car la famille ne peut pas payer. Cela résulte du faible financement public alloué à l’éducation obligatoire à la campagne, soit moins de 4% du PIB. Comparée à d’autres pays, la Chine se trouve à un niveau insuffisant d’investissement dans l’éducation. En 2007, le gouvernement a supprimé les frais de scolarité et les frais annexes des écoles primaires pour la période de l’instruction obligatoire à la campagne. En 2007, le gouvernement a aussi établi une nouvelle politique d’aide financière aux élèves allant à l’université et dans les écoles professionnelles. En 2012, le financement de l ‘Etat dans l’éducation a atteint pour la première fois 4% du PIB.
Troisièmement, l’égalité des chances n’a pas toujours été respectée depuis la réforme économique. L’administration foncière est un bon exemple. L’administration foncière permet aux gouvernements locaux de racheter les terres collectives des paysans à un prix bas et de les revendre à un prix beaucoup plus élevé aux promoteurs immobiliers. Ainsi l’urbanisation et l’industrialisation se font au détriment des paysans qui sont privés des bénéfices résultant de la vente de leurs terres. Un autre exemple est le système bancaire. Des emprunts auprès des banques sont difficiles à obtenir pour des entreprises de petite et moyen taille et pour des individus de faible revenu. L’épargne des paysans est transférée à la Caisse d’épargne postale pour financer le développement urbain en ville, mais leur maison et leur terre à la campagne ne peuvent pas servir de caution lorsqu’ils ont besoin d’un emprunt bancaire. Ici, on constate que lorsque le gouvernement intervient directement dans l’économie locale (micro-économie), il marginalise encore un peu plus les entrepreneurs des régions rurales. Et lorsque des fonctionnaires corrompus abusent de leurs pouvoirs pour aider leurs propres familles et leurs proches, cela se traduit par une concurrence déloyale sur le marché.
En Chine, les entreprises d’état, notamment les banques commerciales et les entreprises de télécommunications, sont privilégiées : elles ont un pouvoir de monopole et ont le droit de fixer les tarifs, car l’état limite l’accès de ces marchés. Ces entreprises réalisent des bénéfices gigantesques. Mais elles ne sont pas compétitives sur le marché international.
Quatrièmement, il subsiste des imperfections et même des défauts aussi bien du côté des recettes que des dépenses du système fiscal. Les services publics sont financés principalement au niveau local. Mais les dépenses des différentes régions sont très inégales. Le gouvernement central recueille près de la moitié des recettes fiscales mais, parce que les dépenses publiques sont très dispersées, le gouvernement central ne supporte directement que moins de 15% de toutes les dépenses publiques. Les transferts fiscaux du gouvernement central vers les collectivités locales se font principalement sous la forme de ressources affectées, faiblement associées à une redistribution régionale des revenus.
La fiscalité en Chine consiste essentiellement en TVA ou taxes sur le chiffre d’affaires et impôts sur les bénéfices. Bien que la loi ait fixé un niveau élevé d’impôt sur le revenu des personnes physiques, la procédure de collecte n’est pas performante. Aujourd’hui le taux d’imposition des revenus individuels ne représente que 5-6% des recettes fiscales du gouvernement central et des gouvernements locaux. Comme on pouvait s’y attendre, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’a joué qu’un rôle minime s’agissant de la redistribution des revenus.
IV- Réflexions et objectifs visés par les politiques
Premier point : réflexion générale
La pensée des grands classiques chinois représentée par le Confucianisme insiste sur la nécessité de rester dans la voie du milieu et de ne pas aller aux extrêmes. Depuis la réforme économique, la Chine s’est transformée d’une société relativement égalitaire dans la distribution de la richesse, avec une productivité et une efficacité faibles, en une société d’économie de marché, avec une croissance rapide en termes de productivité et des revenus. Mais cette transformation a provoqué une grande inégalité, à tel point qu’aujourd’hui nous nous trouvons dans « une société où trop c’est trop ». Des réformes approfondies doivent permettre de corriger cette inégalité en trouvant un équilibre entre une redistribution juste et équitable et l’efficacité économique. Dans certains domaines, il s’agit aussi d’améliorer l’efficacité.
Un des problèmes de l’économie chinoise d’aujourd’hui est la surproduction. D’un côté, une capacité de production excédentaire reste inemployée face à une demande atone. D’un autre côté, des besoins de base considérables restent insatisfaits tels que l’accès à l’éducation primaire et à un service de santé minimal. Il y a encore des personnes âgées pauvres et des familles pauvres qui n’ont pas les moyens de vivre au niveau le plus élémentaire. D’un point de vue macro-économique, nous devons trouver des solutions pour poursuivre la croissance tout en maîtrisant la surproduction et en répondant aux besoins de base de la vie de tout le monde.
Deuxième point : Il convient de rendre plus équitable la fourniture des services publics et de la sécurité sociale ; de renforcer le rôle du gouvernement en prestataire de dernier ressort s’agissant des besoins de base ; d’accroître l’investissement en ressources humaines, notamment dans la scolarité obligatoire.
Comparée à d’autres pays, les dépenses publiques de la Chine restent faibles en matière d’éducation. Par exemple une attention particulière devrait être apportée aux 30 millions d’enfants en mobilité avec leur parents travailleurs migrants et aux 60 millions d’enfants qui restent au village et dont les parents sont partis pour travailler ailleurs. L’instruction obligatoire de ces enfants n’est pas suffisamment financée et suivie.
Le gouvernement central devrait jouer un rôle plus important dans la collecte des financements pour l’éducation primaire permettant de réduire l’écart entre les régions urbaines et les régions rurales. Le système de financement de l’instruction obligatoire par les gouvernements locaux doit se transformer en un système de financement conjoint par le gouvernement central et les gouvernements locaux. D’une part, cela équilibrerait mieux la répartition des dépenses publiques en matière d’éducation rendant ainsi l’ensemble de la société chinoise plus équitable, d’autre part, cela augmenterait le potentiel de croissance à long terme de toute l’économie.
Une autre proposition consiste à équiper les écoles en technologie numérique pour aider des enfants dans les régions reculées qui n’ont pas la possibilité d’aller à l’école. A la campagne, le nombre d’enfants chute, par conséquent, les écoles dans les régions rurales disparaissent, en particulier dans les régions reculées. Des enfants doivent donc faire de longs trajets à pied ou s’inscrire en internat pour aller en classe. Ces changements et les coûts correspondants ont augmenté le taux d’abandon de l’école.
Les Massive Open Online Courses (MOOC) pourraient être une solution pour résoudre ces problèmes. Des enfants pourraient suivre les cours à distance, les enseignants locaux assurant l’aide aux devoirs. Cette solution pourrait aider à scolariser ces enfants et le retour à l’école pour ceux qui l’ont abandonnée.
Le système de sécurité sociale sous-tend l’économie socialiste de marché et doit être amélioré du point de vue de son équité, de son efficacité et de sa durabilité.
A la base, une assurance retraite et une assurance santé de base doivent être assurées pour tous les citoyens. C’est ce système de sécurité sociale élémentaire qui doit assurer à toutes les personnes à faible revenu, et particulièrement aux ruraux et aux travailleurs migrants dans les régions du Centre et de l’Ouest, un filet de sécurité de base leur permettant d’éviter la pauvreté et l’abandon.
Les gouvernements (surtout le gouvernement central) doivent assumer une plus grande responsabilité concernant le financement et la gestion de ce niveau de sécurité sociale. Il faut simultanément améliorer l’efficacité du système de sécurité sociale. D’autres programmes d’assurance personnelle facultative devraient être proposés, afin que le marché joue un rôle plus important dans la répartition des ressources.
Troisième point : Développer et protéger un marché concurrentiel. Accélérer la réforme du marché des facteurs de production, renforcer la mobilité physique et géographique, approfondir la réforme du système bancaire, développer le financement au service de tous afin que les banques puissent mieux servir les PME et les familles rurales. Réformer la fiscalité afin d’alléger les taxes des entreprises, améliorer le système de collecte des impôts et simultanément accroitre la part de l’impôt sur le revenu dans l’ensemble des impôts perçus.
Améliorer le fonctionnement du gouvernement et l’influence du marché dans la répartition des ressources. Le gouvernement doit assurer davantage de services publics, la protection sociale minimale, corriger les erreurs et surveiller le fonctionnement du marché. En même temps, le gouvernement doit réduire ses interventions au niveau micro-économique, diminuer la concurrence déloyale résultant de monopoles administratifs, renforcer le système juridique, prévenir et réduire la corruption.
Ces questions impliquent un ré-équilibrage des intérêts dans une société plurielle. Pareilles réformes tendent à être politiquement très difficiles. D’après la Constitution, l’Assemblée Nationale du Peuple et la Conférence Consultative Politique du Peuple sont l’instance permettant la libre expression, les débats et les compromis entre les diverses opinions qui contribuent finalement à l’élaboration d’un consensus de base, afin que les réformes visant à rehausser l’équité et l’efficacité puissent être mises en œuvre sans heurt.
Seul un niveau d’équité sociale élevé peut promouvoir le développement harmonieux et soutenable de la Chine dans le long terme et promouvoir aussi l’harmonie de la société humaine et de la paix dans le monde
Je vous remercie.
Cette conférence a été organisée avec le soutien du Groupe Vinci

Conférence de Masami Kita, directeur des études culturelles comparées (Université Soka, Tokyo)
L’éthique japonaise et le bouddhisme du Mahayana
Une approche qualitative
traduit de l’anglais par Yasuharu Kakegawa.
1- L’éthique japonaise du travail et la croissance socio-économique
Cette étude analyse l’impact exercé par la pensée éthique et religieuse japonaise, et en particulier du bouddhisme du Mahayana et par suite du mouvement international de la Soka Gakkai sur les civilisations du monde et sur la paix mondiale. L’éthique japonaise du travail exige le dévouement dans son travail et attend par conséquent des employés qu’ils passent de longues heures de travail au bureau pour assurer le succès financier de leur entreprise. Cela fait partie des convictions et croyances japonaises. C’est pourquoi les Japonais sont très disciplinés et respectent leurs devoirs et obligations. Traduit en termes de recherche scientifique et académique, le Japon investit des sommes importantes dans son économie, particulièrement dans le domaine de l’apprentissage créatif des technologies innovantes. Cette croyance en l’apprentissage et la recherche innovante a donné au Japon un avantage considérable dans l’élaboration d’une technologie de pointe et dans la formation de jeunes esprits impliqués dans de nouvelles recherches, si étrange que cela puisse paraître. Ces dernières années, le Japon est devenu un leader dans l’industrie automobile avec des marques comme Toyota, Nissan, Suzuki, Honda, Infiniti et Mitsubishi. Le Japon est aussi leader dans la technologie photographique avec des compagnies comme Panasonic, Nikon, Fuji, Cannon, et Kyosera qui fabriquent des produits de qualité mondiale.
De plus, les Japonais ont créé un réseau solide de partenaires et de relations commerciales stables avec des pays étrangers pour développer ses entreprises de produits de haute technologie et de denrées industrielles. Puisque le Japon est un pays de fabrication dont la production se compose à 97% de produits industriels, il est étroitement dépendant d’autres pays pour ses matières premières. Le yen japonais exerce aussi une influence financière sur le monde en tant que quatrième monnaie du monde la plus importante, après le dollar US, le Yuan chinois, et l’Euro d’Europe. Le yen japonais reflète la stabilité de l’économie japonaise dans le marché financier mondial. La plupart des employés japonais bénéficient d’un haut niveau de sécurité personnelle qui favorise la croissance économique du Japon. Encore de nos jours, beaucoup d’entreprises promettent encore la sécurité d’emplois à vie bien que de telles garanties soient moins fréquentes qu’auparavant. Lorsque l’on garantit aux employés des emplois à vie, cela accroit leur sens de responsabilité dans l’entreprise et leur ambition de s’élever dans l’échelle sociale. Pour répondre à une conjoncture difficile, le Japon a créé une excellente infrastructure qui attire de nombreux nouveaux investisseurs. La technologie japonaise des transports à grande vitesse a créé le Shinkansen qui relie entre elles les villes les plus importantes. Et bien que le Japon soit confronté au problème d’une société vieillissante et d’un déclin de la natalité, il n’en reste pas moins paisible et continue à attirer les investisseurs et les touristes. Tous ces éléments sont des facteurs de progrès social, économique et éthique.
2- Le bouddhisme du Mahayana et le Japon
Une analyse historique de la propagation du bouddhisme indien nous donne quatre courants – nommément l’école bouddhique (noir), le bouddhisme du Mahayana (rouge), le bouddhisme Theravada (vert), et Vajrayana-Tantrique. Le bouddhisme du Theravada s’est répandu au Sri Lanka, en Birmanie (Myanmar), la Thailande et l’ Indonésie, alors que le Mahayana se répandait en passant par l’Hindu Kush en Asie centrale, puis jusqu’en Chine, la péninsule coréenne et le Japon. Le bouddhisme du Hinayana préconisait l’extinction des désirs – parce que les souffrances sont causées par les désirs et l’égoïsme dans la vie humaine – et l’atteinte d’un état de néant appelé nirvana. Le bouddhisme du Mahayana avançait également l’idée que les désirs terrestres étaient la cause des souffrances. Les deux courants encourageaient à s’écarter des désirs. Quand le bouddhisme parvint au Japon au 6e siècle les principaux clans au Japon débattirent sur la façon d’accepter cette nouvelle religion. Puisque la croyance japonaise du Shinto permettait la coexistence de nombreuses divinités, un culte fut également rendu aux divinités bouddhiques. Le bouddhisme du Mahayana relativisa la notion de bon et de mauvais et créa le concept de Daizen ou plus grand bien pour créer des valeurs et susciter une société en paix. Le caractère sacré de la vie est admis dans les trois phases de l’existence (passé, présent et futur) sans pouvoir échapper aux quatre cycles inévitables – nommément Shyo (naissance) Rou (vieillissement) Biyou (maladie) et Shi (la mort). Cette conception de l’univers devint la base du sens commun et de l’éthique du Japon, quelque peu différente de celle du Christianisme, de l’Islam et du Confucianisme qui font du bien et du mal des notions irréconciliables. Qui plus est, la réalisation, et non pas l’extinction des désirs, est au cœur de la croyance du Mahayana afin de contrôler et de canaliser les désirs humains.
Le prince Shotoku (574-622) crut dans le pouvoir d’harmonisation du bouddhisme du Mahayana et accepta officiellement pour le Japon le bouddhisme du Mahayana et les enseignements du Sûtra du Lotus, qui donnait un statut égal aux femmes. Lorsque la classe des samouraïs prit le pouvoir à l’époque de Kamakura (1183-1333), les écoles Jodo et Zen devinrent prééminentes. Pour rendre au bouddhisme sa pureté originelle, Nichiren se servit des doctrines de Tiantai et Dengyo pour rendre le bouddhisme simple et accessible aux gens du peuple. Le bouddhisme de Nichiren fut une doctrine bénéfique et égalitaire pour la classe moyenne japonaise.
3- L’évolutionnisme japonais et la fabrication de fusils au 16e siècle
Il y a eu deux grandes phases dans la rencontre japonaise de la culture et de la technologie étrangère. La première au cours de la période des grandes navigations à la fin du 16e siècle, les Européens, principalement les Britanniques et les Hollandais de la Compagnie des Indes Orientales, se rendirent en Asie centrale, en Malaisie, Indonésie et Philippines et en revinrent avec de fins textiles, des parfums, des pierres précieuses, du poivre, des épices et des condiments. Les Japonais firent voile également vers l’Asie du Sud et se procurèrent les mêmes denrées, y compris des graines qu’ils plantèrent dans le sud de Kyushu et dans les îles d’Okinawa.
Au 17e siècle, le gouvernement des Tokugawa ferma le pays aux échanges avec l’étranger pour 250 ans, à l’exception d’un commerce limité avec la Hollande et la Chine. Pendant cette époque, les Japonais maîtrisèrent la fabrication des fusils. Noel Perrin écrit qu’en 1543, alors qu’un bateau portugais dérivait vers Tanegashima, les marins offrirent deux fusils au seigneur de l’île, qui ordonna immédiatement à ses hommes qui n’avaient pour armes que des épées, de copier ses fusils pour s’en servir dans les batailles. Ce qui fut fait avec succès. Par la suite la technologie de fabrication de fusils fut utilisée par samouraï Nobunaga Oda qui vendit des fusils de grande qualité aux marchands de Sakai. En dirigeant 3000 soldats armés de fusils dans la guerre de Nagashino, Oda vainquit le clan Takeda beaucoup plus nombreux en 1575, bouleversant complètement la stratégie militaire. Au début du 17e siècle aussi bien l’Europe que le Japon s’engagèrent dans des guerres sanglantes, respectivement les Guerre de Trente Ans et la guerre d’Amakusa au cours desquelles les armes à feu firent de nombreuses victimes. Mais 250 ans plus tard, la culture des fusils avait presque disparu, alors que le Japon passait peu à peu du féodalisme au capitalisme puis ensuite à une société de management.
4- L’éthique de la société féodale japonaise
Le bouddhisme du Mahayana aida la culture japonaise fondée sur la culture du riz à maintenir la division du travail, l’harmonie sociale et la bureaucratie féodale. Bien que les systèmes politiques et sociaux soient élitistes et fondés sur la famille, comme en Chine, ils opéraient au Japon d’une façon plus égalitaire. Le système Kakyo ou de ‘sélection par examens ‘ était aussi moins élitiste au Japon. La conception de Weber que la révolution industrielle en Europe était une conséquence du protestantisme et de son influence sur l’éthique du travail doit être rapprochée du fait que lorsque le Japon confucéen s’est rapidement industrialisé un peu plus tard, sa propre éthique du travail joua un rôle important. Bien que la division sociale confucéenne de Shi-No-Ko-Sho (guerriers, agriculteurs, ouvriers et marchands) ait joué un rôle important, l’ardeur au travail et les alliances matrimoniales jouèrent aussi un rôle significatif dans l’accession au succès. Qui plus est, l’administration des Tokugawa était très rigoureusement organisée, de la base vers le sommet, à la grande surprise des explorateurs et des missionnaires occidentaux. De plus l’éducation pour les guerriers, les marchands et les fermiers insistait sur l’apprentissage des connaissances et de la philosophie chinoise et sur l’utilisation des caractères chinois, les Kanji.
Dans le monde occidental, une relation féodale entre deux classes maintenait un ordre rigoureux. Mais au Japon, si un sujet (ou un employé) estimait que quelque chose n’allait pas, un concept égalitaire nommé Gekoku-Jyo permettait à ce subordonné de contester son supérieur si lui (ou elle) percevait un manquement dans le comportement social de ce dernier.
La société féodale japonaise comprenait quatre classes – Samurai (guerriers), Noumin (fermiers), Shokuin (ouvriers) et Chomin (marchands) – qui goûtaient des passe-temps intellectuels et spirituels comme les poèmes Haiku, Waka et le théâtre Nô. La prospérité matérielle de la classe des marchands leur permit aussi de manifester de l’intérêt pour les gravures Ukiyoe, Netuke et le théâtre Kabuki qui lorsqu’ils furent exportés en Europe au 19e siècle donnèrent naissance à la mode du Japonisme.
L’administration féodale japonaise était relativement plus avancée si on la compare au féodalisme occidental. Par exemple le Shogun nommait deux Bugyo (administrateurs) pour être responsables du commerce à Nagasaki, un à Nagasaki et l’autre à Edo, pour surveiller son collègue. Ils changeaient de position tous les ans. Le même système valait pour le Bugyo d’Edo (l’administrateur à Tokyo). Lord Elgin observa que tous les officiels japonais qu’il rencontrait posaient de nombreuses questions, dont les réponses étaient notées, et remarqua une sorte d’espion derrière eux pour surveiller à la fois les invités et les fonctionnaires. Cette sorte de contrôle élaboré et de prise en charge était organisée sur des classes entières et dans toutes les régions du Japon. En ce sens, les activités de lutte contre le feu à Edo, qui étaient confiées à la jeunesse des marchands, étaient magnifiquement divisées pour protéger le district des incendies, des inondations et de tout désastre. L’une des caractéristiques de la structure sociale japonaise était la façon dont les classes supérieures étaient soutenues par les classes inférieures, ce que l’on appelait un système de prise de décisions opérant de la base au sommet, alors que la structure occidentale était du sommet vers la base.
Le témoignage d’Occidentaux concernant le Japon féodal vint de W. Adams (1651-1716) et de deux médecins allemands – E. Kaempfer (1651-1716) qui travaillait pour la Compagnie hollandaise des Indes orientales et P.F.B. von Siebold (1796-1866) qui travaillait pour la Compagnie de Hollande. Ils furent impressionnés par le haut niveau de la culture et du comportement des Japonais. Ils firent également remarquer que l’aristocratie japonaise et les samouraïs préféraient les recherches académiques à la richesse matérielle. En 1857, le 8e Lord Elgin (Earl James Bruce) signa un traité avec le gouvernement des Tokugawa qui ouvrit cinq ports de commerce aux échanges avec les nations occidentales.
5- La nouvelle éthique de Meiji et le développement du Japon
Les nations asiatiques ont été confrontées à la peur d’une invasion occidentale au milieu du 19e siècle. En Inde, après le soulèvement des Sepoy en 1857 la Grande-Bretagne imposa le gouvernement direct par la Couronne, tandis que la Chine, après l’incident de l’Arrow (au cours de la 2e guerre de l’opium) en 1857 commença à être soumise aux nations occidentales.
Bien que le gouvernement féodal du Japon ait refusé le contact avec les nations occidentales pendant 250 ans, une réponse au pouvoir militaire des pouvoirs occidentaux était maintenant clairement nécessaire. Elle prit la forme de la Restauration Meiji en 1866. Le Tenno Meiji (empereur) du Japon, qui jusqu’alors avait vécu à Kyoto et s’appuyait sur le gouvernement des guerriers Tokugawa à Edo, vint à Tokyo occuper le château Edo pour initier sa propre politique. Meiji Tenno avant de mettre en place son administration instaura les Gokajixyo no Goseimon (cinq serments écrits) comme lignes directrices du gouvernement Meiji, qui lui permirent de moderniser avec un grand succès les domaines politique, militaire, éducatif et économique.
Les leaders du gouvernement Meiji étaient pour la plupart des samouraïs révolutionnaires des clans Satsuma, Choshu, Hizen et Tosa, qui avaient triomphé de l’ancien régime, et un petit nombre de samouraïs d’élite ayant appartenu à l’ancien régime des Tokugawa. Ils se réunirent pour manifester une union nationale contre l’éventualité d’une invasion étrangère. Ils avaient le rêve de faire du Japon une nation forte en Asie, qui pourrait être qualifiée de Grande-Bretagne d’Orient à l’avenir. En empruntant à la science et à la technologie avancée de l’Occident, ce fut une politique intelligente du gouvernement Meiji de décider ce qu’il fallait apprendre et de quels pays les Japonais devraient apprendre. Les Japonais n’autorisèrent pas toutes les inventions occidentales mais choisirent celles qui semblaient utiles au Japon à l’époque.
L’impulsion des dirigeants du gouvernement Meiji était nécessaire pour promouvoir les activités industrielles dans de nombreux domaines. Ils acceptèrent l’idée de créer un Ministère des Travaux Publics, comme le conseilla l’ingénieur écossais Edward Morrell qui avait acquis son expérience dans les Bureaux des Travaux Publics à Hong Kong. Puis le gouvernement Meiji employa un certain nombre d’étrangers venus de Grande-Bretagne (principalement d’Ecosse) pour enseigner les techniques modernes d’agencement portuaire et de construction des phares, la fabrique de locomotives et l’installation de rails, l’architecture navale et la construction de bateaux. Sous la direction du Ministère de Travaux Publics, le Koubu-Daigakko (le premier collège d’ingénierie de style occidental fut fondé en 1873 ainsi que le Kaisaiko (College d’Art) soutenu par le Ministère de l’Education. Après quoi de nombreux instituts d’études supérieures furent établis dans les plus grandes villes pour éduquer et former les ingénieurs et les fonctionnaires qualifiés indispensables à l’avènement d’une société industrielle. En un sens, le succès japonais du développement de ses ressources humaines a consisté à changer très rapidement de nouveaux diplômés universitaires en travailleurs dans des compagnies générales, puis de les former à des tâches spécifiques de haut niveau. Ainsi, la compagnie prit la place des propriétaires terriens et des Han de l’ère des Tokugawa, et c’est là que le fondateur de la compagnie Panasonic, Kounosuke Matsushi, élabora le concept d’emploi à vie. Cette idée a persisté même si peu à peu les compagnies japonaises ont évolué vers des méthodes de management à l’occidentale plus modernes.
Cette évolution s’est accompagnée de l’introduction d’une nouvelle éthique– une Idéologie d’Ingénieurs – pour changer la manière de penser féodale en un nouvel esprit, celui de travailler longtemps et avec diligence pour construire une nation moderne digne d’être appelée la Grande-Bretagne de l’Orient. De nombreux livres d’éducateurs écossais furent traduits en japonais, qui encouragèrent les gens à mieux comprendre le concept occidental de société. Un japonais, Saki traduisit le livre de W. Muirhead, M. Nakamura le livre de S. Smiles, T. Hayashi les livres de J.S.Mill ainsi que ‘La Richesse des Nations’ d’Adam Smith. Ces livres de penseurs et d’ingénieurs écossais exercèrent une forte influence sur la jeunesse japonaise en les familiarisant avec les caractéristiques générales de la civilisation occidentale. Après quoi, l’idéologie des ingénieurs – c’est-à-dire le fait qu’il faudrait accorder aux ingénieurs le statut d’appartenir à la quatrième profession moderne (à côté des avocats, des médecins et des prêtres, déjà reconnus aux époques médiévales) fut considérablement renforcée dans la société. (36)
Un ingénieur des chemins de fer écossais, E. Morel, qui avait travaillé en Inde et à Hong Kong, proposa que le gouvernement instaure un Ministère des Travaux Publics afin de promouvoir l’industrialisation de Japon. Il invita des ingénieurs comme J. England, H .Houghton, R. Abbey & T. Shann à se joindre à lui. De plus, W. Cargill, le directeur de la Banque d’Orient, s’employa à lever des fonds étrangers pour la construction de voies ferrées au Japon.
Il est important de noter le rôle de la Chambre de Commerce des diverses villes pour donner les informations nécessaires sur les nouvelles inventions et les nouvelles façons de faire des affaires aux membres des sociétés industrielles locales. Le premier institut de la Chambre d’ Industrie et de Commerce fut fondé à Glasgow en 1783 sur la recommandation du Professeur J. Anderson de l’Université de Glasgow, qui encouragea les hommes d’affaire et les marchands de Glasgow à investir la moitié de leur fortune au commerce avec les Antilles et l’autre moitié dans les industries lourdes dans l’ouest de l’Ecosse, aux environs de Glasgow. Après l’Union avec l’Angleterre en 1707, Glasgow connut un boom incroyable dans le commerce du tabac avec l’Amérique, parce que la distance entre Glasgow et la Virginie était la plus courte par mer. Plusieurs marchands prospères de Glasgow étaient appelés les Seigneurs du Tabac. Mais en 1776 l’Amérique déclara son Indépendance de la Grande-Bretagne et par conséquent le commerce du tabac et d’autres échanges avec l’Amérique s’interrompirent brusquement et disparurent. Alors, le Professeur Anderson, qui se trouvait la même année avec Adam Smith, encouragea les hommes d’affaire à fonder la Chambre de Commerce et d’Industrie pour maintenir la prospérité de ses membres. La deuxième institution de ce genre fut fondée à Manchester puis cette idée de chambres de commerce et d’industrie fut transplantée dans de nombreuses parties du monde. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tokyo fut fondée après celles de Nagasaki et Yokohama, où elles avaient été tranférées de Shanghai et Hong Kong par des déplacements de la diaspora écossaise. Même parmi les Américains visitant le Japon de l’ère Meiji se trouvaient des personnes d’origine écossaise, parce que les Ecossais avaient un réseau très large – pratiquement mondial – d’ information à travers des amis et des membres de leur famille qui étaient missionnaires, aventuriers, banquiers, ingénieurs des chemins-de-fer, constructeurs de navires aussi bien que journalistes .
Les samouraïs des clans Choshu et Satuma bénéficièrent de l’aide d’un marchand écossais, Thomas B Glover à Nagasaki, pour visiter la Grande-Bretagne avant l’ère Meiji, par opposition au gouvernement féodal des Tokugawa, et ils apprirent beaucoup de ce qui assurait le succès de l’industrialisation dans les pays occidentaux. Ils furent aidés par la compagnie de navigation dirigée par des Ecossais P&O et le réseau commercial écossais influent de Jardine Matheson. Glover était le marchand écossais le plus célèbre au Japon à l’époque et c’était lui pensait-on qui avait servi de modèle au Pinkerton dans l’opéra, Madame Butterfly, composé par Giacomo Puccini et fondé sur le roman américain de J.L. Long.
En raison de telles connections, les leaders de Meiji étaient soucieux de pousser les jeunes samouraïs à étudier les technologies modernes et également les méthodes de commerce internationales et tous les domaines scientifiques. Les ingénieurs écossais insistèrent pour que le métier d’ingénieur soit admis comme la quatrième profession parce qu’ils travaillaient dur et la main dans la main pour inventer et entretenir les machines et les appareils qui contribuaient à améliorer la qualité de la vie humaine. Cette conception pratique écossaise était d’autant plus nécessaire à l’époque Meiji au Japon qu’à l’époque féodale les jeunes recevaient une éducation poussée mais que sous l’influence du Confucianisme, le pilier éthique de la société féodale, ils détestaient le travail manuel. Si bien que pour dissiper de telles valeurs traditionnelles, les leaders de Meiji introduisirent des livres et des articles de philosophes écossais qui soulignaient l’importance de l’assiduité et de la coopération dans la société. Les jeunes Japonais, bien que très réticents à l’égard du travail manuel, ne furent pas long à apprendre les connaissances et la technologie de leurs maîtres écossais mais firent aussi preuve d’un plus grand développement. L’estime écossaise pour la qualité d’Ingénieur devait saper l’éthique féodale du Confucianisme, qui prédominait sous le régime des Tokugawa et elle vivifia le désir originel d’évolution du Japon.
En partie grâce à de jeunes maîtres écossais de qualité, le Japon connut un incroyable développement économique et social qu’ Henry Dyer décrivit dans son livre, Dainippon (La Grande-Bretagne d’Orient). On y trouve une description de l’histoire du Japon moderne de la Restauration Meiji jusqu’en 1901, comment les Japonais réussirent leur industrialisation pour devenir le pays le plus puissant d’Asie – vainquant la Chine en 1894 et préparant la guerre contre la Russie en 1904. En 1902, le traité Anglo-Japonais fut signé, reflet de la forte coopération économique entre la Grande-Bretagne et le Japon depuis la fin des années 1850. Toutefois, il faut noter que ces liens dans les sphères économiques et commerciales ne se poursuivaient pas dans les domaines politique et constitutionnel. En coulisses, un changement s’opérait qui conduirait à une modification dans les liens du Japon avec l’Occident. Sous la direction de M. H. Ito, un changement d’orientation de la constitution nationale, de la démocratie anglaise à la monarchie allemande débuta dans les années 1880 et s’acheva en 1890 quand un parlement japonais sur le modèle allemand fut introduit dans la constitution de 1889. Des révisions dans le système bureaucratique sous l’empereur Meiji, inspiré par des arrangements de l’Allemagne impériale furent également faites. A long terme, ces changements saperaient l’alliance anglo-japonaise.
Dyer, tout comme d’autres visiteurs du Japon à l’époque, admira le désir des Japonais de se familiariser avec les langues et les cultures étrangères et la capacité de le faire que leur donnait le haut niveau de l’éducation nationale dans le Japon feudal, qui encourageait la lecture et l’apprentissage dans toutes les classes sociales.
Ils furent impressionnés par la sobriété du mode de vie des Japonais, par leurs façons simples et modestes, et en particulier par la bonne conduite des femmes japonaises qui jouaient un rôle important dans l’éducation et les finances du foyer, en soutenant leur mari et en encourageant leurs enfants. Ils pensèrent même que le statut des femmes japonaises était peut-être supérieur à leur position en Occident. Mais Dyer et d’autres visiteurs occidentaux du Japon ont aussi craint que les leaders japonais ne soient trop pressés de progresser sur le plan économique, et mirent en garde contre l’imitation de l’impérialisme occidental, qui pourrait détruire la beauté et les vertus de la société japonaise.
6- Ressemblances éthiques entre l’Ecosse et le Japon
Avec de nouvelles activités commerciales et l’accroissement de la population, le système féodal dans le monde occidental commença peu à peu à s’effondrer, ouvrant la voie à l’époque des grandes navigations et aux débuts de la Révolution industrielle. Dans ce contexte, la philosophie écossaise du Calvinisme joua un rôle important en promouvant l’activité économique et l’innovation mécanique. Aux époques médiévales, l’Ecosse avait un sens développé de l’unité du people et une tendance égalitaire symbolisée par la Déclaration d’ Arbroath de 1320. En ce sens, la structure sociale écossaise était fortement soudée, à la fois verticalement et horizontalement au féodalisme. Il est intéressant de remarquer que les coutumes et habitudes écossaises, tout comme son système conventionnel unique de famille, de clans d’alliances et de népotisme, se révélèrent des facteurs efficaces pour promouvoir des Ecossais dans des rôles de dirigeants dans le commerce et l’administration des nouvelles terres auxquelles il eurent accès après l’Union avec l’Angleterre en 1707. Après cette Union, l’intellect et la créativité écossaises devinrent encore plus florissants. En particulier de célèbres philosophes comme James Stuart, Walter Scott, William Robertson et A. Carlyle, ainsi que David Hume et Adam Smith, promurent ce que l’on en vint à appeler l’Illumination L’ère des Lumières écossaise, les idées sur la base desquelles la société civile moderne est fondée. Ainsi, la première génération d’ingénieurs écossais contribua de façon substantielle à l’industrialisation de la Grande-Bretagne, créant simultanément une ‘philosophie de l’ingénierie’ qui valorisait les connaissances techniques, l’apprentissage et l’assiduité. La deuxième génération partit en Europe et en Amérique pour y établir des chemins de fer et des réseaux maritimes. Pareillement, la troisième génération partit en Asie et en Afrique pour y construire des réseaux ferroviaires et autres merveilles d’ingénierie. Les banquiers écossais suivirent les ingénieurs et devinrent les fondations solides d’un réseau financier écossais très étendu.
Le développement historique de l’Ecosse et du Japon diffèrent dans l’espace et dans le temps. Mais pourtant, il est indéniable que ce petit pays qu’est l’Ecosse exerça ce que l’on pourrait qualifier de la plus forte influence extérieure sur le Japon et les Japonais à la fin du 19e siècle. De nombreux Ecossais se rendirent au Japon à la fin de l’époque des Tokugawa et au début de l’époque Meiji. Parmi eux, W. Keswick, le petit-fils du fondateur de Jardine Matheson & Co, qui prolongea ses opérations basées en Chine à Nagasaki et Yokohama après que le Japon se soit ouvert au commerce avec l’étranger. A. A. Shand, un employé de la Chartered Mercantile Bank of India, London & China à Yokohama, contribua à la fondation de la Banque du Japon et facilita l’apprentissage professionnel nécessaire pour changer de jeunes Japonais en employés de banque. R. H. Brunton, qui devint le premier employé étranger du gouvernement Meiji en 1868, vint de la firme Robert Stevenson Co d’ Edimbourg pour construire des phares tout autour du Japon. A. R. Brown, un ancien capitaine de la P&O, aida tout d’abord Brunton à naviguer le long des côtes japonaises puis participa à la fondation de la N.Y.K., la première compagnie internationale japonaise de navigation à vapeur.
7- La société japonaise d’après la Seconde Guerre mondiale
Le Japon connut un progrès économique excessivement rapide de l’époque Meiji jusque dans les années 1930, lorsqu’il fut confronté à de graves problèmes pour avoir suivi le mode de développement occidental en abandonnant l’idée traditionnelle japonaise d’équilibre et d’harmonie entre des domaines reliés. L’époque des Tokugawa avait été un système économique et social statique, le Japon de Meiji manquait d’équilibre en poursuivant exclusivement le progrès économique et en perdant l’idée d’égalité. Hirofumi Ito décida de changer l’orientation nationale japonaise jusqu’alors d’émuler la société civile britannique en imitant la monarchie constitutionnelle allemande. Il commença à contrôler l’opinion publique et à interdire les critiques du gouvernement. Il fut soutenu par des politiciens de droite, des autorités militaires et des hommes d’affaires affiliés qui se servaient de la dignité de l’Empereur Showa pour manipuler l’opinion publique. Cette politique resta celle du gouvernement jusqu’à la défaite du Japon dans la Seconde Guerre mondiale.
Pendant l’occupation américaine, et sous le gouvernement du Quartier après 1945, les autorités politiques et sociales ont garanti la liberté d’expression, de religion et les droits humains individuels. Les Japonais acceptèrent les idées de la Renaissance américaine exprimées dans le livre American Renaissance: Art et Expression à l’époque d’ Emerson de Whitman. Cette éthique prenait racine dans l’idéologie de J. Bentham ‘le plus grand Bonheur pour le plus grand nombre’ ainsi que dans les idées de James Stuart Mill. Le développement économique du Japon d’après-guerre fut aussi une conséquence des apports américains de denrées pour continuer à mener les guerres de Corée et du Vietnam. L’économie japonaise se développa rapidement dans les années 1960 et devint mondiale dans les années 1970 – ce que le professeur américain W.W. Rostow décrivit comme l’étape de maturité et de haute consommation de masse dans son livre The Stages of Economic Growth (Les Etapes de la Croissance économique –1960).
Sous la surface de cette remarquable croissance économique d’après-guerre, l’éthique traditionnelle japonaise d’assiduité, de loyauté et de reconnaissance de leur fonction entre ouvriers fut un apport énorme.
Ces valeurs permirent aux entreprises japonaises de devenir les premières sur le plan international dans de nombreux domaines industriels et commerciaux. Vogel dans Japan as Number One (La Primauté du Japon) fait remarquer que de nombreux économistes ont fait l’éloge du succès du management japonais mais ont critiqué les logements japonais comparés à des cages à lapins.
Pour les Japonais dans leur ensemble, il est naturel de partager les tâches et la responsabilité avec le président de la compagnie et les collègues ainsi qu’avec les membres de la famille et les voisins. Cette habitude et cette philosophie fondées sur les principes du bouddhisme du Mahayana ont été inculquées aux Japonais, génération après génération. Bien que peu à peu modifiée par le style de management occidental, l’architecture du travail au Japon conserve cet avantage culturel en matière d’organisation.
8- Le bouddhisme du Mahayana de nos jours et le mouvement de la SGI
Il y a de nombreuses religions au Japon – du Shinto au Christianisme, au Taoïsme, à l’Islam et au Bouddhisme. Le bouddhisme lui-même comporte 13 courants de pensée principaux parmi lesquels Hinayana, Teravada, et Mahayana et revendique quatre-vingt-quatre millions de croyants. Parmi eux, la Soka Gakkai fondée par Tsunesaburo Makiguchi et son disciple Josei Toda a établi des institutions éducatives au Japon et aux Etats-Unis fondées sur la philosophie du bouddhisme de Nichiren. Makiguchi fut emprisonné pour ses croyances au cours de la Seconde Guerre mondiale et mourut en prison. Après sa mort, Toda fit revivre l’organisation qui devint mondiale sous la direction de son disciple Daisaku Ikeda. La Soka Gakkai Internationale préconise la révolution humaine, l’amitié internationale, les droits humains et la paix mondiale. La SGI s’est répandue dans 192 pays.
Le dynamisme d’Ikeda s’est révélé dans deux domaines—ses dialogues avec des personnalités importantes telles que l’historien britannique Arnold Toynbee, et ses rencontres avec des leaders mondiaux comme N. Kosygin d’ URSS et Zhou Enlai de Chine.
L’intérêt de Toynbee pour Ikeda résultait de la récupération du Japon après la guerre. Toynbee se rendit au Japon à trois reprises ; la première en 1929 (à l’âge de 40 ans), la deuxième en 1956 (à 67ans) et la dernière en 1967 (à 78 ans). Il fut impressionné par la capacité des Japonais à innover selon des méthodes américaines et par la fidélité du Japon à ses propres idéologie et culture. Il écrivit les réflexions suscitées par sa troisième visite dans son livre A Study of History (une Etude de l’Histoire) et émit l’opinion que les changements au Japon avaient peut-être quelque-chose à voir avec le mouvement de la Soka Gakkai qui pourrait exercer un bon effet sur la culture et la civilisation chinoises.
Quand en 1967 il vint au Japon sur l’invitation de l’Université Industrielle de Kyoto, il voulut conduire un dialogue avec Daisaku Ikeda. Ils se rencontrèrent finalement à Londres au domicile de Toynbee 1972 (à quatre reprises à partir du 5 mai en 1973 et du 15 mai au 19 encore quatre fois). Le résultat de ces rencontres fut qu’ils soulignèrent d’un commun accord l’importance de construire un monde de paix par des dialogues humanistes. Les idées de Toynbee allaient en direction du spiritualisme et du matérialisme alors qu’Ikeda insistait sur la recherche d’une voie du milieu afin de réunir des façons de penser extrémistes opposées. Ce dialogue fut intégré dans un livre intitulé « Choisis la vie » qui fut traduit en trente langues. A la fin de leur rencontre, Toynbee demanda à Ikeda d’établir de nouveaux dialogues avec d’éminents philosophes et artistes occidentaux comme Aurelio Peccei, André Malraux,René Huyghe,le comte Richard Condenhove-Kalergi. Les dialogues avec ces personnalités éminentes et 200 universitaires ont suscité des livres maintenant lus par des millions de personnes.
Après la Seconde Guerre mondiale, aussi bien Zhou Enlai qu’Andrei Kosygin dans leur désir de reconstruire leur pays, voulurent trouver une collaboration au Japon et une personne digne de confiance. Zhou Enlai demanda à Sun-Ping-hua, un ancien étudiant de l’Université Kogyo (industrielle) de Tokyo, d’aller au Japon avec un groupe d’artistes chinois pour se renseigner sur Ikeda et le mouvement de la Soka Gakkai et de lui soumettre un rapport. Lorsqu’il lut un article parlant de la proposition d’Ikeda de normaliser les relations entre la Chine et le Japon, prononcée lors d’un discours adressé aux membres du Département des Etudiants de la Soka Gakkai en juin 1968, il fut convaincu du rôle que joueraient Ikeda et la Soka Gakkai pour aider la société et l’économie chinoise à se reconstruire. A la même époque, la plupart des Japonais étaient incapables de promouvoir en toute bonne foi l’amitié avec la Chine communiste ou la Russie soviétique. La première visite d’Ikeda eut lieu à la fin de mai 1974 en passant par Hong Kong. Il se rendit à Pékin pour visiter l’Université de Beijing où il rencontra également M. Li Xian, le Vice Premier Ministre à l’époque, un ami proche de Zhou Enlai. En décembre 1974, au cours de son deuxième voyage en Chine, M. Ikeda se rendit à l’hôpital de Beijing pour rencontrer M. Zhou. Sa première visite en URSS eut lieu en septembre 1974 lorsqu’il rencontra le lauréat du Nobel M. Sholokhov et Alexei Kosygin. Par la suite, il se rendit à Moscou au cours de voyages en Europe et poursuivit un dialogue humaniste de paix avec des leaders russes comme Nikita S. Khrushchev et Mikhaïl Gorbachev.
De plus, M. Ikeda rendit visite en plusieurs occasions à des leaders chinois et souligna l’importance des échanges culturels et éducatifs. En fait, les liens universitaires de l’Université Soka avec l’Université Russe de Moscou et l’Université Beijing de Chine commencèrent par un paisible programme d’échanges universitaires en mai 1975. Au cours de plusieurs de ses visites en Russie et en Chine, M. Ikeda fit de grands efforts pour dissiper les malentendus entre l’URSS et la Chine en communiquant les promesses des deux leaders de rechercher la paix mondiale.
Pour finir, je voudrais souligner à quel point cette forte éthique au sein du people japonais n’a pas été entamée par trois récents désastres – les tremblements de terre de Kobe, Tohoku et Kumamoto. Quand deux grands tremblements de terre se produisirent à Kobé en 1995 et à Tohoku en 2011, les gens partout ailleurs dans le monde furent choqués et effrayés, en particulier par l’éventualité de fuites nucléaires. Mais le peuple japonais à fait preuve d’un incroyable sens d’unité, si bien que pas le moindre incident de cambriolage ou de vol ne s’est produit même en plein chaos. Le sens de kizuna ou de la communauté fut indéniablement présent. En particulier, les membres de la SGI de Tohoku ont été activement impliqués dans les opérations de sauvetage et de rétablissement. De plus, ils ont contribué à encourager des personnes dans le trouble et en difficulté grâce à l’humanisme de la philosophie Soka fondée sur le bouddhisme du Mahayana. Les Japonais ont démontré une solidarité sociale unique et une résilience qui doivent être profondément enracinées dans les profondeurs des îles japonaises. Ces trios exemples peuvent server de clé pour comprendre la force des Japonais et la force de leur culture qui traverse les générations, une force qu’ils tirent selon moi du bouddhisme du Mahayana.
9- Conclusion—L’influence de la pensée japonaise sur le monde
Dans les années 1850 et 1860 de nombreuses traductions en japonais de livres de philosophes écossais furent éditées et lues, telles que French Revolution (La Révolution française) de Carlyle, Self Help (S’aider soi-même) de Samuel Smile, The History of British India (l’Histoire de l’Inde britannique) de James Mill et le livre de son fils John Stuart Mill Principles of Political Economy (Principes d’Economie politique). The Wealth of Nations (la richesse des nations) d’Adam Smith était un ouvrage particulièrement prisé par les économistes japonais. Je suis convaincu que les ingénieurs écossais, avant et après l’ère Meiji, furent de bons maîtres pour la jeunesse japonaise au Royaume uni comme au Japon. La principale idée de La Richesse des Nations fut introduite par Smith dans The Theory of Moral Sentiments (la théorie des sentiments moraux en1759) qui expliquait que malgré la force de son intérêt personnel, l’homme possède la capacité de former des jugements moraux. Smith proposait une théorie de la sympathie, dans laquelle le fait d’observer les autres rend les gens conscients d’eux-mêmes et leur inspire une conduite morale). Henry Dyer, un ingénieur écossais et le premier directeur de Koubudaigakko (Université de Tokyo,1873-1882) fut appelé le père de l’enseignement de l’ingénierie moderne au Japon. Il qualifia l’évolution nationale à laquelle il avait participé de Dai Nippon (Grand Japon) parce qu’il voulait souligner le développement social japonais. A l’époque les savants occidentaux étaient très préoccupés par la théorie de l’évolution de Darwin et par le concept d’évolution sociale de Herbert Spencer. Dyer était convaincu que la dynamique du développement et de l’évolution du Japon avait son origine dans son Histoire, étroitement rattachée à l’énergie évolutive du bouddhisme du Mahayana et à la technologie japonaise de fabrication de fusils. Cette énergie bouddhique a également été responsable de la rapide reconstruction économique et sociale du Japon après la Seconde Guerre mondiale et les récents désastres naturels.
Un professeur américain de l’Université de Queens pense que le lien entre le bouddhisme et la société moderne vient du Dalaï-lama du Tibet et de l’énergie dynamique de Daisaku Ikeda du Japon. En ce sens les activités humanistes pour la paix mondiale de la Soka Gakkai internationale fondées sur le bouddhisme de Nichiren et les directives du président Ikeda sont importantes. Aussi bien le 8e Lord Elgin qu’Henry Dyer virent l’harmonie de la société féodale japonaise avant qu’elle subisse l’influence négative de la civilisation occidentale. Je suis persuadé que cette harmonie qu’ils virent dans le Japon feudal fut ravivée par le mouvement Soka dans la société japonaise de l’après-guerre.
Cette conférence a été organisée avec le soutien du Groupe Vinci

.
Conférence de Jean-Pierre DUPUY, professeur à Stanford (mardi 25 avril 2017)
Le libéralisme et les forces destructrices
La tâche de la philosophie est moins d’interpréter le monde que de forger et d’affiner les concepts qui permettent de le penser. L’humilité du philosophe lui commande de ne pas partir de zéro et donc d’essayer de comprendre ce qui a été fait en ce sens avant lui. Je vais donc vous proposer des lectures d’œuvres importantes dans l’histoire de la philosophie politique, morale, sociale et économique. Auparavant, cependant, venant de passer quatre mois dans l’Amérique de Donald Trump, je voudrais vous livrer quelques réflexions sur ce que, selon moi, signifie son élection. Je précise que ma connaissance de l’Amérique se fonde sur une expérience d’enseignement de 33 ans à l’université Stanford, le cœur de la Silicon Valley, ce qui est à la fois non négligeable et étroitement limité, puisque la Californie, et plus spécialement encore, la région de la baie de San Francisco, n’est pas l’Amérique, même si, selon un mot célèbre, c’est l’Amérique de l’Amérique.
Le cas Trump, donc. Rien n’illustre mieux ce qu’il faut entendre par passions destructrices. Pourquoi et comment a-t-il été élu ? Les Américains, dans leur majorité, ne le comprennent pas. Ils sont éberlués, comme si des Martiens avaient voté à leur place. L’objet de leur étonnement n’est pas l’idéologie ou les idées de Trump – il n’en a pas – ni même sa politique – il est fier de la proclamer imprévisible. Non, ce qui proprement stupéfie les Américains, c’est la personnalité de leur président. On a beaucoup parlé de son narcissisme, de son égocentrisme ahurissant, etc. Je crois que c’est tout le contraire. Le narcissisme, dans la définition qu’en donne Freud, traduit un moi plein de lui-même, jusqu’à la saturation. L’ego de Trump est vide. C’est pourquoi il lui faut absolument se nourrir de l’admiration, de l’attention, de l’amour des autres pour se remplir, tel un vampire qui s’abreuve du sang de ses victimes. C’est pourquoi le signe de rejet le plus dérisoire est vécu par Trump comme une humiliation intolérable et il n’aura de cesse que de faire payer à l’insolent le prix de son crime, y consacrant tout son temps et toutes ses énergies. La nosographie psychiatrique française parle de narcissisme pervers, l’américaine de syndrome d’Asperger. Amour de soi ? C’est plutôt de haine de soi qu’il faudrait parler en pensant au mot de Nietzsche : « Celui qui est mécontent de soi-même est continuellement prêt à s’en venger : nous autres, nous serons ses victimes …[1] »
Humiliation, ressentiment, esprit de vengeance : ce trio infernal est le monde de Trump, mais c’est aussi le monde de ceux qui ont voté pour lui, pauvres Blancs de la Rust Belt, cette région marquée par une forte désindustrialisation qui va des Grands Lacs jusqu’au Middle West et comprend la Pennsylvanie, la Virginie de l’ouest, l’Ohio, l’Indiana, le Michigan, l’Illinois et le Wisconsin, mais aussi les pauvres Blancs des régions rurales comme l’lowa et une partie du Wisconsin. La colère et la rage d’être laissés pour compte se sont manifestées avec une force qui a surpris les observateurs les plus chevronnés.
Tout cela est vrai mais je voudrais suggérer une explication plus anthropologique. Pendant la campagne, Trump a insulté avec une grossièreté et une vulgarité inouïes des catégories entières de la population. Chose étonnante, non seulement celles-ci ne se sont pas toutes révoltées mais, dans bien des cas, elles y ont trouvé motif à voter pour lui. C’est le cas des femmes, traitées par Trump comme des objets sexuels dont il peut faire ce qu’il veut. Cosi fan tutte, pour parler poliment comme da Ponte/Mozart. C’est aussi le cas, et je cite en vrac : des Mexicains, tous des voleurs et des violeurs ; des Musulmans, tous des terroristes ; des journalistes, tous ennemis du peuple américain et producteurs de « fake news » ; des handicapés moteurs, tel ce journaliste du New York Times dont Trump a cruellement parodié la claudication à la télévision ; des héros et anciens prisonniers de guerre, tel le sénateur républicain John McCain ; de ceux qui sont morts pour la patrie, tel ce jeune GI d’origine pakistanaise dont les parents se virent pendant une semaine la cible des railleries mesquines de Trump ; de tous ceux qui font des manières, les mous qui respectent les prétendus tabous, comme le non-usage de la torture ou le non-recours à l’arme nucléaire en premier.
Toutes ces catégories partagent un trait commun. Ce sont les vaches sacrées de la démocratie américaine. On n’y touche pas, sous aucun prétexte. Cette sacralisation des victimes donne, sur les campus américains, ce qu’on nomme la political correctness. Mais le phénomène est beaucoup plus général et participe de ce que certains anthropologues américains appellent le ressentiment victimaire[2] – non pas le ressentiment des victimes elles-mêmes, mais la rancœur de ceux qui prennent prétexte des victimes faites, réellement ou prétendument, par d’autres pour mieux les accuser et les persécuter. Ce souci pervers pour les victimes est selon Nietzsche, le plus antichrétien des philosophes, et sans doute, avec Rousseau et Dostoïevski, l’un des meilleurs analystes des passions destructrices, la marque du christianisme et de la morale d’esclave qu’il a enfantée. A quoi l’on peut rétorquer, avec un certain nombre d’écrivains catholiques, comme G. K. Chesterton, Georges Bernanos, Ivan Illich ou René Girard, que, certes, le monde moderne est façonné par les idées chrétiennes, mais des idées chrétiennes … « devenues folles »[3].
L’hypothèse que je vous soumets est que l’Amérique de Trump en avait assez de ce ressentiment victimaire. La vulgarité extrême de son héros a fait merveille. On osait enfin dire tout haut, et avec quelle violence, ce que beaucoup pensaient tout bas. Hillary Clinton, par contraste, représentait la quintessence de la bonne conscience – self-righteousness – puritaine.
***
Une fois caractérisé sur cet exemple contemporain ce que l’on peut appeler avec John Rawls les passions destructrices (disruptive), venons-en au libéralisme économique ou, plus précisément, à ce que l’anthropologue Louis Dumont a appelé l’idéologie économique[4].
Elle naît selon lui avec l’ouvrage de Bernard de Mandeville, un médecin hollandais d’origine française vivant à Londres, The Fable of the Bees, qui sera, au tout début du dix-huitième siècle, un incroyable succès de librairie. Cette fable nous est surtout connue aujourd’hui par la critique qu’en fit Adam Smith, quelque soixante ans plus tard. Le sous-titre de l’ouvrage en dévoile la morale, si l’on peut dire, une morale ô combien scandaleuse à l’époque car parfaitement contraire à l’enseignement de l’Eglise. Ce sous-titre est : « private vices, public benefits », qu’on peut traduire par : ce sont les vices privés qui maximisent l’intérêt général. Pour s’émanciper de la morale commune, c’est-à-dire chrétienne, nous dit Dumont, l’économie avait à prouver qu’elle portait en elle-même sa propre morale. C’est ce que raconte l’intrigue : des abeilles vivaient dans une ruche, parfaitement heureuses car actives, industrieuses, travailleuses et donc prospères, mues qu’elles étaient par ces « vices privés » que sont l’envie, la rivalité, l’esprit de concurrence, le désir de dépasser les autres, etc. Survient un pasteur anglican qui prêche les vertus théogonales : la foi, l’espérance et la charité, ainsi que les vertus cardinales : la prudence, la tempérance, la force d’âme et la justice. Les abeilles se laissent convaincre, elles cessent de travailler, la ruche périclite, les ressources se font rares, ce qui déclenche les passions destructrices dont nous venons de parler et précipite la chute de la ruche.
Il est à noter que la parabole de Mandeville parcourt un chemin qui va de la prospérité au déclin puis à la catastrophe afin de mieux mettre en lumière ce qui rendait la ruche heureuse et qui n’allait pas de soi. Si, maintenant, nous parcourons ce trajet en sens inverse, comme dans un film que nous déroulerions à l’endroit après l’avoir vu à l‘envers, nous voyons les passions destructrices se muer en passions vertueuses, car productrices de richesses. La chrysalide se métamorphose en papillon lorsque l’envie se fait émulation, la haine se transforme en concurrence, le ressentiment se transcende pour se faire dépassement de soi et le désir de vengeance qui est tourné vers la réparation du passé devient désir d’avenir. C’est dans cette direction qu’apparaît la véritable leçon de la fable, car le point de départ qu’observe Mandeville dans l’histoire des hommes correspond à la fin malheureuse de sa fable. Si les hommes de son temps ne sont pas heureux c’est qu’ils respectent des principes moraux dépassés.
Mon interprétation de la fable est donc celle-ci. L’économie fait barrage aux passions destructrices alors même qu’elle en provient. Le mal est capable de s’auto-transcender en une nouvelle forme du bien. En anglais comme en français comme dans d’autres langues latines, le verbe « contenir » a un double sens : avoir en soi et faire barrage à. Nous pouvons donc dire en une seule phrase : L’économie contient les passions destructrices dans le double sens du verbe « contenir ».
***
Il en va de même de la question du rapport de l’économie à la violence. Deux traditions s’opposent depuis le dix-huitième siècle, l’une qui nous dit que l’économie, c’est la violence, et l’autre qui rétorque que dans une société moderne, il n’y a pas de remède plus efficace contre la violence que le marché.
Tout le monde connaît la diatribe magnifique contre la propriété privée du plus anti-économiste des philosophes qui préparèrent par leurs œuvres la Révolution française, Jean-Jacques Rousseau :
« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne.[5] »
Que l’économie soit violente, les plus grands penseurs l’ont dit et écrit, quelle que soit leur idéologie. On peut citer la pensée marxiste et ses rejetons au vingtième siècle, comme l’Ecole de Francfort, avec les catégories d’exploitation et d’aliénation, la tradition nietzschéo-heideggérienne qui voit dans l’économie l’acmé de la pensée calculante et de la volonté de maîtrise sur le monde, l’écologie politique qui accuse le productivisme de faire l’impasse sur la destruction de la nature. Les penseurs libéraux comme Friedrich Hayek et même Adam Smith, qui voyait dans l’économie la source de la « corruption des sentiments moraux », ne sont pas en reste.
Tout cela est bien connu. Ce qui l’est moins est qu’il fut un temps où l’économie était considérée comme le principal moyen dont disposaient les sociétés en voie de « sortie de la religion » pour contenir la violence des hommes. La chose extraordinaire est que les arguments avancés pour justifier cette thèse étaient en grande partie ceux-là mêmes que les critiques de l’économie mettent en avant pour la condamner. C’est le mérite de l’historien de la pensée économique Albert Hirschman de l’avoir montré, dans son livre The Passions and the Interests. Political Arguments for Capitalism before its Triumph [6]. Hirschman nous conte l’émergence, le destin et le relatif déclin d’une idée : celle selon laquelle le comportement économique, entendu comme la poursuite privée du plus grand gain matériel, est un remède aux passions qui poussent les hommes à la démesure, à la discorde et à la destruction mutuelle. Dans une société en crise, déchirée par les guerres et les guerres civiles, ne disposant plus en la religion d’une instance régulatrice extérieure, l’idée que l’économie pourrait endiguer les passions serait née de la quête d’un substitut au sacré, capable de discipliner les comportements individuels et d’éviter la décomposition collective. L’ironie de l’histoire est grande. Comme l’écrit Hirschman, « le capitalisme était précisément censé accomplir cela même qui allait bientôt être dénoncé comme sa pire caractéristique [7]. » L’unidimensionnalisation des êtres réduits à leur capacité de calcul économique, l’isolement des individus et l’appauvrissement des relations, la prévisibilité des comportements, bref, tout ce que l’on décrit de nos jours comme l’aliénation des personnes dans la société capitaliste, était donc pensé, conçu comme devant mettre fin à la lutte meurtrière et dérisoire des hommes pour la grandeur, le pouvoir et la reconnaissance. L’indifférence réciproque et le retrait égoïste dans le domaine privé, voilà les remèdes que l’on imaginait à la contagion des passions violentes. Les auteurs que Hirschman mobilise pour appuyer sa thèse sont Montesquieu et certains membres des Lumières écossaises comme James Steuart et David Hume.
L’économie, est-ce la violence, comme l’affirme une tradition qui va de Marx à la critique actuelle du capitalisme ? L’économie, est-ce le remède contre la violence, comme le pense une tradition libérale, qui va de Montesquieu à Hayek ? L’économie est-elle remède ou bien poison ? Et si elle était, comme le pharmakos grec, tout à la fois remède et poison, ou, plus précisément, un poison qui est à lui-même son propre remède ? Si l’économie contenait la violence, dans le double sens du verbe « contenir » ?
***
Cela, c’est un grand philosophe qui tout à la fois appartient et n’appartient pas à la tradition libérale étudiée par Hirschman qui l’a puissamment pensé.
Il existe un ouvrage écrit par cet auteur, un non-économiste, dont la lecture est indispensable à qui veut comprendre les conditions de naissance de la théorie économique et dont le chapitre central, le pivot autour duquel tout l’argument s’organise, est intitulé, en traduction française, « Sur le mensonge à soi-même [8]». La lecture de ce chapitre nous convainc que le comportement dit « économique » n’a rien d’économique au sens ordinaire du terme. Si nous, modernes, courons après la richesse matérielle sans en être jamais rassasiés, c’est bien que ce que nous cherchons à travers elle n’est pas la satisfaction de besoins matériels : ceux-ci pourraient être comblés avec une quantité finie de ressources. L’illimitation de la quête trahit que son objet est infini comme seule peut l’être une entité immatérielle. On en veut toujours plus. L’économie n’est pas la gestion rationnelle des ressources rares, comme elle aime parfois à se définir, en en appelant à l’étymologie : l’économie comme le nomos de l’oikos, c’est-à-dire les conventions qui règlent la gestion des choses de la maisonnée. Non, nous explique l’auteur dont je parle, l’économie est mue par le désir – et plus spécialement le désir d’être reconnu par les autres, d’être admiré par eux, cette admiration fût-elle teintée d’envie. Et de cela, on n’a jamais assez.
Cependant, ajoute notre penseur, le système ne fonctionne que parce que les agents sont dans l’opacité sur leurs propres motivations et sur celles des autres. Ils croient à tort que la richesse leur apportera ce bien-être matériel qu’ils croient à tort nécessaire à leur félicité. Mais c’est parce qu’ils se trompent en attribuant à la richesse des vertus qu’elle n’a pas que, la convoitant, finalement ils ne se trompent pas. La richesse a bien les vertus qu’on lui prête, mais c’est précisément parce qu’on les lui a prêtées. La richesse attire sur celui qui la possède le regard de convoitise des autres. Peu importe que les autres convoitent ce qui ne mérite pas d’être convoité, ce qui compte, c’est le regard de convoitise lui-même. C’est de ce regard que, sans le savoir, chacun est friand. L’économie, c’est finalement un jeu de dupes, un théâtre dans lequel chacun est à la fois dupe et complice de la duperie. C’est un immense mensonge collectif à soi-même.
Qui est donc cet auteur, et quel est son ouvrage ? On aurait quelques excuses à répondre Alexis de Tocqueville, lui qui écrivait dans un chapitre savoureux du tome II de la Démocratie en Amérique, intitulé « Pourquoi les Américains se montrent-ils si inquiets au milieu de leur bien-être ? »[9] : « Chez les Américains, le matérialisme n’existe pour ainsi dire pas, quoique la passion du bien-être matériel soit générale. » On se tromperait cependant et de siècle et de langue.
Mon puzzle est un piège car l’auteur en question est connu non seulement comme économiste, mais comme le père fondateur de la discipline. Il s’agit en effet d’Adam Smith, au sujet duquel les pires bêtises ont été écrites au fil des siècles. Cependant, à l’époque où il rédige La Théorie des sentiments moraux, publié en 1759, il n’est pas encore l’économiste qu’il va devenir en travaillant à l’ouvrage qui va le rendre célèbre, l’Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, qui date de 1776. C’est un représentant éminent de ce qu’on a appelé les Lumières écossaises, un philosophe de la morale exerçant à Glasgow et sa Théorie, qu’il considérera toujours comme la matrice de l’Enquête, représente la synthèse de ses réflexions en matière de philosophie de la société. Oui, pour Adam Smith, la richesse est ce qui attire le regard des autres, et cela parce qu’ils la désirent. Et, finalement, s’ils la désirent, c’est pour être eux-mêmes regardés. Le pauvre souffre moins de son indigence matérielle que du fait que personne ne fasse attention à lui.
En commettant un anachronisme, on peut dire que pour Smith, nous sommes tous des narcissistes pervers. Nous attachons énormément d’importance à un statut qu’on ne peut appréhender directement. Nous avons seulement accès à des signes de ce statut, en particulier à ceux que renvoient les autres, par leurs regards avant toute chose, de la même manière que les Grecs ne pouvaient connaître l’état de leur daimon que dans la prunelle d’autrui. Nous sommes prêts à payer très cher pour que ces signes nous soient favorables. En veut-on un exemple ? Combien d’hommes ne sont-ils pas disposés à acheter un jugement positif de leurs pairs ? N’est-ce pas complètement irrationnel ? A quoi sert-il d’être approuvé si on sait qu’on ne le mérite pas ? Et si on sait qu’on le mérite, peu nous importe que les autres ne le sachent pas. « Quand un homme a acheté tous ses juges, la décision la plus unanime de la cour est impuissante à le rassurer sur son droit ; et eût-il engagé son procès dans l’unique but d’avoir cette assurance, qu’il n’aurait en aucun cas acheté ses juges. » Cette remarque apparemment de bon sens est de la plume d’Adam Smith. C’est en comprenant que son étonnement procède d’une très grande naïveté que Smith devient économiste et écrit La Richesse des Nations. Il a saisi pourquoi les hommes soudoient leurs laudateurs. C’est que, lorsque le « tribunal supérieur » de la conscience est muet, ou incertain, seuls les mouvements du public peuvent leur fournir les critères de l’excellence et du méritoire.
On trouve dans la Théorie des sentiments moraux le récit d’une lutte entre l’homme intérieur (the man within, le « spectateur impartial ») et le spectateur en chair et en os (the man without), en proie à ses désirs et ses passions). C’est la lutte entre l’idéal d’une conscience définitivement dégagée de ses origines sociales et la réalité de l’opinion publique avec sa versatilité. Il faut lire le chapitre étonnant que Smith consacre au désir d’être approuvé par les autres, et au rapport que ce désir entretient avec celui d’être digne d’une telle approbation — c’est-à-dire de pouvoir s’approuver soi-même. Il voudrait bien montrer que, quoique le désir d’être digne de l’approbation des autres s’enracine dans le désir d’être approuvé par eux, il conquiert une certaine autonomie, une indépendance relative, et que la conscience s’élève par auto-transcendance au-dessus du jugement des spectateurs ordinaires. Mais c’est en vain. Et c’est finalement la richesse économique qui surgit comme l’objet sur lequel tous les désirs convergent car, attirant sur nous le regard d’autrui, autrui qui est exactement dans la même position que nous par rapport à elle, elle est le signe de cette qualité d’être que nous voulons tous posséder sans jamais être certains que nous la possédions.
Si, contrairement à son sens initial, où l’on entrevoit la ladrerie légendaire des Ecossais – « faire des économies » – l’économie a pour horizon la croissance indéfinie, c’est qu’elle est mue moins par les besoins que par le désir. A de rares exceptions près, l’histoire de la pensée économique après Adam Smith repose sur l’oubli, ou le refoulement, de cette idée fondamentale. Puisque l’économie (réalisée) est un immense mensonge à soi-même, on ne s’étonne pas que l’économie (comme théorie) participe pleinement de cette duperie généralisée.
***
L’une des dimensions essentielles de l’éthique est la justice et, puisqu’il s’agit d’économie, la justice distributive, aussi appelée – à tort, selon Hayek – justice sociale. La justice sociale est l’un des grands thèmes de la philosophie libérale. Un préjugé tenace veut, en France, que la justice « sociale » soit la préoccupation majeure du socialisme, et que le libéralisme s’en soucie comme de l’an quarante. Or, c’est l’inverse qui est vrai. Il n’existe pas à proprement parler de théorie marxiste ou socialiste de la justice sociale, alors que la pensée libérale en aura produit à foison. Il y a bien, chez Marx, une théorie de l’aliénation et de l’exploitation capitalistes, mais elle est englobée dans un déterminisme historique qui lui enlève toute valeur normative. Quant à la société communiste sans classes, ce serait, si elle existait, une société d’abondance où ce que Hume appelait le contexte de la justice serait absent : les ressources ne seraient pas rares, les hommes ne seraient pas en concurrence les uns avec les autres.
Je vais pour conclure examiner brièvement deux théories libérales de la justice, la première, celle de John Rawls, qui relève du libéralisme politique, la seconde, celle de Friedrich Hayek, du libéralisme politique et économique. On peut dire qu’elles se situent aux deux extrémités du spectre politique libéral, l’une assimilable par une social-démocratie libérale, l’autre au fondement de ce qu’on appelle d’un terme flou le néolibéralisme. Et cependant, sur la question du rapport aux passions destructrices, et singulièrement l’envie, qui est l’objet de cet exposé, elles présentent des similitudes troublantes.
Une des principales caractéristiques de l’envie est qu’elle ne reconnaît pas, du moins pas ouvertement, le mérite d’autrui. Elle cherche et trouve toujours des excuses à son succès. Or c’est un trait général des théories libérales de la justice qu’elles sont non-méritocratiques, et même anti-méritocratiques dans le cas de Rawls. Seraient-elles travaillées par l’envie alors même qu’elles éprouvent le besoin de montrer qu’une société bonne et juste selon leurs critères réduit les passions destructrices à leur plus simple expression ?
5.1. Rawls énonce deux types de propositions à propos du mérite, qu’il convient de distinguer soigneusement.
- Les règles qui doivent présider à la répartition du produit social ne sont pas le symétrique inverse des lois pénales : celles-là ne récompensent pas la vertu comme celles-ci sanctionnent le crime. Le principe selon lequel les parts du « gâteau social » devraient être calculées en proportion du mérite de chacun n’a pas sa place dans le contrat social originel. La justice sociale « rawlsienne » n’est donc pas méritocratique.
- Les chances de mener une vie pleine ou médiocre dépendent des institutions de base de la société, certes, mais aussi de la loterie naturelle et de la contingence des circonstances sociales de la naissance. Or celles-ci sont arbitraires d’un point de vue moral, aucun mérite ne s’y attache. Nul ne mérite ses talents et ses capacités. Rawls va, en vérité, beaucoup plus loin, puisqu’il affirme que même les efforts déployés par un individu pour cultiver ses dons ne peuvent être mis à son actif, ces efforts étant eux-mêmes déterminés par les capacités et les talents naturels. Les dons et les efforts, étant arbitraires, doivent être neutralisés dans la sphère morale.
Les propositions de type (2) ont tellement choqué qu’elles ont accaparé l’attention. On a dit, sur le ton de la réprobation : « Rawls refuse que le partage social soit corrélé aux talents et même aux efforts pour la raison que, selon lui, on n’a aucun mérite à posséder ses talents, on n’a aucun mérite à faire des efforts ». L’image d’un Rawls anti-méritocratique est née de cette interprétation. Or, qu’on y réfléchisse. Si Rawls tenait le raisonnement qu’on lui prête, cela signifierait tout au contraire qu’il est méritocratique – or, il ne l’est pas, ainsi que l’affirment les propositions de type (1). Quelqu’un qui affirme: « On n’a droit aux biens que si on le mérite » accepte ipso facto le principe : « A chacun selon mérite » – ce qui n’est pas le cas de Rawls. On est en pleine confusion logique. La source, cependant, n’en est pas l’illogisme des interprètes, mais une réelle difficulté anthropologique.
Je ne peux ici que présenter le schème d’une analyse fort complexe1. L’un des principes de justice selon la théorie rawlsienne porte sur la répartition de la richesse économique et sociale. Justement nommé « principe de différence », il établit que les inégalités en la matière ne sont légitimes que dans la mesure où elles contribuent à la maximisation du lot du plus mal loti. Ce principe peut justifier des inégalités, pour autant qu’elles aient un effet « incitatif ». On rémunérera donc les talents et les efforts, mais ce non pas pour des raisons morales, comme ce serait le cas en méritocratie, mais comme moyen efficace d’atteindre une fin morale : accroître le bien-être des plus malheureux. La différenciation sociale légitimée par le principe de différence a une valeur purement fonctionnelle. C’est ainsi que Rawls entend neutraliser, dans le domaine moral, l’inégalité due à la loterie naturelle et sociale : non pas en l’annulant, mais en la mettant au service des plus mal lotis.
L’architecture de la théorie quant au mérite tient donc dans les trois propositions suivantes :
- La justice implique une corrélation positive entre talents et efforts, d’un côté, parts de la richesse sociale, de l’autre, afin que le lot le plus faible soit le plus grand possible ;
- On n’a aucun mérite à ces talents et ces efforts ;
- Donc, la corrélation parts/talents-efforts ne traduit pas un principe méritocratique.
Cette configuration, bien que logiquement cohérente, est étrange et parfaitement inhabituelle. Elle rend Rawls très vulnérable à la critique, tant de droite – « On prive l’individu de ce qui fait sa substance : ses dons, sa peine, les risques qu’il encourt, etc. ! » – que de gauche – « On légitime des inégalités par des données naturelles ! ». Pourquoi Rawls s’est-il mis dans un aussi mauvais pas ?
J’ai suggéré comme réponse : la menace que fait peser l’envie sur la théorie de la justice. La bonne société rawlsienne est une société que tous s’accordent publiquement à reconnaître juste, et qui pousse aussi loin que possible les conditions d’une véritable équité dans l’égalité des chances. C’est par ailleurs une société inégalitaire, où les inégalités sont corrélées avec, et donc donnent à voir, les différences d’aptitudes, de talents, de compétences et d’efforts.
Comment ceux qui sont au bas de l’échelle pourraient-ils s’en prendre à d’autres qu’eux-mêmes de leur infériorité ? A quoi s’ajoute qu’ils devraient en principe se montrer reconnaissants de ce qu’ils ne sont pas plus malheureux qu’ils sont, et en rendre grâce à leurs congénères plus favorisés. Dans une telle société, l’envie a le champ libre. Pour lui couper la route, il faut supprimer le mérite – c’est-à-dire la différence dans la valeur individuelle. Car c’est penser que l’autre mérite sa bonne fortune qui déclenche les tourments de l’envie, et non la pensée inverse, qui est la seule à s’exprimer ouvertement.
D’où l’insistance de Rawls, si paradoxale dans le contexte idéologique qui est le sien, sur l’arbitraire des conditions initiales, et l’absence de mérite ou de démérite qui s’y attache. Pour caricaturer quelque peu, le pauvre, dans la société juste, n’aurait à souffrir de nul complexe d’infériorité parce qu’il saurait que s’il est pauvre c’est qu’il est taré ; quant au riche, il n’aurait pas de raison de se sentir supérieur parce qu’il saurait que tant ses talents que ses aptitudes à l’effort ne sont que des moyens, qu’ils a reçus de la nature, sans autre valeur que fonctionnelle, de rendre la société plus juste.
La solution rawlsienne ne pourrait fonctionner que si les sociétaires eux-mêmes se persuadaient que le mérite n’est pas en jeu. Malheureusement, plongé dans un univers de concurrence, l’individu moderne n’accepte pas, dans sa voracité, qu’on prétende lui retirer toute une part de lui-même : ses dons, ses talents, ses efforts – son « mérite », en un mot. Les gagnants ne veulent pas qu’on les prive de leur prestige, ni les perdants de leurs tourments.
On ne peut mettre le mérite hors circuit. Il le faudrait pourtant, pour que la société juste ne soit pas une société invivable. Telle est l’aporie de la justice sociale dans une société de concurrence.
5.2. De semblables contorsions et distorsions logico-anthropologiques se repèrent au cœur de la philosophie sociale et politique de Friedrich Hayek, et cela pour les mêmes raisons. Tel est du moins ce que je crois avoir démontré[10].
La « main invisible » du marché a chez Hayek un sens très différent de celui qu’elle a dans le modèle néo-classique formulé pour la première fois par Léon Walras, et qui constitue l’ossature de la théorie économique telle qu’elle est enseignée aujourd’hui dans toutes les universités du monde. Il ne s’agit plus de la composition spontanément harmonieuse de comportements qui, bien qu’ils n’aient pas l’intérêt commun pour objet, restent néanmoins, au plan individuel, guidés par un esprit de calcul et un souci de rationalité. Il s’agit plutôt de l’auto-organisation propre à la termitière – une termitière où, toutefois, l’imitation aurait pris le relais de l’instinct. Des comportements individuels, bien qu’aveugles, réussissent à former un système efficace grâce à la « sélection » culturelle qui élimine ce qui doit l’être.
On souffre beaucoup dans le marché selon Hayek, au moins autant que dans les marchés du monde réel : les gens ne trouvent pas de travail ou perdent leur emploi, les entreprises font faillite, les fournisseurs sont abandonnés par leurs clients de longue date, les spéculateurs jouent gros et perdent tout, les produits nouveaux font un bide, les chercheurs, malgré de longs et pénibles efforts, ne découvrent rien, etc. Or ces sanctions tombent comme des coups du sort, injustifiées, imprévisibles, incompréhensibles. La base de la critique hayékienne des politiques de « justice sociale » n’est pas qu’elles dérèglent le système des incitations économiques (« travailler plus pour gagner plus ») puisqu’il n’y a pas ici, de toute évidence, d’incitations efficaces. C’est que de telles politiques ne peuvent elles-mêmes qu’être aveugles, car on ne dicte pas à un ordre social spontané les résultats qu’il doit atteindre. Il n’y a pas de régulation concevable qui ignore l’autorégulation spontanée du marché.
C’est la thèse, chère à Hayek, de la « complexité sociale » qui fonde l’argumentation précédente. Nul ne peut fixer a priori la valeur d’un travail, d’un effort ou d’un produit car seul le marché en décide et ses arrêts ne peuvent être anticipés. Les agents n’ont pas accès à ce savoir collectif que représentent les prix avant qu’ils s’établissent sur le marché. Un travailleur français apprend brutalement que la valeur pour la collectivité de ses services et de sa qualification est devenue nulle au moment où il est licencié, telle multinationale ayant décidé de fermer l’usine qui l’employait – et ce parce que les conditions économiques mondiales rendent plus rentable de s’installer à Singapour ou au Brésil. Certes, dans un monde d’information parfaite, comme les économistes se plaisent à l’imaginer, notre homme aurait pu anticiper le processus de « délocalisation » et, soit migrer, soit acquérir à temps une nouvelle qualification. La complexité du processus social l’interdit, affirme Hayek. Pour mieux se faire entendre, c’est souvent les termes de hasard, de chance ou de malchance, plutôt que celui de complexité, qu’il utilise. Mais un rapport profond unit les catégories de hasard et de complexité[11]. Ce ne sont donc pas seulement le mérite ou la valeur morale qui peuvent être aveuglément sanctionnés par le marché ; ce sont aussi l’effort, le talent, l’habileté, les choix stratégiques réfléchis : nulle récompense garantie face aux aléas et à la contingence de la vie sociale.
Hayek est loin d’ignorer le risque que le marché puisse exacerber les passions destructrices. Les hommes souffrent inévitablement de l’envie dans un marché concurrentiel, où seuls comptent le succès et l’échec. L’échec signifiant l’incapacité à servir autrui adéquatement, il entraîne inévitablement la perte de l’estime des autres et, par voie de conséquence, la perte de l’estime de soi. Or le remède contre cette menace, Hayek va le chercher dans la solution la plus traditionnelle : l’appel à une extériorité. Et c’est bien sûr la « complexité » de la dynamique sociale qui lui fournit l’extériorité dont il a besoin. La citation suivante de Hayek est suffisamment éloquente :
« On supporte plus aisément l’inégalité, elle affecte moins la dignité, si elle résulte de l’influence de forces impersonnelles, que lorsqu’on la sait provoquée à dessein. Dans la société de concurrence, un employeur n’offense pas la dignité d’un homme en lui disant qu’il n’a pas besoin de ses services, ou qu’il ne peut pas lui offrir un travail intéressant. Le chômage ou la perte de revenu pour quelque autre raison, choses qui arrivent immanquablement dans toute société, sont moins dégradants si l’on peut les considérer comme la conséquence d’une malchance, et non pas comme voulus par l’autorité. »[12]
Comme chez Rawls, le problème est que cette solution ne peut fonctionner qu’à la condition que tous partagent la conviction du philosophe, à savoir qu’ils ont affaire à une véritable extériorité. Nul ne s’abandonnera à ces « forces impersonnelles » que Hayek présente comme providentielles s’il a de fortes raisons de douter qu’elles entraînent le monde dans la bonne direction, ou simplement dans une direction viable. Or l’« ordre étendu du marché » peut aisément s’enfermer dans des impasses ou même plonger dans l’abîme, comme l’expérience historique le prouve régulièrement.
L’erreur philosophique fondamentale des théories de la justice est de croire qu’il existe une solution au problème de la justice et que cette solution résout du même coup la question des passions destructrices. L’erreur, la faute même, est de croire qu’une société juste et qui se sait comme telle est une société qui coupe court au ressentiment ; de ne pas voir que c’est précisément dans une société qui s’afficherait publiquement comme juste que ceux qui s’y trouveraient en situation d’infériorité ne pourraient qu’éprouver du ressentiment. Le Saint-Georges de la géométrie morale se vante de vaincre le dragon de l’envie. Quelle présomption fatale, comme aurait dit Hayek ! Fatale, car elle éloigne de ce qu’on peut et doit faire : étant entendu qu’on ne supprimera pas le ressentiment, la seule question pertinente est de savoir comment on peut en minimiser ou en différer les effets, les canaliser vers des formes bénignes voire productives, etc. C’est à l’échelle internationale – à propos de laquelle le rawlsisme n’a strictement rien d’intéressant à dire – que cette tâche doit désormais être entreprise et réussie
***
En guise de conclusion : pour les philosophies libérales, il ne s’agit pas de faire que le bien l’emporte sur le mal, puisque le bien est contaminé par le mal. Les plus subtiles d’entre elles perçoivent une propriété du mal dont on ne trouve l’équivalent, du moins dans le monde occidental, que dans les Evangiles[13]: Satan est capable de faire échec à Satan. Ce libéralisme comprend que le mal – les passions destructrices – peut parfois se contenir lui-même en s’auto-dépassant. Je pense en particulier à la philosophie politique que le romantique et romancier Benjamin Constant, ce grand lecteur d’Adam Smith dont je n’ai dit mot ici, a déduit de sa connaissance de la complexité de l’âme humaine. Ce libéralisme-là, à l’opposé des simplifications outrancières de la pensée économique, mérite tout notre respect.
Notes
[1] Frédéric Nietzsche, Le Gai savoir, section 290.
[2] En particulier, Eric Gans, professeur à UCLA.
[3] Georges Bernanos, s’inspirant d’un mot célèbre de G. K. Chesterton.
[4] Le mot « idéologie » n’a pas chez Dumont le sens négatif qu’il a chez Marx : c’est un système d’idées et de valeurs partagées par les membres d’une même société. Voir Homo Aequalis, I: Genèse et épanouissement de l’idéologie économique, Gallimard, 1977 ; et Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Seuil, 1983.
[5] Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Seconde partie, 1754.
[6]. Princeton University Press, 1977.
[7]. Ibid, p. 132.
[8] En anglais, langue dans laquelle l’ouvrage fut écrit : « On self-deceit ».
[9] Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, vol. II, Paris, 1840, Deuxième partie, chapitre XIII. Je souligne.
1 Je me permets de renvoyer à mes livres Le Sacrifice et l’Envie. Le libéralisme aux prises avec la justice sociale, Calmann-Lévy, 1992, et Libéralisme et justice sociale, Hachette, coll. Pluriel, 1997.
[10] Ibid.
[11] Cf. Henri Atlan, L’Organisation biologique et la Théorie de l’information, Hermann, Paris, 1972 (rééd. 1992).
[12] Friedrich Hayek, La Route de la servitude, tr. fr., PUF, 1985, p. 80-81. Je souligne.
[13] Marc 3:23-26 et Mathieu 12, 22-29.
Cette conférence a été organisée avec le soutien du Groupe Vinci

.
Conférence d’Angel Gurria, Secrétaire général de l’OCDE, correspondant de l’Académie (lundi 20 février 2017)
Rétablir la confiance : replacer l’éthique au cœur de l’économie
C’est un honneur pour moi d’être élu « correspondant » de l’Académie des sciences morales et politiques. Créée il y a plus de 220 ans, cette institution perpétue la rigueur intellectuelle d’une grande époque porteuse de progrès: les Lumières. Vous rassemblez quelques-uns des esprits les plus novateurs de l’ensemble des sciences sociales. Je succède à M. Boutros-Boutros Ghali, sixième Secrétaire Général des Nations Unies, et un grand artisan de la paix. Je suis fier de suivre ses traces et d’être associé à votre institution.
J’espère que cette distinction sera le nouveau trait d’union qui renforcera la coopération entre l’Académie et l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’OCDE). Plus que jamais il importe de resserrer cette coopération afin de promouvoir et d’actualiser les valeurs sur lesquelles sont fondées nos nations. Plus que jamais, nous devons œuvrer ensemble à la défense des principes d’intégrité, de liberté d’expression, de dialogue éclairé, de tolérance multiculturelle et de coopération internationale. C’est impératif !
Les temps sont difficiles
L’heure est grave. Nos pays sont toujours confrontés aux conséquences de la pire crise économique que nous ayons connue.
Huit ans après l’éclatement de la crise, la croissance annuelle mondiale reste hésitante autour de 3 %. La faiblesse des échanges et de l’investissement continue de peser sur la consommation, freinant l’augmentation de la productivité et des salaires. Les taux de chômage demeurent inacceptables. Dans les pays de l’OCDE, 38.5 millions de personnes sont sans emploi, soit près de 6 millions de plus qu’avant la crise. Le plus préoccupant, c’est que c’est notre jeunesse qui paie le plus lourd tribut. En France, le chômage des jeunes atteint 25 %, pratiquement le double de la moyenne OCDE, qui se situe à 13 %[i]. En Italie, c’est presque 40% et en Grèce et en Espagne, ce sont près de la moitié des jeunes (44 % et 44.5%)[ii].
Ce contexte difficile est encore aggravé par le creusement des inégalités. Selon notre analyse, dans les pays de l’OCDE, les 10 % les plus riches gagnent aujourd’hui environ dix fois plus que les 10 % les plus pauvres, contre sept fois plus il y a 30 ans[iii]. Dans certaines économies émergentes, l’écart est encore plus important, près de vingt fois plus au Mexique et au Chili[iv], et 28 fois plus au Brésil. Selon une récente étude du Crédit Suisse, 1 % de la population possède 50 % de la richesse mondiale, tandis que l’actualité est émaillée de scandales de corruption impliquant de hauts responsables des secteurs privé et public.
Voilà autant de facteurs qui minent gravement la confiance. Dans les pays de l’OCDE, seuls quatre citoyens sur dix font confiance à leur gouvernement[v]. En France, le niveau se situe même plus bas, vers les 30 %, alors qu’il était proche de 40 % en 2007[vi].
Cette crise de confiance constitue un terreau propice au rejet de la mondialisation, à la résurgence du protectionnisme, du populisme et de ce que Paul Collier a appelé « le nationalisme exclusif ». Ainsi, seule la moitié de la population française (51 %) estime que l’insertion de la France dans l’économie mondiale ouvre de nouveaux marchés et fournit des opportunités de croissance. Moins d’un quart des Français (24 %) estiment que le commerce crée des emplois[vii]. Ces craintes, réelles, pourraient exercer une influence déterminante sur l’issue du scrutin présidentiel d’avril prochain.
Nombreux sont ceux qui assimilent les systèmes économiques, l’économie de marché, les accords de libre-échange, les unions monétaires et la libéralisation des marchés de capitaux à des créations de technocrates. Ils estiment que ces mécanismes, cette dynamique que nous appelons mondialisation, profitent pour l’essentiel à quelques privilégiés. Ce qu’ils appellent « la clique de Davos ». De plus en plus, le public pense que le système a été détourné par quelques privilégiés à leur profit.
Il nous faut répondre à ces inquiétudes ! Nous devons inverser cette tendance !
Nous devons rétablir la confiance
Il nous faut rétablir la confiance ! Et commencer par reconnaître que nombre de nos concitoyens n’ont pas bénéficié de certaines des politiques et systèmes économiques que nous avons mis en place. Nous devons admettre qu’un grand nombre de travailleurs n’ont pas vu augmenter leur revenu réel pendant plus d’une vingtaine d’années. Nous devons prendre conscience que dans l’économie numérique du XXIe siècle, les plus vulnérables n’ont souvent pas accès aux formations, aux technologies et aux opportunités qui leur permettraient de prospérer.
Il est temps de rétablir la confiance en plaçant l’humain et l’éthique au cœur de notre conception de l’économie. Le moment est venu de repenser nos cadres, théories et modèles économiques. De recentrer nos réformes et nos politiques, nos systèmes fiscaux et nos cadres de réglementation sur la redistribution des revenus et de la richesse, mais aussi sur les opportunités et les compétences. Le moment est venu de corriger les défauts de la mondialisation pour qu’elle profite à tous pleinement.
Consciente de la nécessité du changement, l’OCDE mène des travaux sur de multiples fronts :
- Nous travaillons à définir, promouvoir et mesurer une nouvelle logique de croissance. La « croissance inclusive » dépasse la notion de PIB pour accorder une place centrale au bien-être et aux opportunités. C’est pourquoi nous réexaminons nos modèles et théories économiques dans le cadre de notre initiative sur les Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC), lancée en 2012. Nous avons par exemple élaboré un cadre d’analyse de la qualité de l’emploi et un Indicateur multidimensionnel du niveau de vie (MDLS), qui reservent une place plus importante à la qualité des emplois et de la croissance.
- Nous portons un regard neuf sur les relations entre le creusement des inégalités et le ralentissement des gains de productivité, qui freinent la progression des salaires et contribuent à miner la confiance. Le projet sur l’articulation productivité-inclusivité, que nous avons lancé lors de notre Réunion ministérielle de juin 2016, a pour but d’expliquer comment les pays peuvent accroître les actifs productifs de leur économie en réduisant les inégalités, en investissant dans les compétences et en favorisant l’équité des règles du jeu des entreprises.
- La reconversion professionnelle revêt aussi une très grande importance. C’est pourquoi nous travaillons avec les gouvernements à élaborer des stratégies nationales de compétences, qui ont pour but de mettre en adéquation les systèmes éducatifs avec les besoins de l’économie du savoir du XXIe siècle. Nous lançons également un nouveau projet horizontal qui etudiera comment les politiques sociales, en particulier les politiques d’éducation et de formation, mais aussi une meilleure intégration des immigrés et des filets de sécurité sociale plus efficaces, peuvent faire de la transformation numérique un moteur de la croissance inclusive.
- Nous sommes en train de corriger les défauts du système multilatéral pour faire en sorte que tous les acteurs suivent les mêmes règles. Plus de 90 pays et juridictions se sont engagés à mettre en œuvre le Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Et des progrès tout aussi encourageants doivent être mentionnés en ce qui concerne la norme d’échange automatique de renseignements à des fins fiscales, que plus d’une centaine de pays se sont engagés à appliquer. Les autorités chiffrent déjà à près de 80 milliards d’euros les recettes fiscales supplémentaires découlant de déclarations volontaires.
- L’OCDE coopère aussi étroitement avec le G7 et le G20, sur des enjeux qui sont liés de très près au rejet de la mondialisation. Ainsi, les dirigeants du G20 ont demandé à l’Organisation de mettre sur pied un Forum mondial sur les surcapacités sidérurgiques. L’OCDE s’est aussi associée au G20 pour produire une version révisée des Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, qui énoncent des normes reconnues mondialement sur la transparence, la responsabilité et l’intégrité dans les affaires.
- Nous nous employons à améliorer les normes et accords multilatéraux pour que la mondialisation soit plus équitable et inclusive. La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption est le premier instrument international qui met l’accent sur l' »offre » de corruption. S’agissant de la conduite responsable des entreprises, les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sont l’instrument le plus complet concernant l’éthique des entreprises. Seulement le mois dernier, le Conseil de l’OCDE a approuvé la Recommandation de l’OCDE sur l’intégrité publique, qui donne aux pays un outil pour défendre et faire primer l’intérêt général sur les intérêts privés dans le secteur public. Nous progressons aussi rapidement dans nos travaux sur la protection des lanceurs d’alerte, et nos outils concernant la concurrence.
- Enfin, l’enjeu n’est pas seulement de favoriser la confiance, mais également de la mesurer. Nous travaillons à l’élaboration d’un cadre statistique devant permettre aux offices statistiques nationaux de disposer de mesures effectives et comparables de la confiance. Nous mettons actuellement à l’essai les techniques les plus pointues empruntées à l’économie expérimentale pour mieux comprendre ces indicateurs et en isoler les déterminants.
Il est temps de placer l’humain, l’éthique et la redistribution au centre de notre réflexion et de notre action. C’est à cette seule condition que nous rétablirons la confiance. Il n’y a pas de mystère. Il s’agit d’imaginer, de développer et de mettre en œuvre des politiques, des réglementations et des institutions efficaces. L’OCDE est déterminée à aider les pays dans cette voie et nous ne doutons pas que l’Académie s’associera à nous dans cette démarche, guidée ainsi que mise en garde par ces paroles d’Albert Camus: “l’intégrité n’a pas besoin de règles« .
Notes
[i] Taux de chômage de la zone OCDE, février 2017, http://www.oecd.org/std/labour-stats/OECD-HUR-02-17.pdf
[ii] OCDE, Taux de chômage harmonisés, février 2017.
[iii] All on Board: Making Inclusive Growth Happen, 2014, p17.
[iv] OCDE, Panorama de la société 2016.
[v] OCDE (2015) Panorama des administrations publiques 2015.
[vi] Panorama des administrations publiques 2015, p. 163.
[vii] Pew Research Center Survey.
Cette conférence a été organisée avec le soutien du Groupe Vinci

Conférence de Suzanne Berger, professeur de sciences politiques au M.I.T. (lundi 16 janvier 2017)
POPULISM AND THE FATE OF GLOBALIZATION
Le texte anglais est suivi d’une synthèse en français.
We are now in a world in which the political costs of globalization are escalating out of control. Against all expectations, we see victories of populist candidates and agendas in Europe and the United States that threaten to wipe out the centrist and social democratic politics of the postwar world. The victories of Brexit in England, of Donald Trump in the United States, the rise of AfD (Alternative for Germany), of Front National in France and Five Stars in Italy threaten to have many serious consequences for liberal democracies. Today—only 4 days before Donald Trump assumes power as president of the United States— I can hardly express to you the sense of apprehension and fear for liberal democratic values and for international peace and stability that is widely felt across our country.
Tonight I will focus on one among the many potentially disastrous outcomes of populism. That outcome would be a radical reversal of globalization and a closing up of national borders to flows of goods and services, of capital, and of people. I am going to start with two assumptions: first, that globalization can be significantly reversed. We have already seen this happen in the past with the end of the first globalization. When the first world war broke out, barriers went up everywhere. Globalization did not return to its 1914 level until 70 years later, in the 1980s. So first: despite the difference between the world economy of 1914 and that today, I do believe that globalization can be reversed. Secondly I will assume that most of us here today believe that globalization should not be reversed; that it is worth defending. Of course you challenge either of these assumptions, and I hope you will do so in the discussion. But for now I will proceed as if we have agreed on these two points and I will focus on laying out my views on two other points that I believe require much further consideration.
The first: why and how populism and anti-globalization have managed to win so much support? And the second: what we can do and what should we do about it
1- What is populism?
Populism can most usefully be defined as a form of political interaction “predicated on a moral vilification of elites and a concomitant veneration of the common people”[1]. What people mean by “the elite” today is understood expansively to include the rich, politicians, well-educated professionals, and globally-connected big business leaders. The populists’ supporters are disproportionately drawn from the losers of globalization, workers whose jobs have vanished because of outsourcing, offshoring, and imports, and from communities whose economies have collapsed along with their traditional manufacturing base. Populists appeal to older people in the population and to those with less education. Anti-immigrant campaigns and proposals are another powerful draw for populists, even in regions with few immigrants and refugees in the population. We are seeing the “double-movement” of backlash against global markets and against globalization’s rapid, radical disruption of social life that Karl Polanyi described in his great work, The Great Transformation—a book from 1944 translated into French only 8 years ago. The double-movement against markets seems once again at work producing authoritarian anti-liberal politics[2]. We are entering into a radically new and dangerous period.
The essential dynamic in today’s rage against the elite has been succinctly expressed in a single frame political cartoon that appeared first in Greece, then in France, and that now circulates widely on the Internet. Drawn by Panos Maragos, the cartoon shows three sheep looking at an electoral poster. The candidate is a wolf with a swastika armband. One sheep tells the others: “I think I’ll vote for the wolf. That will really show the shepherd.”
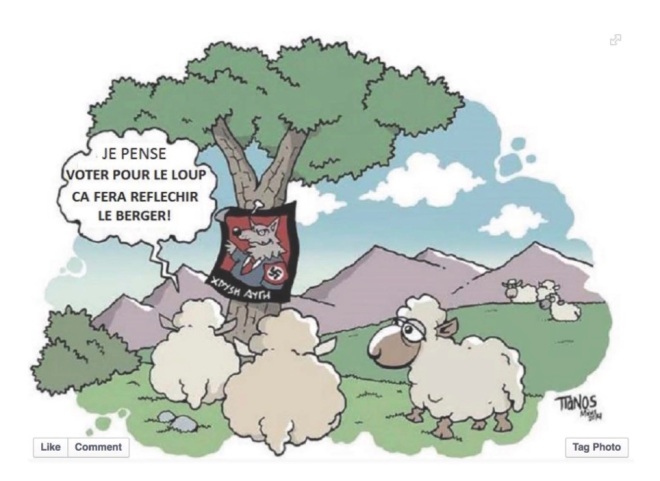
The point the cartoon makes is that populist politics is not a politics of interest representation. It’s the politics you get when interest representation has failed. It’s not that the sheep believes the wolf will act in the sheep’s interest. It’s that voting for the wolf gets back at the shepherd—even at the expense of the sheep’s eventual fate as dinner for the wolf.
2- Economic causes of populism
Today in the United States, as we try to understand how Donald Trump could have been elected president, we are likely to attribute the eruption of populist voting to economic or social or cultural characteristics of the voters. And these economic and social factors are undoubtedly a large part of the story. The unbelievable successes of Donald Trump and of Bernie Sanders in the Democratic primaries do clearly reflect the destructive impact of globalization on large segments of the population. Seventeen years ago the anti-globalization protests at Seattle against the WTO involved mostly marginal groups in the population, aside from some unions. Today in contrast, populist voters come from core groups across American society. The success of Trump (and of Sanders to some degree) in the primary elections was strongest in areas with large numbers of white male working class voters. They have good reason to be distressed. From the entry of China into the WTO in 2001 onward, the impact of imports from low-wage countries hit the U.S. manufacturing workforce. Economists who have studied the localities hardest hit by imports have concluded that about a fifth of the job losses between 2000 and 2007— so even before the financial crisis — were due to Chinese imports[3]. If laid-off workers found jobs at all, it was usually at lower wages and benefits at a Walmart, for example. In a break with past patterns, unemployed workers did not move to other parts of the country to try to find jobs. Moving is expensive and chancy and laid-off workers might not have been able to sell their now-underwater mortgaged houses. Many ended up out of the workforce on permanent disability rolls. Nationwide the income of white males without college degrees fell 20% between 1990 and 2013 and about 1/5 of these working-age men are permanently out of the workforce[4].
The last two decades have been ones in which income inequality has been growing rapidly. Although per capita GDP was 78% higher in 2015 than in 1979, the average household income of a family in the 20th percentile of the income distribution rose only by 6.9% over the period. The gains overwhelmingly went to those at the top of the income distribution. The pain of inequality and job loss affects not only those who directly lose jobs. It extends to many middle class groups in the same communities. It’s not only the Cleveland steelworker who lost his job who is up in arms; it’s the Cleveland Ohio pharmacist and Cleveland dentist and Cleveland lawyer all of whose businesses and houses declined in value as the community went down. So these middle-class voters are furious, too. This is not the American Dream. White middle class voters also overwhelmingly voted for Trump.
How did we get to this point without noticing what was happening to large groups in our society? Why did we not stop to consider what their reaction might be? Perhaps because our understanding of how globalization works has been shaped by standard economic trade theory: Ricardian theories of comparative advantage, Heckscher-Olin, Stolper-Samuelson. The heirs of that tradition today, like Paul Krugman, now plead innocent. They claim they always said there would be losers under globalization, but that the gains of globalization for the community at large would outweigh the losses. And somehow the gains would be used to compensate the losers. Those thrown out of jobs in one industry would be absorbed into jobs in other more promising sectors of the economy. Or else be compensated by government and the political system. So what would become of the losers was not part of the economics model. It was up to politicians and not the fault of economists or of globalization that a broken, polarized political system did not do its job. Government did not provide the kinds of new job training, education, and income supports that would allow the losers to get new jobs and re-integrate into healthy communities. If wage stagnation has led to a great new surge of inequality, there, too, the economists point the finger of blame to a broken political system which failed to use fiscal policy to protect those at the bottom or even those on middle rungs of the ladder.
One problem with this line of reasoning, though, is that it fails to push the explanation one step further back to analyze why government failed to act. The broken politics of the past decades can be understood as itself a product of globalization. Research by MIT economist David Autor and colleagues shows that in the zones in which Chinese imports had the largest impact on killing manufacturing jobs, the response of voters in subsequent elections was to choose more and more radical candidates[5]. In primary elections between 2002 and 2010 in these heavily hit districts Republican voters chose more and more radical Republicans and Democrats chose more and more radical Democrats; and thus the polarization of the political system proceeded and came to paralyze all action in Washington. Out of the Tea Party came the likes of Rand Paul, Ted Cruz, Mario Rubio and they prepared the terrain for the emergence of Donald Trump. Out of the impotence of polarized government grew the rage of the citizens against elites and politicians. And as an integral part of the populist reaction there was was a strong attack against globalization.
3 – Social and cultural causes of populism
Alongside these economic explanations of the rise of the populist electorate that attribute most of the blame to globalization, there has also been a return to an older tradition of cultural and psychological explanations of populism. Much of the work in this vein in the United States points to relatively stable cultural traits of segments of the population, like the Scotch-Irish Appalachian families depicted in the J.D. Vance autobiography, Hillbilly Elegy (2016) or the Louisiana people in Arlie Russell Hochschild’s Strangers in Their Own Land. Anger and Mourning on the American Right (2016)[6]. These subcultures typically accord high value to individualism, self-sufficiency, and personal honor and denigrate “dependency”– even when those espousing these values may themselves be regular recipients of government subsidies. Suspicion of foreigners, negative views of non-Caucasians, anti-intellectualism, and nationalism are other recurrent themes in these subcultures. These attitudes and values are not new, but they have been reactivated and leveraged into greater salience by the economic strains that globalization has imposed on these communities. These cultural identities have also been aroused by political shifts in national politics that make these communities feel even more marginalized and looked down on.
Among these political shifts, perhaps the most painful is the rise in social status of the very groups to whom poor whites once felt superior and the conviction that these groups are rising because of favoritism from national government. Arlie Russell Hochschild writes that it feels to poor whites in Louisiana as if they are in a long line leading towards the American Dream. They feel they are patiently waiting for economic improvement, while things seem to be getting worse not better. They believe that other people — blacks, women, immigrants, gays, refugees — are cutting ahead in line because they are being helped unfairly by special political dispensations. Even the government’s environmental policies seem determined to advance animals ahead of humans—so as Arlie Hochschild writes about the Louisiana people who went through the Deepwater Horizon oil spill they feel as if “unbelievably, standing ahead of[ them]in line is a brown pelican, fluttering its long, oil-drenched wings”[7].
4- Failures of representation
These economic and cultural explanations of populism are powerful and largely mutually complementary, but they also seem incomplete. The phenomenon we want to explain—the recent surge in populism—is a radical break, while the economic and cultural factors have been long in the making without producing anything that even began to look like an advanced anticipation of the Brexit and Trump victories. What has changed is that the grievances of these groups in the population used to find expression through unions and the Democratic Party. Liberal democracies become vulnerable to populist politics when parties of government and of opposition, unions, and interest groups fail to transmit the interests and grievances of significant groups in the population into political deliberation and policy making. Thirty-five per cent of American workers were unionized in the 1950s; by 2015 only 11.1% of all workers, and only 6.7% of private sector workers belonged to unions[8]. The anger over wages and working conditions and inequality that once was channeled by unions into collective action and strikes at the workplace now remains bottled up in desperate, angry individuals vulnerable to the appeals of demagoguery.
As for the Democratic Party–an institution which from the days of the New Deal on through the most prosperous years of the postwar world used to represent the interests of working class people—it now seems to many of these citizens to have been captured by the elites of Wall Street, the high tech industries, and the well-paid professional classes. The Democratic Party, which in the New Deal of Franklin Roosevelt and Harry Truman used to represent workers, has over the past three decades shed its commitments to lower and middle income groups[9]. It increasingly presents itself as the defender of the interests of rich and upper-middle class voters, highly educated professionals, and a diversity of ethnic and identity groups: Hispanics, African-Americans and gays. The outcome in the 2016 elections was a massive shift of white working class and white middle class voters who once were stalwarts of the Democratic electorate to voting for Donald Trump.
The atrophy of union and party channels for expressing the concerns of working class citizens is hardly a phenomenon restricted to the United States. In France the despair of lower and middle class citizens over the failures of both Right and Left governments has turned to rejection of the Left and Right parties of government[10]. A survey carried out at the end of 2013 reported that 69 percent of the respondents believed that democracy is working badly in France—up from 49 percent who gave this negative assessment only four years earlier[11]. An 11 December 2013 Ipsos/Le Monde survey found only 13 percent of the respondents expressing confidence that government could relaunch growth; indeed two-thirds of them thought growth would require limiting the role of the state as much as possible[12]. The public’s faith in the possibility of bringing about change through collective action is collapsing. Perhaps this might be considered a desirable development if one believed that the French had previously held unrealistically high expectations of politics and had now come to recognize, as the former Socialist prime minister Lionel Jospin once put it (impoliticly at the time): “l’Etat ne peut pas tout.” On the contrary, however, the frustration of citizens over their inability to use the channels of established parties for changing the state seems to be resulting in a search for alternative channels. The Front National seems to be reaping the harvest of this frustration. Perhaps, as mon maître Stanley Hoffmann argued about the Poujadists, the support for the Front National does not mean some whole-hearted popular adherence to the FN’s ideology—itself a shifting and unstable mix of old and new elements[13]. As Hoffmann presciently suggested in the 1950s, the support for the populists might evaporate if the political system were reformed and representation functioned better to channel the interests of the angry citizens. Indeed in 1958, the Poujadists did disappear in the new Fifth Republic. What would it take in France to defeat populism in 2017 ?
5- What should we do about globalization ?
Is it the case that globalization is responsible –wholly or in large part for the ills for which it has come under attack? Is globalization responsible for the loss of jobs and decline of wages for less- educated workers? It’s true that about 1/5 of job loss over the past 15 years can be attributed to trade. But surely technological change and automation explain a significant part of this outcome. Is globalization responsible for the enormous increase in inequality in advanced industrial countries ? Or is politics largely responsible for this outcome? Politics in this case would include tax policy, deregulation, changes in the welfare state. Is globalization responsible for the cultural gap between rural and small town communities and urban centers? Or are changes in values and in the media responsible? All of these are good questions for research and many of my colleagues in political science, economics, and sociology will be busy examining these issues for years to come. The fact is, though, that the public today does largely believe that globalization is to blame.
The populist response across the board has been to close up the borders. In the case of Brexit, this chiefly means withdrawal from the European Union and closing the frontiers to free entry of European Union citizens. What it will ultimately mean for Britain’s trade policies is not so clear. Trump’s proposals, in contrast, squarely promise trade protectionism. They range from threats against China to retaliate against currency manipulation, threats to levy high tariffs on goods imported by companies who have off shored some production, to Republican plans for a corporate tax reform (Destination-based cash flow tax with border adjustment) that would have heavy negative impact on importers, consumers and retail stores[14]. The countervailing effect here is supposed to be a major strengthening of the dollar—which would of course have huge impact on the global economy. Any of these trade threats if implemented would likely set off a trade war. The Chinese have already explicitly promised this. Here the negative consequences are unimaginable.
As for the movement of people across borders: there’s the famous wall that Trump threatens between the US and Mexico. Trump’s statements, or “tweets” change from day to day —most recently suggesting that we’ll pay for it, and the Mexicans will “owe us.” There are also the unconstitutional threats to restrict entry to the United States by Muslims. As for the flow of capital across borders—while Trump’s remarks during the campaign suggested the tightening up of financial regulation, his appointment of Goldman Sachs bankers to the key economic cabinet positions makes it seem very unlikely that the campaign threats against Wall St will come to pass.
Should we accept some part or all of these populist proposals to limit globalization as an acceptable price to pay for reducing the levels of populist rage? Obviously new trade agreements, like the Trans Pacific Partnership (TTP) and the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) are now out of the question for the foreseeable future. But beyond those new initiatives, I would be very reluctant to see any retreat on old trade commitments. First of all — I would argue that any level of trade protectionism sufficient to increase jobs in the U.S. would also be sufficient to produce huge consequences through retaliation and reprisals from other countries. It’s true that Trump by making specific threats against Carrier and Ford about leveling import taxes on their products made abroad was able to get them to rescind the off shoring of some of the jobs they had planned to move to Mexico. But this company by company approach just can’t work on any scale. I do not see Apple responding to Trump’s threats by bringing iPhone production to the U.S. The iPhone is assembled in plants with 100-200,000 workers in China. We have no such production sites in the U.S. Assembly is responsible for a very small fraction of the value of an iPhone. These jobs are bad jobs: and the Chinese workers in the Foxconn plants that produce for Apple rarely stay more than a year on the jobs. They would be very low wage bad jobs in the US and the demand for iPhones would decline as the price went up steeply .
Secondly, I think it would be mistaken patriotism to yield to the demands of a Trump on where to locate jobs. I think the principled position for business leaders is to resist these demands. The real ethical obligation for business leaders is to accept responsibility for nurturing the capabilities of the workforce and for building innovative resources in our society. We need to make our societies ones in which good jobs are created and good jobs stick. What does it mean to be sticky? I’ll give you a local example. Why do biotech and pharma companies keep opening new businesses in the mile and a half between MIT and Harvard? The rents are high. Wages are high. And as for taxes–Massachusets is otherwise known as Taxachusetts. But in this mile and half companies have access to the great research labs of Harvard and MIT and on a daily basis can track the progress of different technologies. They have access to a large labor pool of very well educated scientists and engineers. That’s why they feel they need to be here and those jobs stick there.
Let me make this point a different way: When I first came to France in the 1960s for my doctoral research on Breton peasants, the French I met often told me how different French farming was from American farming. In America, they said, you have so much land that farmers don’t think of maintaining and investing in the fertility of the soil. They just exploit it and exhaust it and move to new land. The result was vividly illustrated by something like the great Dust Bowl of the 1930s. In France, with limited land, even the peasant farmers devote enormous effort and precious resources to maintaining the fertility of the soil. That ethos of massive investment in maintaining and enhancing the resources that make our societies prosperous is one we need to bring into corporate culture today, both in France and in the United States. It means educating the workforce with skills that can be renewed over the course of a lifetime; it means investing in research capabilities that can produce not just a cute social media app that takes 2 or 3 years to get going as a start up but 10-15 year investments in developing new storage batteries or new materials or better solar cells. Our responsibility is to enhance the fertility of the soil.
Third, perhaps a more realistic approach to dealing with the impact of globalization on employment –and one that would not incite trade wars with our neighbors —would be to provide better compensation to the “losers” in globalization. There are many forms such compensation might take: wage insurance, real retraining, portable pensions, guaranteed health benefits. In fairness, I think we should do all this. But I do not believe that any kind of compensation we could devise for the losers would be sufficient. The losers are not just individuals, but whole communities. And all the evidence suggests that people don’t want pay-outs: they actually want jobs. What I see as most telling against the hope that better economic compensation for losers would lower the support for populists is the experience of countries like Denmark, Sweden and Germany. Those countries have done virtually everything we could imagine in the way of support for workers who lose jobs that were killed by international competition. They have excellent unemployment benefits; they provide excellent coaching and retraining for new jobs; they provide incentives to find new jobs—and still the populist parties are growing there. So yes: we need to do far better for the losers of globalization. We ought to make good on our old and never-honored commitments to use globalization as a lever to raise everyone’s well being. This will take massive expenditures on education and job retraining, rebuilding of our infrastructure, and also: flat-out compensation for lost incomes and benefits. But I don’t think it will be enough.
Finally, in conclusion, I turn with great personal reluctance to the main demand of the populists both in Europe and in the United States. It’s the demand to stop or to limit the flow of people — whether economic migrants or refugees — across borders. As we can see even in countries like Germany, Sweden and Denmark, where the economies have been doing well and where workers who lost jobs because of globalization were reasonably well compensated — even there, populist parties are flourishing because of fear and anger over immigration. Given the levels of anxiety, even hysteria, about the dangers that flood in as migrants and refugees come in over unprotected borders, I do believe that to contain populism we need to reinforce the national state on its frontiers. However reluctant we may be to lose the gains for individual freedom and for European integration that the Schengen regime represented, stronger controls at the border and controls that are national may be necessary.
The basic legitimacy of the national state has to do with protection of the citizenry within borders. In 1993, Philippe Séguin wrote: « L’idée des frontières est démodée? Il y a un dogme à attaquer. Revenir aux frontières est la condition de toute politique. »[15] When I read this in 1993 I thought this idea was rather extreme. And interestingly, M. Séguin must have come to think so too, because after I quoted him in an interview, he wrote to me in great indignation in 2006 to deny that he had ever written such a phrase. Which he had. But today I think we might consider his statement as a kind of harsh statement of the realities of what it will take to fight back populism. Drawing a distinction between refugees and migrants is difficult and somewhat artificial, since many of the migrants are seeking to leave countries in which poverty, ethnic hatreds, and violence will inevitably shorten their lives. But I do believe we need to use this distinction. We are morally obliged to admit and to try assist the refugees. But I think that to save our own liberal democratic polities, we need to turn back many of the migrants. Slowing the entry of migrants into our countries is really only a stop gap measure, though perhaps a necessary one. Protecting globalization means not only ultimately defeating the policies and the threats of President Trump. It will take moving beyond our broken, polarized politics and the paralysis at the center to a federal government capable of massive new initiatives in economy and society. The real solutions lie in tackling the failures of representation and the failures of hope for the future for themselves and their children that have led so many of our fellow citizens to vote for the wolf against the shepherd.
Bibliography
- Autor, David, David Dorn, and Gordon H. Hanson. The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States. Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research, 2012.
- Cramer, Katherine J. The Politics of Resentment. Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker. Chicago: University of Chicago Press, 2016.
- Frank, Thomas. Listen Liberal: Or Whatever Happened to the Party of the People. New York: Metropolitan Books, 2016.
- Mueller, Jan-Werner. Qu’est-Ce Que Le Populisme? Translated by Frédéric Joly. Clermond-Ferrand: Premier Parallèle, 2016.
- Séguin, Philippe. Ce Que J’ai Dit. Paris: Grasset, 1993.
Notes
[1] Bart Bonikowski and Noam Gidron, “The Populist Style in American Politics: Presidential Campaign Discourse, 1952-1996,” Social Forces 94 (2016): 4, accessed July 19, 2016, doi: 10.1093/sf/sov12; 4
[2] Karl Polanyi, The Great Transformation (Boston : Beacon Press, 1944).
[3] David Autor, David Dorn, and Gordon H. Hanson, The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States (Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research, 2012).
[4] Brookings Institution research cited in William B. Bonvillian, “Donald Trump’s Voters and the Decline of American Manufacturing,” Issues in Science and Technology, Summer 2016, p. 27.
[5] David Autor, David Dorn, Gordon Hanson, and Kaveh Majlesi, “Importing Political Polarization? The Electoral Consequences of Rising Trade Exposure,” (working paper number 22637, National Bureau of Economic Research, 2016).
[6] J.D. Vance Hillbilly Elegy (New York: Harper Collins, 2016). Hochschild, Arlie Russell, Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right (New York: The New Press, 2016). Katherine J. Cramer, The Politics of Resentment. Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker (Chicago: University of Chicago Press, 2016).
[7] Hochschild, Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right, p. 138.
[8] Bureau of Labor Statistics, “Union Members 2015“ http://www.bls.gov/news.release/pdf/union2.pdf (accessed December 10, 2016). See also Neil Gross, “The Decline of Unions and the Rise of Trump,” New York Times August 12, 2016. http://nyti.ms/2bc7a1U
[9] See this theme developed in Thomas Frank, Listen Liberal: or Whatever Happened to the Party of the People (New York: Metropolitan Books, 2016).
[10] I have analyzed the current French situation in “La Grande Désillusion,” in Jean-François Sirinelli, ed., La France qui vient (CNRS Editions, 2014).
[11] Thomas Wieder, “Les Français s’enfoncent dans la ‘dépression collective,’” http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protégé/20130114/html/946498.html. The “barometer de la confiance politique” was a study conducted for the Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) and the Conseil économique, social, et environnemental. The survey was conducted 25 novembre-12 décembre 2013.
[12] Philippe Escande, “Relance de la croissance: les Français ne comptent plus sur l’Etat,” Le Monde.fr. 11.12.2013.
[13] Grégoire Kauffmann, Le Nouveau FN (Paris: La République des idées, Seuil, 2016).
[14] Neil Irwin, “The Major Potential Impact of a Corporate Tax Overhaul,” http://nyti.ms/2jeVcVI (accessed January 7, 2017).
[15] Philippe Séguin, Ce que j’ai dit (Paris: Grasset, 1993). p. 39.
Le populisme et le destin de la mondialisation
Synthèse en français
Introduction
Les coûts politiques de la mondialisation sont devenus incontrôlables. Les victoires – contre tout pronostic – et la progression de candidats populistes en Europe et aux États-Unis (Brexit, D. Trump, AfD en Allemagne, Front national en France ou Cinque Stelle en Italie), ainsi que la promotion de leurs agendas, menace d’anéantir les politiques centristes et sociales-démocrates mises en place après la Seconde Guerre mondiale. À quatre jours de l’investiture de Donald Trump, Suzanne Berger se fait entre autres l’écho des peurs et des craintes ressenties dans son pays pour les valeurs de la démocratie libérale et pour la paix et la stabilité internationales.
Le propos de la conférence entend se concentrer sur une des nombreuses conséquences potentiellement désastreuses du populisme, à savoir la régression du phénomène de mondialisation et la fermeture des frontières aux flux de biens et de services, de capitaux et de populations. S. Berger formule deux hypothèses en préambule.
La première est la possibilité d’un retour en arrière dans la mondialisation, dont elle ajoute qu’elle s’est déjà produite dans le passé à l’occasion de la Première Guerre mondiale, qui a sonné la fin de la première mondialisation. Il a fallu attendre les années 1980 pour retrouver un degré de mondialisation comparable à celui d’avant 1914.
La seconde est que la majorité des personnes réunies ce soir partagent sa conviction que la mondialisation doit se poursuivre.
Tout en appelant à des discussions sur ces hypothèses lors des débats, elle propose pour l’heure de les tenir pour acquises et de se consacrer à répondre aux deux questions suivantes : pourquoi et comment le populisme et les courants antimondialistes sont-ils parvenus à susciter autant d’adhésions ? Et que pouvons-nous et devons-nous faire à ce propos ?
1– Qu’est-ce que le populisme ?
Le populisme peut être défini comme une forme d’interaction politique qui repose sur la condamnation morale des élites et la célébration des milieux populaires, étant entendu que le terme « élites » est compris de manière extensive, regroupant les « riches », la classe politique, les professions intellectuelles et les dirigeants des grandes entreprises mondialisées. Les populistes se recrutent massivement parmi les perdants de la mondialisation, tels les travailleurs dont les emplois ont disparu à cause des délocalisations et des importations, et dans des sociétés dont l’économie s’est effondrée en même temps que leur base manufacturière. Le populisme séduit les plus âgés et ceux qui ont un faible niveau d’études. Les campagnes et argumentaires anti-immigration sont un autre facteur d’attraction pour les populistes, même dans des régions dans lesquelles immigrés et réfugiés sont peu nombreux. On assiste à un phénomène de réaction hostile au marché mondial et aux bouleversements rapides et radicaux que la mondialisation fait subir à la vie sociale, tels que les a décrits Karl Polanyi en 1944 dans The Great Transformation (La Grande Transformation). Cette double réaction paraît de nouveau à l’œuvre à travers des politiques autoritaires et antilibérales. Nous entrons dans une période radicalement nouvelle et dangereuse.
Berger illustre son propos par un dessin de presse de Panos Maragos : trois moutons regardent une affiche électorale représentant un loup dont le brassard s’orne d’une croix gammée ; l’un d’eux déclare : « Je pense voter pour le loup, ça fera réfléchir le berger. »
Selon elle, ce dessin montre en quoi le populisme n’est pas une politique de représentation des intérêts, mais la politique qui se fait quand les intérêts ne sont plus représentés. Le mouton ne croit pas que le loup agira selon ses intérêts, mais il agit en réaction contre le berger, au risque de servir de repas au loup.
2 – Les causes économiques du populisme
On a relié la victoire de Donald Trump aux caractéristiques économiques, sociales ou culturelles de ses électeurs. Il est incontestable que les facteurs sociaux et économiques jouent un rôle important dans cette histoire. Les incroyables succès de Trump ou de Bernie Sanders sont un reflet non équivoque de l’impact destructeur de la mondialisation sur de larges parts de la population. Alors que les manifestations contre l’OMC à Seattle en 1999 impliquaient pour l’essentiel des groupes marginaux (et quelques syndicats), les électeurs populistes viennent aujourd’hui du cœur de la population américaine. Les succès les plus importants de Trump et de Sanders ont été enregistrés dans des territoires peuplés d’hommes blancs des classes populaires. Depuis l’entrée de la Chine dans l’OMC en 2001, les importations des pays à faibles salaires ont porté un coup à la main-d’œuvre industrielle américaine. Entre 2000 et 2007, soit avant même le début de la crise, les importations chinoises ont coûté un cinquième de leurs emplois aux régions les plus touchées. Ceux qui ont retrouvé un emploi sont payés moins chers dans la grande distribution. On constate par ailleurs, ce qui est nouveau, une moindre mobilité des chômeurs, car déménager coûte cher et ils n’arrivent pas à vendre leurs maisons hypothéquées. Les hommes blancs sans diplômes ont perdu 20 % de leurs revenus entre 1990 et 2013 et un cinquième de ces hommes est sorti de la population active.
Les deux dernières décennies ont aussi vu la montée des inégalités. Le PIB par tête a augmenté de 78 % entre 1979 et 2015, mais cette augmentation a surtout bénéficié aux plus riches. De plus le chômage des couches populaires a des répercussions sur les classes moyennes qui perdent leurs clients. Dans les communautés sinistrées par la désindustrialisation, elles aussi ont voté massivement pour Trump.
Pour S. Berger, si les élites ne se sont pas rendu compte de ces phénomènes, c’est que la compréhension des mécanismes de la mondialisation est façonnée par les grands classiques de l’économie comme les théories de Ricardo sur l’avantage comparatif, le modèle Heckscher-Ohlin et le théorème Stolper-Samuelson. Leurs héritiers, tel Paul Krugman, affirment que les gains de la mondialisation auraient dû en compenser les pertes et qu’il y aurait dû y avoir des transferts d’emplois ; ils rejettent par conséquent la faute sur les politiques qui n’auraient pas donné les moyens aux chômeurs de se réorienter. S. Berger décèle toutefois une faille dans ce raisonnement, qui ne remonte pas aux sources de l’échec du système politique, qui est aussi une conséquence de la mondialisation. Elle cite les recherches de David Autor qui montre une radicalisation des votes dans les territoires industriels menacés par les importations. Cette radicalisation a contribué à une polarisation du système politique et a entravé l’action du gouvernement de Washington, ce qui a accru la colère contre les élites gouvernantes. Voter populiste est un moyen d’attaquer la mondialisation.
3– Causes sociales et culturelles
Parallèlement au facteur économique, on note aussi le retour d’une analyse du populisme selon des schémas culturels et psychologiques, avec la mise en évidence de sous-cultures valorisant l’individualisme, l’autosuffisance ou l’honneur personnel et dénigrant l’assistanat (ce qui n’exclut pas de toucher des allocutions). La xénophobie, l’hostilité envers les non-Blancs, l’anti-intellectualisme ou le nationalisme sont d’autres thèmes à l’honneur dans ces milieux. La mondialisation a rendu de la vigueur à ces identités culturelles, tout comme le sentiment de marginalisation au sein de la communauté politique nationale.
Cette impression d’être en décalage par rapport au reste de la société est d’autant plus amèrement ressentie par les « petits Blancs » qu’ils constatent la promotion sociale de groupes auxquels ils se sentaient jusque-là supérieur (S. Berger s’appuie notamment sur les travaux d’Arlie Russell Hochschild sur la Louisiane). Leur sentiment est que les pouvoirs publics favorisent les minorités (Noirs, femmes, homosexuels, immigrés, et même animaux dans le cadre des politiques environnementales) à leur détriment.
4– Échecs dans la représentation
À côté des facteurs économiques et culturels, qui s’inscrivent dans le long terme, il convient cependant de faire place à une autre explication, plus apte à rendre compte du surgissement récent du populisme, rien n’ayant permis d’anticiper le Brexit ou la victoire de D. Trump. Pour S. Berger, ce qui a changé c’est que jusque-là les groupes sociaux qui se jugeaient délaissés exprimaient leurs doléances au travers les syndicats ou le Parti démocrate. Les démocraties libérales deviennent vulnérables aux populismes lorsqu’elles ne sont plus capables de traduire les doléances de composantes significatives de la population en action politique. Elle donne en exemple le très faible taux de syndicalisation (11,1 % en 2015 aux États-Unis) et le recul de la foi en l’action collective. Le Parti démocrate, porte-voix des classes laborieuses au temps du New Deal, est perçu par elles désormais comme le parti des élites aisées. Lui-même se présente d’ailleurs comme le défenseur des intérêts des classes moyennes et supérieures diplômées et des minorités (Hispaniques, Afro-américains, homosexuels). Le résultat est le vote des classes moyennes et populaires blanches, autrefois noyau de l’électorat démocrate, en faveur de Trump.
Le phénomène n’est pas propre aux États-Unis. En France, le rejet de la droite et de la gauche de gouvernement (d’après un sondage de 2013, 69 % des Français jugent que la démocratie ne fonctionne pas bien en France) est alimenté par le sentiment d’impuissance des pouvoirs publics en matière économique, dans un pays qui attend traditionnellement beaucoup de l’État. Les citoyens recherchent d’autres canaux pour faire entendre leur point de vue, comme le Front national. Reprenant les analyses de Stanley Hoffmann sur les poujadistes, S. Berger estime que le vote du Front national ne vaut pas adhésion à son programme (d’ailleurs hétéroclite) et qu’il disparaitrait si les intérêts des citoyens en colère étaient mieux représentés.
5– Que devrions-nous faire de la mondialisation ?
Berger se demande dans quelle mesure la mondialisation peut-elle être tenue pour responsable de la situation actuelle, d’un point de vue économique, social et culturel. Si un cinquième des disparitions d’emplois est sans doute dû au commerce, il convient aussi de faire une part aux progrès technologiques et à l’automatisation, tout comme les politiques économiques, fiscales et sociales des gouvernements jouent un rôle dans l’accroissement des inégalités au sein des pays développés. Quant au fossé culturel qui se creuse entre les villes et les périphéries, peut-être l’évolution du système des valeurs et des médias n’y est-elle pas non plus étrangère. Le fait est pourtant qu’une large partie de l’opinion publique en rend responsable la mondialisation.
La réponse populiste est de fermer les frontières, comme le montre le Brexit (même si les conséquences en matière de politique commerciale sont encore floues) ou la politique protectionniste annoncée par D. Trump qui pourrait amener à une guerre commerciale avec la Chine, avec des conséquences sur les consommateurs américains et sur le cours du dollar, avec à la clé des répercussions mondiales. Le mur avec le Mexique ou la menace d’interdire l’entrée de musulmans sur le sol américain vont dans le même sens, avec des incertitudes toutefois. On peut douter ainsi de l’exécution des menaces prononcées contre Wall Street lors de la campagne au vu de la nomination de banquiers de Goldman Sachs dans l’équipe du président élu.
Faut-il reprendre à son compte tout ou partie de ces propositions pour apaiser les colères populistes ? S. Berger juge compromis l’avenir des négociations en cours (Accord de partenariat transpacifique, Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement) mais est hostile à ce qu’on revienne sur les accords passés. Elle croit que les menaces de D. Trump sur les entreprises qui délocalisent, ponctuellement suivies d’effet, ne sauraient constituer une stratégie globale. Elles entraîneront des représailles et ne sont tout simplement pas exécutables. Une relocalisation complète aurait pour seule conséquence de créer des emplois à faible salaire.
Dans ce sens, elle fait un devoir éthique aux chefs d’entreprise de résister à ces pressions, au nom d’un patriotisme bien compris. L’obligation morale des chefs d’entreprise, c’est plutôt de contribuer à la reproduction et au renforcement des ressources nationales qui rendent possible la réussite de l’entreprise, donc la formation et l’investissement dans la recherche. Il faudrait créer de bons « jobs » qui resteront au pays parce qu’ils ont besoin d’y être, comme le biotech entre MIT et Harvard. S. Berger illustre son propos par une comparaison agronomique tirée de ses échanges avec des paysans bretons : en France, la relative rareté de la terre a contraint les agriculteurs à déployer des moyens importants pour conserver la fertilité des sols. À leur exemple, les sociétés française et américaine doivent investir dans leurs ressources futures : cela passe par la formation de la main-d’œuvre tout au long de la vie active ou des investissements de longue durée dans des produits innovants (tels les nouveaux matériaux).
Une approche réaliste des conséquences de la mondialisation serait d’accorder des compensations à ses perdants, des compensations non seulement individuelles sous forme d’assurances et de garanties, mais aussi collectives, s’appliquant aux milieux et communautés les plus touchés. S. Berger soulève cependant le contre-exemple du Danemark, de la Suède et de l’Allemagne, où la situation de l’emploi est dynamique, mais où les partis populistes progressent malgré tout. Elle appelle, certes, à appliquer des politiques généreuses et inventives vis-à-vis des perdants de la mondialisation, mais ne croit pas que cela suffise.
Elle conclut en reprenant, non sans réticence, la principale revendication populiste des deux côtés de l’Atlantique : arrêter ou limiter les flux migratoires, ce qui est précisément la raison de l’essor des partis populistes au Danemark, en Suède et en Allemagne. Étant donné l’état d’esprit des populations, S. Berger croit nécessaire de restaurer des frontières fortes pour les États nationaux, malgré les conséquences en termes de liberté de circulation. La légitimité de l’État national a partie liée avec la protection de ses citoyens à l’intérieur de ses frontières, ajoute-t-elle en citant Philippe Seguin à l’appui de son propos. Aussi artificielle soit la distinction entre réfugiés et migrants, les premiers doivent être accueillis, les seconds limités et régulés pour sauver les démocraties libérales. Pour sauvegarder la mondialisation, il ne suffira pas de faire échouer les politiques du Président Trump. Il faudra pour cela substituer à un système politique polarisé et paralysé en son centre un authentique gouvernement fédéral capable de prendre de nombreuses initiatives en matière économique et sociale. La véritable solution est de s’attaquer aux échecs dans la représentation des intérêts et restaurer l’espoir dans leur avenir chez tous ceux qui ont voté pour le loup par dépit envers le berger.
Cette conférence a été organisée avec le soutien de la Compagnie de Saint-Gobain

Conférence du cardinal Philippe Barbarin (lundi 15 décembre 2016)
Économie : Liberté, égalité, fraternité.
Dans ce monde dominé par l’économie, on entend continuellement parler du taux de croissance, des parts de marché, de la première puissance économique mondiale, du G 8, du G 20… Et vous, vous m’invitez à rapprocher ces critères majeurs et parfois uniques d’évaluation de nos sociétés, des trois mots de notre devise républicaine. Exercice intéressant !
Le 30 novembre dernier, j’ai eu la joie de vivre en compagnie de mes frères évêques de Rhône-Alpes et de deux cent soixante élus de nos départements une rencontre avec le Saint Père dans la salle Clémentine, au Vatican. Dans son allocution, le Pape François parlait ainsi aux élus de notre Province : « Que les valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité ne soient pas seulement brandies de manière incantatoire, mais soient approfondies et comprises en référence à leur vrai fondement, qui est transcendant. »
Quel est ce « vrai fondement » ? Où et comment le trouver ? Qu’est-ce que la transcendance ? En quoi est-elle nécessaire ? Ces questions ont nourri nos échanges après cette audience mémorable. Je pensais à la phrase de Heidegger : « L’homme dépourvu de transcendance erre sans but sur la terre dévastée. » Me revenait surtout à l’esprit la lecture de l’ouvrage simple et si profond d’un membre de votre Académie, le Professeur Rémi Brague, Les ancres dans le ciel. En conclusion, citant Le Timée de Platon et Rivarol, il risque : « Pour tout homme les ancres sont dans le ciel. C’est en haut qu’il faut chercher ce qui sauve du naufrage » (1).
« Economie : liberté, égalité, fraternité », vous me pardonnerez de ne pas avoir choisi d’autre plan que celui d’écouter successivement chacun de ces quatre mots, la beauté de leur contenu, les dangers qu’ils comportent et les dérives auxquelles ils donnent lieu. L’objectif de vos travaux est justement de voir comment ils peuvent et doivent s’harmoniser, ce qui est un enjeu majeur pour le bien commun de nos sociétés.
I.- ECONOMIE
En grec, ce mot ne signifie pas production ou acquisition de biens, mais plutôt répartition, dispensation. On le trouve dans la Bible. Evoquant la surabondance de l’amour de Dieu, saint Paul parle d’« économie du mystère » (Ep 3, 9) pour expliquer comment Dieu a dispensé son amour, comment il a décidé de partager avec les hommes ce torrent de bonté, de miséricorde.
En ce premier sens, donc, le mot économie désigne la façon dont un Etat choisit de répartir les biens dont il dispose. Ce sont ses choix budgétaires : quelle part reviendra à l’éducation, à la santé, à la défense, aux relations extérieures, aux transports, à la culture… Cela suppose un regard politique équilibré sur la vie de notre société, sur les besoins de chacun. Et le critère majeur doit être celui du bien commun. On sait l’importance du Ministère du budget et la difficulté des arbitrages à rendre. Le vote du budget au Parlement est, chaque année, un moment essentiel pour l’ensemble de la nation.
L’un des membres de votre Académie, Jean Tirole, a publié récemment un ouvrage magistral dans ce domaine, Economie du bien commun (2). Mais pour lui, comme pour tout le monde, économie prend un sens beaucoup plus large, celui du langage courant.
Chez les grecs, Aristote par exemple, l’autre volet de ce que nous appelons aujourd’hui « l’Economie », à savoir la production de richesses, la vente et l’acquisition des biens, les affaires, tout cet ensemble était rendu par le mot « chrématistique ». Il évoque tout ce qui est nécessaire, utile et profitable, tout ce qui contribuera à la prospérité d’un pays. Produire des richesses est une mission très honorable. On peut féliciter celui qui réussit ce qu’il entreprend. J’aime entendre les Juifs adresser des vœux à celui qui se lance dans une belle aventure professionnelle, si importante pour le bien-être de tous. Je ne sais pas si les catholiques savent dire de la même manière : « Je vous souhaite plein de succès dans vos entreprises. »
Entreprendre est un mot magnifique. On y entend le fait de prendre à pleines mains, à bras le corps, un projet audacieux. On sent l’intelligence, l’audace et l’énergie qu’il faut pour concevoir un projet, pour convaincre des partenaires et des collaborateurs de s’y associer, et pour le mener à bien. Dans l’encyclique Centesimus annus, Jean-Paul II fait l’éloge de l’entrepreneur, de sa capacité d’initiative ; il évoque les risques personnels qu’il prend souvent pour le bien d’autrui et de la société en offrant de nouveaux emplois. Cette encyclique marque une étape importante dans l’enseignement social de l’Eglise. Elle s’appuie sur celle du Pape Léon XIII, Rerum novarum, publiée en 1891. Oui, des res novae étaient apparues au XIXème siècle, avec l’essor de l’ère industrielle. Des questions nouvelles se posaient à propos de la condition ouvrière, et elles méritaient que l’Eglise les éclaire à partir de la Révélation chrétienne.
Comme la situation économique évolue sans cesse – que l’on pense, par exemple, à la crise bancaire de 2007-2008 qui a remis en cause tout l’équilibre de l’économie mondiale -, de nouvelles questions se posent régulièrement. C’est ainsi que les papes ont publié des encycliques ou d’autres textes majeurs pour préciser certains points de la doctrine sociale de l’Eglise, en fonction de l’évolution de l’économie mondiale (3).
Dans l’encyclique du Centenaire, Jean-Paul II demande que l’on garantisse la liberté d’entreprendre et refuse que l’on diabolise a priori la croissance économique. Au paragraphe 35, il écrit : « L’Eglise reconnaît le rôle pertinent du profit comme indicateur du bon fonctionnement de l’entreprise. Cela signifie que les facteurs productifs ont été dûment utilisés et les besoins humains convenablement satisfaits. » « Cependant, poursuit-il, le profit n’est pas le seul indicateur de l’état de l’entreprise. Il se peut que les comptes soient bons et qu’en même temps les hommes qui constituent le patrimoine le plus précieux de l’entreprise soient humiliés et offensés dans leur dignité.»
Plus loin, au paragraphe 42, il constate qu’après l’échec du communisme, le capitalisme triomphe. Mais il ne veut pas s’en tenir à cet argument simpliste. Oui, on peut « reconnaître le rôle positif de l’entreprise, du marché, de la propriété privée et de la responsabilité qu’elle implique, de la libre créativité humaine dans le secteur économique ». Dans ce texte, il déclare préférer les expressions « économie d’entreprise », « économie de marché » ou « économie libre » au mot capitalisme, qui semble tout centrer sur le capital. Mais le Pape signale aussi qu’à défaut d’un encadrement juridique ferme qui mette la liberté d’entreprendre « au service de la liberté humaine intégrale », la porte est ouverte à tous les dangers…
II.- LIBERTÉ
Certains affirment que les « racines chrétiennes », son anthropologie expliquent le développement de l’économie moderne et du capitalisme dans les pays occidentaux, dès le Moyen-Age et la Renaissance. D’aucuns insistent même sur le rôle spécifique du catholicisme, nuançant ainsi la thèse classique de Max Weber qui voyait en l’éthique protestante le terreau ayant permis la croissance du capitalisme. Je pense ici aux travaux de Pierre de Lauzun, comme Christianisme et croissance économique (4).
1- Qu’est-ce que la liberté ?
Mais commençons par donner quelques éléments de réponse à cette question fondamentale, et à quelques autres immédiatement connexes : Quelles sont les conditions de la liberté ? Comment devenir vraiment libre soi-même ? Comment donner à un enfant, à un jeune toutes ses chances pour devenir un homme ou une femme libre ?
Est libre celui que l’on sent en pleine possession de ses moyens, qui ne craint pas de se lancer dans une aventure audacieuse, après avoir réfléchi et mûri son projet. On fait confiance à quelqu’un que l’on sent libre, parce que c’est « un homme de parole » ou une personne intègre. Alentour, on sait cela, on le sent. On fait attention à celui que l’on choisit comme trésorier dans une association. Parfois, on entend dire : « Si c’est lui qui t’a dit cela, tu peux être tranquille : c’est vrai (ou il le fera…) » ou au contraire : « Ah oui ! il t’a dit cela, mais hier, il disait le contraire et demain ce sera encore autre chose… Il ment comme il respire. »
Je voudrais m’arrêter un moment sur ce que l’on appelle les commandements dans la Torah, mot qui désigne une « instruction » donnée à l’homme sur le mystère de sa vie, avant d’être une « loi ». La loi et les commandements ont tôt fait d’être abaissés au niveau des règlements, alors qu’il s’agit plutôt de « paroles de vie ». Je les perçois comme des indications, des repères majeurs donnés à l’homme pour garantir sa dignité et sa liberté. Il me semble essentiel de voir que ces « dix paroles de vie » sont dans l’ordre. Les trois premières mettent « les ancres dans le ciel ». Mon père nous disait toujours – c’est un peu moins poétique que l’image des ancres ! – : « Il faut pendre les casseroles par en haut… ». Les suivantes indiquent les impasses en abordant chacun des domaines majeurs. D’abord la vie, bien sûr : « Tu ne tueras pas.» Jésus nous invite à aller en amont, à discerner la violence qui vient, qui monte du fond de nos cœurs : « Si tu dis à ton frère crétin,… renégat » (Mt 5, 22). Puis, dans la vie, tout le monde sait que l’essentiel, c’est l’amour. Il est à la fois merveilleux et fragile. C’est trop facile et souvent irréparable de le briser : « Tu ne commettras pas l’adultère.» Ensuite, viennent les biens dont on peut dire qu’ils font corps avec nous. Parfois, j’ai entendu des personnes, cambriolées en pleine nuit, dire qu’elles avaient eu l’impression d’avoir été violées : « Tu ne voleras pas. » Puis la qualité de notre relation aux autres est conditionnée par la parole : « Tu ne mentiras pas. » Sinon, tout le monde se méfiera de toi dès que tu ouvriras la bouche.
A vrai dire, l’une des dernières consignes que Jésus laisse à ses disciples pour garantir leur liberté, c’est la méfiance… mais d’eux-mêmes. « Méfiez-vous, de peur que votre cœur ne s’alourdisse. » De telles paroles nous préparent à l’ultime rendez-vous : « Afin d’avoir la force (…) de vous tenir debout devant le Fils de l’homme » (Lc 21, 34-36). Elles correspondent aux deux derniers commandements (« Tu ne convoiteras pas… ») qui nous rappellent que souvent notre cœur est biaisé, malade, rongé par la jalousie.
2- Illusions ou perversions de la liberté.
Ces dérives sont bien mises en lumière dans l’Evangile. La parabole de l’enfant prodigue dénonce cette illusion de liberté imaginée par un jeune qui réclame à son père la part de ses biens pour quitter la maison et trouver enfin la liberté ! L’histoire de la chèvre de M. Seguin (qu’on me pardonne de la mettre en parallèle avec la Parole de Dieu !) n’avait guère pour but que de faire peur aux jeunes filles en les avertissant que de méchants loups les attendaient si elles quittaient la maison en cachette. La parabole montre qu’il est difficile d’être vraiment libre. Le fils prodigue, décidé à prendre sa liberté, entre dans un esclavage imprévu, et le fils aîné travailleur, apparemment docile et fidèle, n’a pas trouvé le chemin de sa liberté intérieure. Qu’est-ce donc que cette prétendue liberté qui aboutit finalement à l’esclavage, la dégradation complète d’un être ou même à sa mort ? Une certaine liberté économique peut aussi avoir des effets ravageurs sur l’équilibre social.
Il ne suffit certes pas d’invoquer le principe de la liberté, comme on répète un slogan, pour se garder des dérives et des perversions auxquelles il peut donner lieu. Liberté d’entreprendre, oui, mais parfois la montée tragique de l’ego d’un grand patron ou d’un homme de pouvoir peut avoir des effets ravageurs sur autrui, comme l’hybris d’un homme politique peut blesser un peuple tout entier quand, par exemple, le roi se prend pour le soleil.
Les avertissements de Jésus sur les méfaits dont l’argent peut devenir la source sont nombreux. J’en relèverai deux, aux chapitres 12 et 16 de l’Evangile selon saint Luc. Quand l’argent devient la préoccupation principale, quand il devient le centre de nos vies, il risque de nous rendre fous. On connaît ce passage où un homme pensait avoir bien réfléchi et pris de bonnes dispositions pour la conservation de ses biens. Il se croyait à l’abri de tout souci et se disait à lui-même : « Repose-toi, mange, bois, fais la fête… », alors qu’il avait perdu de vue l’essentiel : « Insensé, cette nuit même, on va te demander ton âme… » (Lc 12, 19-20). L’argent peut aussi rendre aveugle. Le pauvre Lazare vivait près du portail d’un homme riche dont l’Evangile ne précise pas le nom. Rien ne nous dit que ce riche était malhonnête. Simplement, il « se revêtait de pourpre et de lin fin, et faisait chaque jour brillante chère ». On comprend sans difficulté que, tellement pris par ses affaires, il n’avait même pas vu le pauvre gisant à sa porte, tout couvert d’ulcères (Lc 16, 19-31) !
J’aimerais regarder de près devant vous le verset célèbre dans lequel Jésus souligne : «Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent » (Mt 6, 24). Il ne s’agit pas d’un simple parallèle où il faudrait choisir d’aimer l’un ou l’autre. Les mots et leur ordre sont précis. « L’un » désigne Dieu et « l’autre » l’argent. Et voilà comment j’interprète ce verset : celui qui aime l’argent finit par haïr Dieu, tandis que celui qui est vraiment « attaché » à Dieu laisse l’argent à sa juste place. Un cadre d’une grande banque française me racontait, un jour, qu’à la fin d’une concertation en équipe sur une affaire qui avait fait perdre beaucoup d’argent à la banque, il avait dit : « Bon, ce n’était que de l’argent ! ». Parole déplacée dans un temple de l’argent ? Un de ses collaborateurs lui avait aussitôt demandé : « Que voulez-vous dire, Monsieur le Directeur ? » Et sa réponse fut : « Vous voulez savoir ce que je veux dire ? Eh bien, c’est simple ! Je veux dire que perdre autant d’argent, cela me fait moins d’effet que si l’on venait m’annoncer qu’on avait trouvé un cancer à ma fille de 15 ans ! »
3- Apporter un discernement sur économie et liberté.
Jean-Paul II parle de « perversion de la liberté lorsqu’elle devient un absolu ». Dans Centesimus Annus, 41, il avertit : « L’expérience historique de l’Occident, de son côté, montre que, même si l’analyse marxiste de l’aliénation et ses fondements sont faux, l’aliénation avec la perte du sens authentique de l’existence est également une réalité dans les sociétés occidentales. » Au paragraphe suivant déjà cité (42), il s’interroge sur la nature de notre système économique :
« Peut-on dire que, après l’échec du communisme, le capitalisme est le système social qui l’emporte et que c’est vers lui que s’orientent les efforts des pays qui cherchent à reconstruire leur économie et leur société ? Est-ce ce modèle qu’il faut proposer aux pays du Tiers-Monde qui cherchent la voie du vrai progrès de leur économie et de leur société civile?
La réponse est évidemment complexe. Si, sous le nom de ‘’capitalisme’’, on désigne un système économique qui reconnaît le rôle fondamental et positif de l’entreprise, du marché, de la propriété privée et de la responsabilité qu’elle implique dans les moyens de production, de la libre créativité humaine dans le secteur économique, la réponse est sûrement positive, même s’il serait peut-être plus approprié de parler d’ ‘’ économie d’entreprise’’, ou d’ ‘’économie de marché’’, ou simplement d’ ‘’économie libre’’. Mais si par ‘’capitalisme’’, on entend un système où la liberté dans le domaine économique n’est pas encadrée par un contexte juridique ferme qui la met au service de la liberté humaine intégrale et la considère comme une dimension particulière de cette dernière, dont l’axe est d’ordre éthique et religieux, alors la réponse est nettement négative. »
Pour les professionnels de l’économie, cela se traduit par la question de la régulation ou réglementation. C’est un thème prépondérant dans les activités financières qui, depuis la crise de 2007, connaissent une prolifération de réglementations. On en est au point où on peut se demander si cet arsenal réglementaire ne devient pas contre-productif. Les Papes Benoit XVI et François font référence au besoin de réglementation et d’encadrement des marchés chaque fois qu’ils parlent des dérives ou des mirages de la finance. Il faut réguler et encadrer en vue du bien commun l’activité financière et économique, ne pas la laisser réagir aux simples dynamiques spontanées du marché. C’est un sujet peu conflictuel, tout le monde s’accorde à dire qu’il faut une réglementation et, de fait, les activités bancaires sont aujourd’hui parmi les plus régulées au monde. Ensuite, il faut garder le bon équilibre avec la responsabilité personnelle et la liberté d’entreprendre …
Pour conclure ce paragraphe sur la liberté, que l’on me pardonne de citer encore Jean-Paul II dans la même encyclique, au paragraphe 32 : « L’économie moderne de l’entreprise comporte des aspects positifs dont la source est la liberté de la personne qui s’exprime dans le domaine économique comme en beaucoup d’autres. En effet, l’économie est un secteur parmi les multiples formes de l’activité humaine, et dans ce secteur, comme en tout autre, le droit à la liberté existe, de même que le devoir d’en faire un usage responsable. »
III.- ÉGALITÉ
Dans une audience que le Pape François vient d’accorder, le 3 décembre, à quatre cents patrons réunis par les magazines américains Fortune et Time, il a demandé un « nouveau pacte social » et fondé son propos sur la notion d’égalité. Parlant de ce « monde marqué par l’inégalité, la guerre et la pauvreté », il a appelé de ses vœux un « modèle économique plus juste et plus inclusif ». Il s’agit donc de faire en sorte que les différences entre les personnes, entre leurs biens, leurs ressources paraissent justes et n’empêchent pas une entreprise ou un pays de former une communauté.
La question sous-jacente, et fort ancienne, est celle de l’équilibre paradoxal, difficile entre « la propriété privée et la destination universelle ». C’est le titre même du chapitre 4 de l’encyclique Centesimus Annus. Il me semble que la doctrine de l’Eglise dans ce domaine est souple. Elle ne donne pas de solution toute faite, mais plutôt une dynamique… Je renvoie au paragraphe 35, déjà cité, où il est question du « rôle pertinent du profit comme indicateur… », et aussi et surtout de l’entreprise vue comme « communauté de personnes », thème sur lequel je reviendrai en parlant de la fraternité. C’est cette idée qui va servir de fondement à toutes les prises de position en ce domaine. Egalité ne veut pas dire égalitarisme, mais sous-entend un ensemble où chacun est traité de manière à lui permettre d’être heureux d’appartenir à cet ensemble.
En ce domaine, la question emblématique est celle du salaire juste. Plusieurs fois, à Lyon, dans nos « Entretiens de Valpré », il en a été question. Il y a quelques années, j’avais été invité à prendre la parole en premier dans une table ronde à laquelle participaient M. Alain Mérieux et le directeur général d’une ONG. Mettant à part les prêtres qui ont un statut spécial, j’avais dit que dans notre diocèse l’écart des salaires était de 1 à 4. Le responsable de l’ONG avait parlé, lui, d’un écart de 1 à 10, et Alain Mérieux avait expliqué qu’il avait accepté des écarts beaucoup plus considérables en embauchant des personnalités d’exception dont la présence et l’action lui semblaient nécessaires pour le bien de l’entreprise et pour lui permettre de continuer à aller de l’avant …
Pour les chefs d’entreprise que j’ai consultés, un écart allant jusqu’à 20 ou 30 est tolérable. J’ai entendu sur leurs lèvres, quand ils parlaient de leur entreprise, l’adjectif « juste » aller de pair avec « stimulant ». Parfois, cependant, nous dit-on, cet écart atteint la proportion de 1 à 200 dans d’autres pays. Un chef d’entreprise m’expliquait que le premier dont il se méfiait, c’était … lui-même et qu’il avait commencé par fixer son salaire et les possibilités de son augmentation, au su de tout le monde. Dans l’entreprise, cet indice est important pour l’équilibre général, et les dirigeants doivent le regarder attentivement, le vérifier, et même communiquer à son sujet, pour que le sujet ne soit pas tabou.
Pour ne pas dévier vers l’idéologie, il faut aussi dénoncer les illusions de l’égalitarisme. L’expérience et l’histoire nous ont montré qu’un combat acharné pour l’égalité peut anéantir la liberté et conduire à des systèmes totalitaires qui aboutissent à un effondrement de l’économie.
Le scandale de la croissance des inégalités
Les dérives de la liberté, le non encadrement de la finance… peuvent mener à un monde profondément inégalitaire. Depuis trente ans, les inégalités se sont accrues dans nos pays. Christine Lagarde cite en particulier la Russie, l’Allemagne ou la Chine, pays où les écarts se creusent et les inégalités se sont décuplées. Mais en même temps, l’ONU affirme qu’un milliard d’individus sont sortis du seuil de pauvreté, notamment grâce à la mondialisation qui s’est traduite par le transfert d’une partie des emplois des pays développés vers les pays émergents. Ces deux réalités coexistent. C’est ce qui rend toute prise de position difficile, car soit on sombre dans la caricature d’un côté ou de l’autre, soit on dilue toute incitation au changement dans un équilibre conservateur.
Dans ce domaine des inégalités, j’ai eu, cet été, une conversation étonnante avec l’archevêque de Budapest, le cardinal Erdö, lors des JMJ à Cracovie. Selon lui, on ne peut plus parler de « communauté européenne ». C’est plutôt une colonisation à laquelle on assiste, quand l’écart dans le salaire minimum entre l’Europe de l’Ouest et celle de l’Est est de 1 à 5. On lit aussi cette colère sous la plume de Marcel Gauchet lorsqu’il écrit : « L’Allemagne a imposé son modèle à la zone euro, elle peut se permettre de le ‘’dégermaniser’’, ce qui voudrait dire l’imposer un peu plus aux autres ! »
Parler de l’entreprise comme d’une « communauté de personnes », de la « communauté européenne » ou de la « communauté nationale », c’est, dit encore Marcel Gauchet, « tenir un langage patriotique et politique au lieu de se contenter du langage technique de l’économie, oser s’en remettre à l’efficacité libérale pour dégager les moyens de la redistribution » (5).
IV- FRATERNITÉ
En abordant ce dernier mot de notre devise nationale, je voudrais en rappeler l’enracinement et la richesse bibliques. Si les hommes sont frères, c’est d’abord parce qu’ils ont le même Père. Dès le Nouveau Testament, adelphotès est le premier nom de l’Eglise : elle est fraternité (6). On nous exhorte à l’amour-amitié des frères, une philadelphia associée dans l’épitre aux Hébreux (13, 1-2), et à la philoxenia qu’on traduit toujours par hospitalité (7), mais qui veut dire amour-amitié pour l’étranger. Il est particulièrement intéressant, dans le contexte où nous vivons, de noter, et c’est un thème récurrent dans la Bible, que la fraternité ouvre obligatoirement sur l’accueil de l’étranger.
Autour de cette notion de Fraternité, je voudrais évoquer plusieurs thèmes.
1- D’abord celui de l’articulation entre économie et politique.
L’économie ne peut pas être autonome, la politique (ou la foi) doit lui donner sens. L’ordonnancement de l’économie au service du Bien Commun et du développement de tout l’homme et de tout homme est un des thèmes centraux de la doctrine sociale de l’Eglise. Les intellectuels français pensent peut-être que cela va de soi. Mais l’expérience réelle de la vie d’entreprise prouve que cette tension est forte au quotidien, en particulier dans des activités mondialisées et des grands groupes soumis aux commandements des marchés financiers qui privilégient la rentabilité à court terme. La réalité, c’est que les actionnaires, en particulier les actionnaires financiers que sont les investisseurs institutionnels, n’ont qu’un seul objectif, celui de la rentabilité. Il est très difficile pour un dirigeant d’une entreprise cotée en bourse de ne pas faire passer en premier cet objectif de rentabilité financière demandée par les propriétaires de l’entreprise. C’est le grand problème du capitalisme financier moderne.
Benoît XVI avait bien résumé le problème dans son encyclique sociale Caritas in Veritate, au paragraphe 36 : « L’activité économique ne peut résoudre tous les problèmes sociaux par la simple extension de la logique marchande. Celle-là doit viser la recherche du bien commun, que la communauté politique d’abord doit aussi prendre en charge. C’est pourquoi il faut avoir présent à l’esprit que séparer l’agir économique, à qui il reviendrait seulement de produire de la richesse, de l’agir politique, à qui il reviendrait de rechercher la justice au moyen de la redistribution, est une cause de graves déséquilibres. »
C’est là que le rôle de l’Etat, pour autant qu’il vise le respect du Bien Commun, peut fixer des normes qui viendront pondérer la priorité à la rentabilité financière des actionnaires financiers.
En France, un grand système a été mis en place au lendemain de la guerre par le Général de Gaulle, reprenant des éléments mis en place antérieurement. Il est toujours à ajuster, améliorer, mais il ne faut pas le remettre en cause en bloc. Il a été organisé avec un vrai souci de fraternité, touchant à la fois les retraites, la sécurité sociale, les allocations familiales, la protection de l’emploi, du salarié….
En France, on le sait, les patrons se plaignent souvent de ce que ce système paralyse les entreprises. Mais une discussion récente avec un cadre de la finance qui travaille maintenant en Angleterre m’a éclairé. Il est scandalisé de voir qu’outre-Manche, on licencie sans aucune contrainte. C’est violent et dangereux. Notre législation paraît trop lourde, mais elle part de quelque chose qui a de la valeur, d’une intention majeure : l’attention au plus faible, la nécessité du partage, le bien de tous. Certes, ce n’est pas simple, mais tout remettre en cause serait catastrophique, conduirait à un trop grand déséquilibre social.
Dans le thème déjà évoqué de l’entreprise comme communauté de personnes, on perçoit la référence sous-jacente à la famille et à la fraternité. « Il peut arriver, écrit Jean-Paul II dans Centesimus annus (par. 35), que les hommes qui constituent le patrimoine le plus précieux de l’entreprise soient humiliés et offensés dans leur dignité. Non seulement cela est moralement inadmissible, mais cela ne peut pas ne pas entraîner par la suite des conséquences négatives, même pour l’efficacité économique de l’entreprise. En effet, le but de l’entreprise n’est pas uniquement la production du profit, mais l’existence même de l’entreprise comme communauté de personnes qui, de différentes manières, recherchent la satisfaction de leurs besoins fondamentaux et qui constituent un groupe particulier au service de la société tout entière. »
2- Ensuite, la place du don et de la gratuité.
Ce fut une surprise de trouver dans l’encyclique de Benoit XVI Caritas in Veritate un chapitre, le troisième, consacré à la place de la gratuité au cœur même de l’activité économique et des structures de marché (8). On y lit par exemple : « Le grand défi qui se présente à nous, qui ressort des problématiques du développement en cette période de mondialisation et qui est rendu encore plus pressant par la crise économique et financière, est celui de montrer, au niveau de la pensée comme des comportements, que non seulement les principes traditionnels de l’éthique sociale, tels que la transparence, l’honnêteté et la responsabilité ne peuvent être négligées ou sous-évaluées, mais aussi que dans les relations marchandes le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de la fraternité, peuvent et doivent trouver leur place à l’intérieur de l’activité économique normale. C’est une exigence de l’homme de ce temps, mais aussi une exigence de la raison économique elle-même. C’est une exigence conjointe de la charité et de la vérité » (par. 36).
Sur ce thème, je me rappelle aussi une intervention mémorable de M. Mérieux (qu’il me pardonne s’il vient à avoir connaissance de mes propos !), un jour où nous avions organisé à Lyon une rencontre sur cette encyclique, quelques mois après sa parution. Je l’entends encore nous dire : « Je n’ai pas lu l’encyclique, mais vous m’interrogez sur la gratuité et la rentabilité dans l’entreprise. Ma grand’mère aurait dit : ‘‘Ce sont deux horloges qui ne marquent pas la même heure ! ‘’. » Puis, il nous a expliqué la proposition qu’il avait faite dans son entreprise à ceux qui le désiraient de partir à Haïti après le séisme de 2010. Cela lui a permis d’apporter sur place une aide appréciée dans laquelle il est toujours très engagé. « Non seulement, nous a-t-il dit, l’entreprise n’y a rien perdu, mais elle a vécu cet engagement gratuit comme un vrai renouvellement pour tous. » Je l’ai vu recommencer ce genre d’opération lorsque tous les chrétiens ont été chassés de Mossoul, en juillet 2014. Il a mis en œuvre beaucoup de moyens, et intéressé des personnes à ce projet : construire des logements et des écoles, et tout récemment encore une maternité. Dans cet engagement gratuit, apparemment « à perte », l’ensemble de l’entreprise gagne beaucoup humainement, socialement.
C’est un exemple qui illustre à la perfection la suite du texte de Benoit XVI : « Il est nécessaire aussi que, sur le marché, soient ouverts des espaces aux activités économiques réalisées par des sujets qui choisissent librement de conformer leur propre agir à des principes différents de ceux du seul profit, sans pour cela renoncer à produire de la valeur économique. Les nombreux types d’économie qui tirent leur origine d’initiatives religieuses et laïques démontrent que cela est concrètement possible » (par. 37).
3- L’attitude du serviteur
Soucieux du bien commun, le chef d’entreprise sera aidé dans sa mission s’il choisit d’adopter l’attitude du serviteur de tous. Son critère majeur au moment de prendre une décision sera : « Est-ce vraiment le bien de mes collaborateurs, de mes employés… de mes enfants ? » J’ajoute ici les enfants, car il y a évidemment un rapport entre le thème de la fraternité et celui de la famille. Elle conduit à avoir le souci de l’équilibre entre tous, elle est le lieu premier de la redistribution des richesses, notamment entre générations, et du don (9). Ce qui est assez facile à vivre avec la génération d’après, avec ses enfants, peut être vu aussi avec les contemporains… même s’il s’agit d’une réalité un peu éloignée des objectifs fixés par les actionnaires !
Je voudrais aussi souligner l’importance d’adopter une attitude vraiment fraternelle : attention aux malades, aux événements personnels et familiaux de ceux avec qui l’on travaille. Les exemples sont nombreux : je pense à la maman de sainte Thérèse de Lisieux, sainte Zélie Martin, qui pourrait être nommée patronne des chefs d’entreprise… et qui, le dimanche, allait visiter ses ouvrières malades. Dans ma vie sacerdotale, je me souviens d’un chef d’entreprise que je suis allé voir à l’hôpital. Il avait la réputation d’être un homme très sûr de lui, un patron dur avec son personnel. Quelle ne fut pas ma surprise de voir ses collaborateurs venir nombreux et lui parler avec une grande délicatesse ! J’étais étonné de la gratitude et de l’admiration qu’ils exprimaient à son sujet. Un de mes amis musulmans, à qui je racontais cela quelque temps plus tard, m’a dit : « Tu vois, bien que formé au Séminaire, tu es marqué, …formaté par la logique de la lutte des classes. » En fait, au moment d’un « pot de départ », des propos tout simples viennent spontanément sur les lèvres. Ils sont exprimés alors qu’on ne s’y attendait pas du tout. C’est aussi le visage de l’entreprise. On a l’impression que les gens ne voient plus les performances professionnelles, mais savent remercier un homme, une femme de son attitude fraternelle, de son attention, de son humanité qui a su toucher les proches. C’est peut-être même le seul souvenir qu’ils garderont.
Pour terminer cette approche du thème du service en vue d’une authentique fraternité, je citerais l’un de mes confrères, Mgr Castet, concluant un colloque en avril 2011 sur la place du don et de la gratuité dans l’économie selon Caritas in veritate : « Voici à quel changement de regard nous invitent la foi chrétienne et Benoit XVI : c’est le sens du service qui doit être regardé comme la clé de l’activité économique et qui doit présider à nos choix. »
CONCLUSION
En guise de conclusion plus personnelle, je voudrais souligner que, selon moi, les trois mots de la devise de la République sont dans l’ordre.
La liberté, c’est le point de départ et le cœur de la dignité humaine. Les Pères de l’Eglise se sont souvent interrogés pour savoir en quoi consistaient l’image et la ressemblance de la créature avec son Créateur. Ils ont évoqué la raison, le langage, la capacité d’aimer. Pour saint Grégoire de Nysse, ce qui fait que l’homme est à « l’image de Dieu », c’est la liberté. Certes, elle peut avoir des conséquences catastrophiques, s’autodétruire pour aboutir à de vrais esclavages, comme je l’ai évoqué tout à l’heure, mais la liberté est notre plus grande dignité.
L’exercice d’une liberté sans contrôle peut conduire à de monstrueuses inégalités, mais la réalité nous rappelle un jour ou l’autre que nous sommes tous égaux. On s’en aperçoit le jour où survient la maladie, la mort, un accident, un cataclysme… Il est sûr qu’au dernier jour, cette vérité ontologique s’imposera. Le célèbre passage du jugement dernier (Mt 25, 31-46) nous enseigne clairement qu’au dernier jour, ni l’argent, ni la carrière, ni le pouvoir ne compteront. Il ne restera que l’amour. Saint Jean de la Croix exprime en une phrase ce qu’on peut regarder comme un résumé de tout le message biblique : « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour » (10).
Et il vaut mieux avoir conscience de cette vérité essentielle maintenant, dans notre rapport avec les autres. Nous devons user de notre liberté, dans la vie sociale et économique, pour travailler à ce que soit reconnue l’égale dignité de chaque personne. Il me semble que la fraternité sera le résultat, la conséquence, le fruit de cet engagement. Lorsque je rencontre des élus, par exemple, au cours de mes visites pastorales et que je les invite à un temps d’échange dans ces lieux que je découvre comme pasteur et qu’ils connaissent bien mieux que moi, je présente souvent cette conviction qui m’habite. Qu’ils agissent pour que tous leurs concitoyens puissent être libres, prendre des initiatives, faire ce qui leur plaît et les épanouit. Cela veut dire, faciliter la vie associative, la vie culturelle, sportive, artistique, organiser les écoles, les transports, donner les meilleures chances à une collectivité. Qu’ils veillent aussi attentivement à l’égalité, à ce que tous puissent avoir accès à ces moyens mis à disposition. Une réelle fraternité pourra apparaître et éclairer notre « vivre ensemble ». On le voit dans de belles initiatives prises par les habitants d’une rue, d’un quartier, d’une commune… La fraternité ne se décrète pas ; elle est le cadeau, le résultat inattendu d’un vrai travail pour la liberté de chacun et pour l’égalité de tous. Lors d’un colloque récent, j’entendais – merveilleuse surprise ! – le député-maire de Sarcelles nous expliquer que, dans sa commune, plus de 50 ou 60% des habitants vont prier chaque semaine à la mosquée, à la synagogue ou dans une église (c’est à Sarcelles que se trouve la cathédrale des Chaldéens), le vendredi, le samedi ou le dimanche. Et il ajoutait : « L’ambiance n’est pas la même dans ma commune, le lundi matin ! » Au fond de moi, je pensais que c’est bien et d’abord la relation au Père qui fonde notre fraternité humaine.
Sur un tout autre registre – qu’on me pardonne ce récit personnel – j’ai vécu une aventure où j’ai clairement ressenti que les trois mots de la devise républicaine sont effectivement dans l’ordre. En juillet 2013, alors que les jeunes de Paris, de Lyon et de quelques autres diocèses étaient réunis à Cayenne pour une semaine préparatoire aux J.M.J. de Rio, j’ai été victime d’un infarctus… très discret ( !) devant un millier de jeunes dans la Cathédrale de Cayenne alors que je leur donnais une catéchèse. Aussitôt, j’ai été merveilleusement pris en charge par mon pays : soins immédiats à l’hôpital de Cayenne, transfert quelques heures plus tard à Fort-de-France, opération d’un triple pontage le lendemain et retour trois semaines plus tard à Lyon pour un long temps de convalescence, avant de pouvoir reprendre ma mission. C’est un choix pastoral, librement consenti, qui m’avait conduit à accompagner les jeunes à Cayenne. J’étais émerveillé de voir les soins dont j’ai été l’objet. Je partageais ma chambre avec un charpentier originaire de Guadeloupe qui vivait la même mésaventure. Et l’on nous a expliqué que l’un des derniers occupants de cette chambre avait été… Johnny Halliday. Belle égalité entre tous les malades, garantie par la Santé publique dans notre pays. Ensuite, pendant la rééducation, à Marcy l’Etoile, mes compagnons étaient un charcutier, un architecte, un camionneur, un agriculteur, un intermittent du spectacle… Nous avions entre 38 et 83 ans, tous à égalité, avec un seul et même souci : faire repartir notre petit cœur ! Au fil des semaines, il était étonnant de voir les liens fraternels simples qui nous ont unis et qui, avec certains, durent encore.
Les trois mots de notre devise nationale ont bien, comme le disait le Pape, un fondement transcendant, toujours à approfondir. L’économie, dans notre pays et au-delà, a certainement tout à gagner à s’inspirer du chemin qu’ils indiquent.
Notes
(1) Rémi Brague, Les ancres dans le ciel, L’infrastructure métaphysique, Le Seuil 2011, p.131.
(2) PUF, 2016.
(3) Pour le 40è anniversaire de Rerum Novarum, le Pape Pie XI publia Quadragesimo anno (1931) et, trente ans plus tard, Jean XXIII écrivit Mater et Magistra (1961). Paul VI célébra le 80è anniversaire par son admirable Lettre apostolique au cardinal Roy en 1971, Octogesima Adveniens, et Jean-Paul II consacra un texte entier au travail, l’encyclique Laborem Exercens, en 1981.
(4) Parole et Silence, 2008. On doit aussi mentionner du même auteur : l’Evangile, le chrétien et l’argent. Finances, un regard chrétien….
(5) Marcel Gauchet présentant son ouvrage Comprendre le malheur français, Stock, 2016 dans Les Echos, Mercredi 24 août 2016, p. 9.
(6) Souvent nos Bibles traduisent par communauté le mot adelphotès qui désigne l’Eglise, cf. par exemple 1 P 5, 9 « … la fraternité répandue dans le monde… ».
(7) « Grâce à elle, quelques-uns à leur insu ont hébergé des anges » (He 13, 2).
(!) Benoit XVI, Caritas in veritate (29 juin 2009), en particulier, les paragraphes 36-38.
(9) On pourrait noter ici l’apport du livre de Jean-Didier Lecaillon, La famille, source de prospérité, éd. Régnier, 2000.
(10) En fait, le texte espagnol ne comporte pas les mots « de notre vie » : « A la tarde te examinarán en el amor.» Il fait même l’objet d’une variante : « A la tarde te examinarás en el amor », ce qui peut devenir un utile conseil pour un petit exercice spirituel quotidien : Chaque soir, tu t’examineras sur l’amour, puisqu’au soir de ta vie, tu seras examiné sur l’amour.
Cette conférence a été organisée avec le soutien de la Compagnie de Saint-Gobain

Conférence de Narayana Murthy (mercredi 14 septembre 2016)
Making respect more respectable in the corporate world
I consider it a great privilege and a pleasure to speak at this famous place. I worked in Paris in the early seventies. I thank the organizers for providing me with the opportunity of coming back to the world’s most beautiful city.
After much thought, I have decided to speak on a fundamental issue that has relevance to businesses in France, India, the United States, and, in fact, the whole world. We live in an interconnected world that has embraced globalization, seen tremendous advances in communications, and that has had an increased focus on universal concerns such as multicultural workforce, carbon emission and laissez-faire capitalism. Any strategic issue that has relevance to India must have value to France and vice-versa. Hence, I want to speak on how we, the business leaders in France, India and the world, can save capitalism from the wheelers and dealers, restore its glory, and leverage its power to make this a better world. I believe that the primary remedy we have is restoring respect for values in the boardrooms and corner offices. Our task is to make respect much more aspirational than money and power among our current and future corporate leaders. Hence, I have chosen this title for my talk.
My talk will have three parts. First, I will define the relevance of capitalism even in today’s context of deep skepticism about it. Second, I will talk about the various reasons why there is so much skepticism about capitalism. Finally, I will talk about a few ideas that inspirational corporate leaders have practised to make respect more important than money or power.
Several years ago, I was talking to a well-known business school professor about some highly-improbable but decidedly-impactful changes I have seen in the world during the last 30 years – fall of the Berlin Wall, collapse of communism, and the end of apartheid in South Africa. He smiled and said that I would live to see many more such events. Little did I realize then that I would be a witness to the cataclysmic events that have happened since September 2008 – the massive financial tsunami that has led to the fall of several major financial institutions, the shenanigans of the disciples of the God of greed, the multi-trillion dollar recovery package by various governments, equity participation in major private sector institutions like Citigroup, AIG, RBS and Barclays by the US and UK governments, the failure of Fannie Mae and Freddie Mac, and the unimaginable book-cooking scandal of inflated revenues, and fabricating profits and cash balances by the founder at Satyam, once a respected and, today, a disgraced software services company from India, fortunately saved by the timely efforts of the Government of India. No wonder that the CEOs have been ranked the lowest in trust-coefficient in citizen surveys of trustworthiness of various professions in most countries in the world. Skepticism about capitalism is growing every day in developing countries.
Therefore, it is fair to answer the question whether capitalism needs to be preserved. According to most dictionaries, capitalism is an economic system in which investment in and ownership of the means of production, distribution, and exchange of wealth is made and maintained chiefly by private individuals or corporations. It is a system that incentivizes individuals to use their enterprise, drive, hard work and innovation to create wealth for their team and jobs for the society. It is a system most conducive to the elimination of poverty. Other political systems like communism and socialism, practised by most developing countries during the 50s, 60s, 70s, and 80s, have failed to deliver on their promise. They fail in one fundamental premise of development – individuals need incentives to create wealth and jobs for the society. This is where capitalism has succeeded eminently. Even China, ostensibly, a communist country has practised state-directed capitalism and made stunning progress. We see a similar example in Vietnam, also a communist nation. In India, there are several examples of shift towards capitalism. India’s tele-density, a measure of the number of telephone connections per 100 persons, increased from 0.7 in 1991 when the highly controlled socialist economy was liberalized to 80 today. This was primarily driven by large-scale private sector participation and adoption of mobile telephony. Thus, in my opinion, there is no alternative to capitalism to ensure better prosperity in both the developed and the developing world.
Is everything hunky-dory with this elixir for poverty reduction and prosperity? Why has it become effete? Why is it, then, that even in this mono-ideological world, there are currents of disenchantment with capitalism? Why are our corporate leaders the least trusted people in the world? I believe there are several reasons for this.
Greed has played a major part in this drama. Headlines like “CEOs earn big bonuses in a bad year”, “CEOs look at public companies like personal ATMs”, “Five biggest lies on Wall Street”, and “Satyam Scam – A shame for the nation” have brought the attitude of corporate chieftains and boards to the front burner and have shocked the public and the average worker. The propensity of a few senior management professionals in large corporations in the US to sell large chunks of stocks based on insider information while promising a rosy picture of future performance of their crumbling corporations to outsiders and even their own employees has tarnished their image seriously for three reasons. One, it is patently unfair and illegal to resort to such insider trading. Second, it results in the destruction of the corporation, and third, it depletes the precious savings of the employees as most of the savings of the employees in 401K funds are invested in the stocks of these corporations.
Greed has been portrayed as good. The practice of CEOs arguing that a certain merger or acquisition is good for the corporation and then demanding retention bonuses after the merger is yet another example of the insincerity and greed of the CEOs. The huge severance compensation awarded to the failed CEOs has created tremendous loss of faith in the fairness and accountability of boards. I hope many of you have watched CNBC’s award-winning, prime time series – “American Greed” that portrays a compelling description of greed, treachery, dishonesty, fraud, profligacy and debauchery using corporate money. You appreciate the levels to which these apostles of greed can sink. The mindset has become one of equating being truthful with not being caught when telling a lie. The words of Gordon Gekko, a ruthless corporate raider played by Michael Douglas, that greed is good, greed is right and greed works seems to have become a gospel for some people on the Wall Street. A prominent business writer has even called such CEOs fiscal terrorists!
There is huge inequity in corporate compensation worldwide. An example of the unfairness in compensation is the fact that the top five officers of major US public corporations extracted as much as half a trillion dollars or roughly 9% of the profits of these corporations during the last ten years. An even more worrisome trend is that there is no accountability in compensation since their pay is not linked to performance. Several high profile CEOs received huge compensation during a period when their corporations were hurting and not performing. The average pay of CEOs in the US was estimated to be about 204 times that of the average pay of a worker in 2015. This ratio is between 11 and 22 in Japan, France, Germany, Italy and the UK. This ratio in the US was between 1000 and 2000 in some extreme cases. In other words, the CEOs of the extreme case companies earned in one day, what an average worker would take almost three to six years to earn. Equilar, an Executive compensation research firm located in Redwood Shores, California has published data on such contracts that do not meet the usual norms of fairness, transparency and accountability.
This ratio was 20 in 1995 in the US and it peaked at 375 in 2000. There was some moderation after the exposure of the 2002 shenanigans of Enron and a few other companies. But, it now looks like it will come back to the figure of the year 2000. What is sad, according to an article in the Economic Policy Institute published in 2014, is that during the period 1978 – 2013, the CEO compensation, inflation-adjusted, increased 937 percent, a rise of more than double the stock market growth. During the same period, the inflation-adjusted growth rate for compensation of a typical worker, I believe, was just 10.2 percent.
Another reason is the total disregard of truth and unbridled avarice. The case of Satyam, as stated by the founder himself, is shocking. According to a letter that Mr. Raju, the founder, wrote to the Securities and Exchange Board of India on the day he resigned, he admitted to inflating his revenues and cooking profits for over 6 to 7 years just to make sure that his stock price held up. As revealed by subsequent investigations, he had either sold or mortgaged most of his shares for loans that he had taken to support his private businesses. The Ponzi scheme of Bernard Madoff resulting in fabricated gains of almost $ 65 billion dollars over a decade is yet another blot on the reputation of fund managers. The inability of Enron’s Kenneth Lay, Jeff Skilling and Andy Fastow to answer the question of reporters – Bethany McLean and Peter Elkind – both of whom had the guts to ask tough questions on how Enron made money, and their bullying these reporters are examples of the hubris, arrogance and utter disregard for truth exhibited by the carpetbaggers in the corporate world. The face of capitalism received a huge knock recently when Sir Greene was censured by Parliamentary Committee in the UK for his mismanagement of BHS, and for allegedly siphoning money away from the employee pension funds. Reporters found that he was relaxing in his superyacht while the future of 20,000 of his employees was uncertain.
Therefore, the leaders of capitalism must work hard to correct this perception and regain trust. The first step is to set right the current structure and the magnitude of compensation and perquisites they receive. It is very important that fairness, transparency and accountability are strictly followed in fixing the compensation of the senior management of a corporation. Fairness with respect to the compensation of the lowest level employee, and fairness with respect to what part of the profits are kept for growth and payment of dividend are important. Transparency with the respect to the shareholders resulting in providing full details of the compensation and full details of the entire set of conditions under which such compensation is payable are very important. Finally, accountability has to kick in by making sure that a large part of compensation is variable and will become payable only when the targets are achieved on a medium term (3 to 5-year basis) basis with suitable claw back terms.
Is there a solution to this seemingly unsolvable global problem? I am an optimist and I believe we can succeed in our effort. There are two dimensions to solving this problem. The first is reforms in regulation at the institutional level. Such reforms are necessary but not sufficient conditions. For example, after ENRON, we have had the Sarbanes-Oxley act as well as several other changes in regulations in the US demanding better transparency and accountability. In India, we have had several committees on corporate governance including a committee headed by me to improve the level of honesty and decency among corporate leaders. However, they did not prevent a major violation of corporate governance like the Satyam scandal. The number of pages in the Accounting standards manual has increased significantly both in the US and in India during the last ten years. But, we continue to see major violations. The crooks seem to be always a step ahead of the regulators. Hence, tackling this problem just at the level of regulations alone will not suffice. In any case, there is a lot of improvement required in regulating fairness, transparency and accountability of the senior management compensation. The punishment amounts for any violation will have to be many times the sum that the senior management are awarded when they do not result in criminal prosecution.
The second dimension is enhancing the value compliance of corporate leaders. In my opinion, any system of regulation and compliance is as good as the people who are governed by it. The future of any corporation is as good as the value system of the leaders and followers in the corporation. Let me give you an example. In the 1970s, a friend of mine designed a computerized machine-maintenance information system for a government workshop in one of the emerging countries. After a couple of years, he was told that the system was malfunctioning. His team reviewed the working of the programs of the system and found them to be in order. After putting the storekeeper to a thorough cross-examination, my friend came to know that there was a scam. Whenever there was a request to the store keeper from the personal assistant to the minister in charge of the workshop for funds for minister’s entertainment, a certain spare part would be shown as faulty in one of the machines, the replacement for that part would be debited to that machine even though the machine was in perfect condition, the part would be sold in the market, and the money would be handed over to the minister’s assistant! When the demand from the minister became frequent, the spare part consumption soared! It required a smart engineer to conclude that the system was not working well, and my friend’s team had to conduct a thorough investigation to unearth the scam.
Therefore, I am a firm believer that a corporation is what its people are. As Thoreau once said,” It is truly enough said that a corporation has no conscience. But, a corporation of conscientious men is a corporation with a conscience”. That is why I believe that an important step in solving the problem of poor corporate governance is enhancing the desire for respectability among the men and women who populate corporations of this world. Hence, the solution to the vexing problem of raising the prestige of corporate leaders is to create a mindset that puts premium on earning respect from the society, and on defining success as going beyond just seeking money and power. Therefore, we, the business leaders, have to believe and act according to the words of Jon Huntsman, a former Chair of the Board of Overseers at Wharton, that winners never cheat and that decent, honorable people finish races and their lives in grand style and with respect. Whenever I have doubt about any action I have to take, I go back to his wonderful book – Winners never cheat. I suggest that every one of you buy this book and use it as your Pentateuch or Bible or Geeta or Koran in your moments of dilemma.
I will suggest a few simple ideas for enhancing respect for your consideration.
In any society, stability, peace and harmony exists only when leaders who are powerful show self-restraint in their actions. Self-restraint comes from civilized behavior. Even though in democracies, we are guaranteed the power of free expression and the right to criticize in the most strident form, we exercise self-restraint and use soft words so that we act as responsible citizens of the society. Such self-restraint is extremely important even in curbing profligacy in CEO compensation and perquisites.
Self-restraint comes from good culture. Good culture comes from transformation of our mind and our values. To me, decent behavior stems from an environment of good culture surrounding a person. What is culture? Culture is about things that bring me joy and sorrow; that defines my priorities in life; how I spend my time and money; the kind of friends I have; and the issues that excite me. In essence, culture is how I behave when I know nobody is watching me.
Hence, it is important to create a culture of openness, fairness, honesty, decency, transparency and accountability in a corporation. Such a culture is likely to discourage greed, fraud and misdemeanor. Creating such a culture requires that the leaders lead by example. Mahatma Gandhi wanted us to be the change that we want to see in the world. So, we have to take lead in creating such a culture around us. This task has to start right from day one and cannot wait until one becomes a CEO.
Respected corporate leaders cultivate simple and inexpensive habits. My father who was a high school teacher teaching Physics, Mathematics and English for most of his life used to tell us that the best way of overcoming greed is to derive pleasure from simple and inexpensive habits in life. He also believed that the best habits in life were inexpensive. Therefore, he would urge us to read books, listen to music, and enjoy conversation with good people. In the India of the early sixties, every small town had a public library from where we could borrow books free; every small town had a public park where music would be played every evening; and there was no tax on having good conversation with decent friends! Therefore, I have found that simple and inexpensive habits bring me joy.
Good corporate leaders do not equate success with money and power. Today, success in corporate circles is most often equated with money and power. This is a key reason for corporate leaders to become greedy. We glorify corporate leaders appearing in popular lists like “World’s Top 100 Billionaires” or “World’s 100 most powerful persons” published by leading magazines. Do we have a list to venerate “World’s 100 most respected persons”? The real success is not about money or power. I know several billionaires and have met several national leaders who are not happy. I have met several film actors and actresses who are rich and famous but are rarely happy because they are lonely, crave acceptance from their circle, and worry they are not successful. What is success? Success to me is the acceptance by the circle of my family, friends and my community that I am indeed valuable to them. That value does not come from my wealth but it comes from my generosity – generosity to share what little I have, and generosity to bring joy to people. To me, a successful person lights up the eyes of people and brings smile to their faces when he or she enters a room. Success is having sound sleep every night. Let us remember the words of Senator J. William Fulbright who said, “It is not our affluence, or our plumbing, or our clogged freeways that grip the imagination of others. Rather, it is the values upon which our system is built.”
Successful corporate leaders create an environment of happiness around them. « He is happiest, be he the king or peasant, who finds peace in his home », said, Johann Von Goethe. A happy leader has a circle of supportive family and friends. They share in his joy, cheer him in his marathon, applaud him on his success, and commiserate with him in his sorrow. Building such a circle requires lots of emotional investment. To do so, we have to learn to give back in good measure. We have to be present to celebrate their moments of glory and to provide our shoulder for them to cry on when they are down. We have to put our personal interest behind the interest of our loved ones. We have to level with them at all times. We cannot play games with our loved ones. I do not know of anybody who is a demon in office and an angel at home. We are the same everywhere. It is not easy to turn off our bad qualities in a jiffy. They ooze out from our mindset. That is why it is important to eschew greed, selfishness, intrigue and opacity in our dealings in the office, at home, among friends and in the community. As we know, families, friends and the officemates of most of the well-known villains of corporate frauds were unhappy with them.
Happy corporate leaders don’t get fixated on extreme desire. “Desire is the root cause of all sorrow”, said Buddha. While it is natural to have normal urges in life, extreme fixation with possession of material things is what leads to greed. It is such fixation that leads us to fraud and acts that we would later regret.
Contented corporate leaders shun jealousy. Jealousy is, in essence, another form of greed. Jealousy is a rationalization of our failure vis-à-vis another person’s achievement. Jealousy burns our own stomach and will not affect the other person. Jealousy does not help us to take constructive steps to improve our performance. Jealousy leads us to do things we would later regret. When I was a child, I remember my mother urging me to just look at my own plate while eating, and not to look at somebody else’s plate. She would urge me to eat what I could digest rather than feel bad that the other person was able to eat more than me.
Confident corporate leaders maintain transparency and develop a sense of humility. Whenever they have any doubt about their intended actions, they consult their well-wishers – spouse, family and friends. Most often, such consultation will help avert disasters. After all, our well-wishers want to see us successful – good-natured, happy, contended, healthy and, hopefully, prosperous. That is why it is best to practise the adage – when in doubt, disclose – with our family, friends and in our workplace. Such a mindset helps us to develop humility. Humility is about admitting that I could be wrong and that there could be other people who are better than me. Humility leads to open-mindedness and transparency and helps teamwork. More importantly, humility helps us avoid hubris. Hubris is what leads people to disaster.
Respected corporate leaders take part in a charitable activity in their spare time. This will put themselves among people that have elevated their desires beyond possessing the next mansion or the next million dollars. The opportunity to meet generous people outside the hierarchy of our organization is a sure way of escaping the orbit of jealousy and intrigue at least a part of the time.
Successful friends tell me that making a difference to people less fortunate than themselves and building a great institution made them happier and satisfied persons. In the end, it is very important to remember the words of George Sand who said, “Il n’y a qu’ un bonheur dans la vie, c’est d’aimer et d’être aimé”. No amount of money and power can match this privilege of loving your society and being loved by your society.
I have no doubt at all that the assembled leaders here have lived up to the expectations of this great society and groomed a new generation of corporate leaders who stand for the best values. While these values may appear very difficult to practise, I am inspired to work harder to succeed by a famous French saying, “Vouloir, c’est pouvoir”.
I will close with my favorite quotation from President Theodore Roosevelt who said, ‘Americanism means the virtues of courage, honor, justice, truth, sincerity and hardihood – the virtues that made America. The things that will destroy America are prosperity-at-any-cost, the love-of soft living, and the get-rich-quick theory of life’. These are truly immortal words that hold good for the US, France, India and all nations. I wish you all success in living up to these famous words.
Cette conférence a été organisée grâce au soutien de la Compagnie de Saint-Gobain
![]()
Conférence du Grand Rabbin Haïm KORSIA (lundi 9 mai 2016)
Libéralisme et espérance
Conférence de M. Pascal LAMY (lundi 18 avril 2016)
L’Éthique de la globalisation
Merci à la Fondation « Éthique et économie » de m’avoir invité à apporter ma contribution à ce cycle que Bertrand Collomb vient de décrire sur l’éthique du libéralisme économique. Comme les initiateurs de cette vaste entreprise, je considère que la globalisation impose une telle recherche. Mais, au-delà d’une éthique du libéralisme, il s’agit, selon moi, de se mettre en quête d’une nouvelle approche universelle de la question des valeurs, d’une « éthique de la globalisation » de nature à justifier dans l’avenir nos choix individuels et collectifs. Je vais tenter de démontrer en quoi cette éthique globale s’avère nécessaire. Puis d’exposer pourquoi cette voie est ardue. Enfin de proposer quelques pistes à explorer et quelques principes à définir pour avancer dans cette direction, dans une démarche plus pragmatique que théorique. J’espère que les mânes de cette auguste maison ne me tiendront pas rigueur de cette approche itérative et concrète.
*
Les questions du bien commun, du sort de la Cité universelle sont vieilles comme la Philosophie, comme la Morale, comme le Droit, et comme la Religion. Si on tente de retracer à grands traits l’histoire de la pensée qui a nourri ce qui s’apparente à une morale universelle, deux grands courants se dessinent : l’approche westphalienne suivie de l’approche cosmopolitique.
L’approche westphalienne aborde la question de la morale universelle à travers celle de l’éthique des relations internationales qui se nouent entre les États nations souverains. Ils constituent des blocs éthiques homogènes qui s’articulent entre eux comme des molécules, libres de contracter ou non telle ou telle obligation, selon le vieux principe du « cujus regio ejus religio ». Cette morale universelle s’exerce dans le cadre d’espaces moraux séparés juxtaposés, y compris, par exemple, pour construire une morale de la guerre. Dans le monde westphalien, il fallait disposer d’une éthique de la guerre qui a d’ailleurs suscité des grandes controverses philosophiques et juridiques, par exemple sur la notion de « guerre juste « .
Il y a, plus tard, l’approche cosmopolitique, de Kant à Habermas qui retourne aux sources de principes déjà énoncés par Confucius dont l’enseignement prônait un droit naturel, une sorte de morale collective, et une morale universelle qui ne transite pas par l’État. Il a inspiré Kant pour sa morale universelle sans Wolkenstadt qui ne passe pas nécessairement par le truchement de la souveraineté. Cette idée se retrouve dans la doctrine sociale de l’Église catholique, de Rerum Novarumde Léon XIIIà Caritas in Veritate de Benoit XVI, doctrine qui apparut au moment de la révolution industrielle, qui s’est poursuivie en droit fil jusqu’à nos jours, et qui s’est nourrie de la pensée jésuite. Benoit XVI lui-même, qui ne s’est pourtant pas illustré par l’audace de ses opinions, énonçait que le monde avait besoin d’une autorité morale universelle pour que règne un certain ordre éthique.
Ce sont les deux grands conflits mondiaux catastrophiques qui ont créé les circonstances favorables à la convergence de ces deux courants vers une approche intermédiaire, celle du droit international ou, encore, celle des Nations Unies. La partie du droit international que les juristes nomment jus cogens pose des principes supérieurs à l’expression de la volonté des États souverains. Ce ne sont pas, pour autant, des normes éthiques. Ces principes qui établissent, par exemple, le caractère illicite d’un génocide, ou le fait que « pacta sunt servanda » sont importants mais ils se réfèrent à des procédures et à des méthodes, plutôt qu’à des valeurs en tant que telles. L’énoncé le plus complet et le plus varié de l’expression de cette convergence se trouve dans le système des Nations Unies après sa création à l’issue de la deuxième guerre mondiale et dans ses évolutions successives, à commencer par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 dont nous savons ce qu’elle doit à l’opiniâtreté d’Eleanor Roosevelt et qui décrète les valeurs positives à promouvoir – la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété, la justice, l’hospitalité parmi d’autres- et les antivaleurs à combattre – l’arbitraire, la discrimination, la torture- .
Se sont ajoutés ensuite ce qu’on appelle ces covenants à cette Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui incarnent ces valeurs en termes de droits économiques et sociaux: la santé, le logement, la culture, le travail.
Ce corpus existant, auquel on se réfère si souvent, constitue-t-il une éthique universelle ? Non, à mon sens et pour au moins deux raisons.
D’abord, je fais mien le postulat de Stanley Hoffmann selon qui « il ne suffit pas de désigner un concept par le même vocable pour parler de la même chose. » Cette théorie s’applique à bon nombre d’expressions en vogue sur lesquelles tout le monde feint de s’accorder alors qu’elles donnent lieu à des interprétations fort diverses, selon le lieu où elle est proférée: « il faut promouvoir un « travail décent » ou encore « un développement soutenable » : les qualificatifs de décent et de soutenable donnent lieu, dans la réalité, à des traductions et des applications à géométrie très variable. La Chine peut bloquer l’accès à internet au nom de sa propre interprétation de la Déclaration des Droits de l’Homme et d’autres invoquer l’atteinte au respect de la religion pour imposer l’interdiction des caricatures du prophète.
Ensuite parce qu’il suffit de mettre en regard ce que la Déclaration des Droits de l’Homme préconise en termes de droits économiques et sociaux et la réalité de cette planète en ces domaines pour mesurer le gouffre qui les sépare. On pourrait être tenté de s’associer à ce qu’a écrit Stephen D. Krasner : « ce principe qui consiste à baser des droits moraux, globaux, sur un principe de souveraineté, n’est finalement pas autre chose qu’une hypocrisie organisée ». Tout ceci tend à prouver à quel point la question d’un système de valeurs morales, d’une « éthique de la globalisation » se pose désormais de manière inéluctable. Au-delà des résistances et des traditions, l’échelle du bien commun qui s’impose désormais est celle de la planète, comme Paul Valéry l’avait pressenti à l’aube du XXe siècle et qui n’a pas été démenti par la suite des événements.
Je me limiterai à illustrer cette nécessité par cinq arguments de nature contemporaine.
D’abord, la globalisation qui jette des ponts entre les systèmes économiques, les systèmes de production de biens et de services, mais aussi entre les systèmes sociaux et sociétaux et devrait donc rapprocher également les systèmes politiques. Nous connaissons bien le moteur de cette évolution, la technologie dont l’effet écrase la distance, et donc les coûts de la distance. L’un des effets les plus visibles et probablement les plus efficaces mais aussi les plus perturbateurs de la globalisation, est l’échange international. Au cours de ces vingt ou trente dernières années, j’ai assisté au passage du vieux monde où l’obstacle à l’échange avait pour objet de protéger les producteurs de la concurrence étrangère – les droits de douane, les subventions – au nouveau monde où l’essentiel des obstacles à l’échange vise à protéger les consommateurs. De l’ancien monde de la protection au nouveau monde de la précaution. Pour être plus précis, l’obstacle à l’échange ne provient pas de la mesure elle-même, mais de la différence dans le niveau de la précaution et dans la manière dont il est administré. Par exemple, ce sont les questions des organismes génétiquement modifiés ou de la protection des données privées qui obéissent à des règles très différentes de part et d’autre de l’Atlantique qui font l’objet de nombreux débats dans le cadre de la négociation du Traité Transatlantique. La question du bien-être des animaux et des conditions dans lesquelles ils sont tués, régies par des critères anthro-politiques, spirituels, religieux, culturels différents, sont une parfaite illustration du choc des systèmes de valeurs qui ne sont plus cloisonnés comme au temps où la globalisation demeurait partielle. La force, la taille, la vitesse de la phase actuelle de la globalisation, qui n’est d’ailleurs pas la dernière, nous oblige à relier les différences dans le domaine de la précaution aux divergences culturelles.
Nous n’aurions pas vu, auparavant, d’activistes australiens empêcher l’exportation de bovins sur pied vers l’Indonésie sous prétexte que ce pays pratique l’abattage selon le rite hallal. Les traditions et l’échelle des valeurs entre le bien et le mal antagonistes s’entrechoquent.
Viennent ensuite les excès de la globalisation qui posent des problèmes moraux d’autant plus choquants – qu’il s’agisse des inégalités, des migrations forcées, des dommages environnementaux, du crime ou du terrorisme- qu’ils sont maintenant connus du monde entier. Bertrand Collomb rappelait tout à l’heure, à juste titre, qu’Adam Smith fut moraliste autant qu’économiste. Nous voici de retour aux sources.
Troisième raison pour laquelle nous ne pourrons échapper à la nécessité de trouver une voie vers l’éthique de la globalisation : la désoccidentalisation du monde qui est à l’œuvre. Depuis la période des Lumières et la révolution industrielle jusqu’à nos jours, ce monde a été dominé par la pensée occidentale alors qu’il existe bien d’autres systèmes de pensée. Ces cultures que l’ordre colonial avait assujetties et occultées, par exemple en Asie et en Afrique, ressurgissent aujourd’hui et s’imposent avec le poids croissant de leur démographie et de leur économie.
Quatrième raison : c’est la diversification des acteurs de la vie internationale et de la scène globale. L’époque de Grotius ou de Metternich où l’État nation avait le monopole de la relation internationale est désormais révolue parce qu’aujourd’hui des entreprises et des organes de la société civile, fort bien organisées au niveau global ont fait irruption sur la scène internationale. Des organisations comme WWF, OXFAM ou Médecins sans frontières n’ont rien à envier à des entreprises multinationales comme General Electric, Danone ou Ali baba qui se conduisent en principe conformément à leurs propres déclarations de valeurs. Danone, par exemple, qui revendique la responsabilité sociale des entreprises, a exporté en Égypte, au Mexique, au Bangladesh, ou en Afrique du Nord, ses valeurs humanistes spécifiques, dans la gestion des ressources humaines, la formation, l’éducation, les droits des salariés, la concertation avec les syndicats, et désormais la soutenabilité environnementale.
Enfin, cinquième raison : à plus ou moins brève échéance les chercheurs, les moralistes, les politiques seront confrontés à un monde où les progrès scientifiques vont toucher, à l’essence du vivant, à l’espèce sapiens. L’ingénierie génétique, l’homme augmenté, l’allongement de la durée de la vie vont poser des problèmes éthiques inédits à l’échelle planétaire puisque la science existe pour tous, même si ses progrès ne sont pas accessibles à l’ensemble de l’humanité. Question morale dont l’importance va, elle aussi, s’imposer dans l’avenir.
Pour toutes ces raisons, nous assistons donc, je crois, au déclin programmé de l’École westphalienne et à la montée en puissance de l’École cosmopolitique qui, probablement, prendra le dessus.
Nécessaire, cette voie n’en est pas pour le moins ardue, comme le démontrent les difficultés auxquelles ont été confrontées toutes les d’initiatives menées depuis une vingtaine d’années pour faire progresser l’idée d’une éthique de la globalisation. Ce que Le théologien Hans Küng a proposé dans » Global ethic for Global politics and economics » a inspiré indirectement beaucoup des propositions que j’ai faites dans le rapport de l’Oxford Martin School en 2013. La Fondation de Sean Cleary, la Future World Foundation travaille sur les questions de gouvernance et particulièrement sur le volet « valeurs ». Gordon Brown vient de publier avec New York University le rapport d’une commission de sages « globaux » sur l’actualisation d’une Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. La Charte de la Terre fut élaborée par les Nations Unies entre 1980 et 2000. Citons aussi la Déclaration des Droits et des responsabilités des Citoyens du monde par l’UNESCO. Sans oublier de mentionner le texte publié en 2013 par le Comité Central du Parti Communiste Chinois qui recense la liste des valeurs que les media chinois sont instamment priés de promouvoir auprès des citoyens pour leur édification. Cette profusion de recherches très diverses, achevées ou en cours d’élaboration, si elle confirme la nécessité de cette quête, témoigne aussi d’une certaine confusion. Elles achoppent toutes sur les mêmes écueils tels que, les limites de l’appartenance, les risques de l’uniformité, les dangers du relativisme, la nécessité du politique.
Sur les limites de l’appartenance, je ne m’attarde pas sauf pour commenter ce vocable abusif de » communauté internationale » dont on se délecte dans la sphère des Nations Unies. Le désir, fondé, d’une communauté internationale ne suffit pas pour lui donner corps. Une Communauté internationale qui justifierait une agrégation et un respect de valeurs n’existe pas, pour la simple raison que, quoiqu’en pense Habermas, nous ne sommes pas des Citoyens du Monde. Un certain nombre d’entre nous prétendent à ce statut et l’ont sans doute acquis, mais cette aspiration n’est pas la plus communément partagée. La légitimité d’un système de valeurs provient, pour l’essentiel, du sentiment que nous appartenons à un espace humain qui pratique ce système de valeurs. Or la légitimité, – nous en faisons tous l’expérience – est une fonction exponentielle de la proximité. Aussi longtemps que le Citoyen du Monde ne sera qu’une identité lointaine, notre quête d’une éthique globale restera largement utopique, ce qui ne suffit pas à la condamner.
De nombreux moralistes anciens et contemporains ont souligné les risques de l’uniformité. Un monde où règnerait une vérité, seule et unique, ne pourrait advenir qu’au prix de conversions forcées et provoquerait sursauts identitaires violents et résurgences fondamentalistes brutales.
Mais les sursauts identitaires peuvent aussi être produits autant par le relativisme complet : s’il n’y pas de vérité absolue, ni de vérité relative, on voit mal quel sens donner à un ordre qu’il soit social, politique ou mondial.
L’énumération de quelques-uns des dangers jalonnant cette voie démontre, à mon sens, la nécessité de l’intervention du politique qui énonce des valeurs, mais surtout qui arbitre entre ces valeurs, dans l’acception que donnent à ce terme les peintres, les musiciens, et les physiciens: un poids différent. Sans doute est-ce le fondement idéologique de la maison qui nous accueille aujourd’hui : l’Académie des Sciences Morales ET Politiques!
Un militant pour le bien-être des animaux manifestera lundi, puis il défilera mardi en faveur du développement. Mercredi, ce défenseur de bonnes causes devra se demander si la promotion du bien-être animal est compatible avec celui du développement et s’il peut faire l’économie d’une démarche politique qui consiste à hiérarchiser ses préférences en leur affectant des coefficients. C’est ainsi qu’on peut définir une démocratie, la forme la plus légitime selon laquelle des préférences individuelles s’agrègent pour s’exprimer dans des choix collectifs.
Il faut donc rechercher une échelle de valeurs moins indéfinie que celle qui s’exprime dans l’ensemble des systèmes sans toutefois tendre vers une standardisation globale qui risquerait de déclencher un retour du tribal. Voie étroite, convenons-en. Et qui promet bien des débats.
*
Avant d’envisager ces rivages escarpés à venir, ceux des fondements d’une éthique de la globalisation, il me semble souhaitable de passer par une étape intermédiaire et rechercher une convergence éclairée des sagesses sur l’essentiel, si tant est que l’on puisse s’accorder sur ce qu’est l’essentiel lorsqu’il est question de valeurs ou de contre valeurs. C’est une gageure que je n’hésite pas à relever en me référant à l’article 1 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme stipulant que » tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit ». A ce stade, mon audace ne parait pas démesurée. » Libres et égaux » : nous sommes tous en faveur de la liberté et de l’égalité. Oui, mais à quelle hauteur, à quel degré, dans quelles proportions ? De combien affectons-nous la liberté pour l’égalité et de combien affectons-nous l’égalité pour la liberté? Nous avons tous été confrontés, un jour ou l’autre, à ce dilemme crucial, à ce choix entre égalité et liberté. Et nous le savons, c’est à la Justice de placer le curseur. Lorsque la Justice a dans les plateaux de sa balance, l’égalité et la liberté, son fléau ne se place jamais au centre mais penche tantôt à gauche, tantôt à droite. Là se trouve le point sur lequel cette convergence doit situer l’essentiel: combien pour combien d’égalité et de liberté. La justice est un concept universel qui se retrouve dans toutes les religions, dans toutes les traditions monothéistes et même dans l’animisme et le confucianisme. Les 17 objectifs du développement durable adoptés par les Nations Unies en septembre 2015, contiennent une grille, certes implicite, de valeurs et notamment avec une pondération qui varie selon les objectifs retenus, entre l’égalité et la liberté.
La convergence se fait aussi sur le principe de subsidiarité cher à Saint Thomas d’Aquin et à Althusius, vieux principe du fédéralisme qui consiste à faire le départ entre les préférences collectives qu’il convient d’agréger et le reste qui doit demeurer, pour des raisons de légitimité, de l’ordre de la proximité. Une fois posé le principe de la subsidiarité comme crucial pour l’hygiène institutionnelle, on retombe de nouveau sur l’épineux problème de la pondération. Prenons deux exemples : Tous les économistes s’accordent pour dénoncer et démontrer l’absurdité économique de la prohibition de la drogue. Or, jusqu’à présent les valeurs fondant le raisonnement des économistes ont été préemptées par d’autres valeurs. Dans ce cas, la subsidiarité joue en faveur de la proximité et au détriment d’un raisonnement économique plus global. Autre exemple avec la peine de mort qui parait une fracture irréductible dans nos valeurs, et cependant nous acceptons de vivre dans un monde où certains pays tuent leurs citoyens en fonction de leur législation pénale et d’autres le refusent.
La convergence devrait se faire aussi autour du principe de la diversité dont nous, Européens, sommes familiers. « L’unité dans la diversité », n’est-elle pas notre devise, dont l’oxymore ne doit pas nous décourager. Diversité des acteurs, des pratiques, des démarches; diversité du chemin que nous emprunterons pour atteindre le but ultime de cette quête.
Enfin, dernier point, le plus immédiat, le plus pratique, et sans doute, le moins controversé sur lequel nous devons nous retrouver, il s’agit du principe de connaissance, corollaire de la curiosité. D’après mon expérience du système européen et du système international, la connaissance consiste à comprendre pourquoi mes valeurs ne sont pas celles de l’autre, ce qui nous fait parcourir, sans trop de difficultés théoriques, les deux tiers du chemin qui peut mener à la convergence. Laissons de côté pour l’instant le troisième tiers où il s’agit de savoir s’il faut converger, où, comment et combien. Cet exercice de connaissance qui requiert un goût de l’investigation, de l’apprentissage et de la compréhension, dans lequel l’humanité d’aujourd’hui est peu versée, se révèle pourtant extrêmement utile, malgré ses difficultés propres. Si vous êtes occidental et intéressé par la pensée chinoise, le nombre d’ouvrages lisibles et disponibles sur le marché est plus que restreint. J’ai toujours été frappé de l’incroyable niveau de connaissance que les Asiatiques, – les Japonais, comme les Chinois ou d’autres– ont de notre civilisation en comparaison de l’insondable ignorance que j’ai de la leur, en dépit du bon niveau d’éducation que j’ai reçu. Il me semble urgent de remédier à cette asymétrie dans la connaissance de l’autre dont l’Europe, d’ailleurs, n’a pas l’apanage. Dans la démarche que je suggère, celle de la convergence éclairée des sagesses, le terme sur lequel je mets l’accent n’est pas sur celui de convergence ni celui de sagesse, mais sur celui d’éclairée.
Chercher à comprendre et à connaitre est essentiel pour que le chemin que je suggère mène quelque part.
*
Je conclurai par trois considérations.
La première : à supposer que nous nous entendions sur un certain nombre de convergences qui pourraient conduire, un jour, à une éthique de la globalisation, nous devrons nous doter d’un dispositif institutionnel. Une valeur en soi, c’est bel et bon, mais une valeur qui ne sait pas devenir du droit, reste fort éloignée. Pour qu’une valeur devienne du droit, il faut une prescription, il faut un code et il faut un juge qui fasse respecter un code de valeurs commun.
La Communauté internationale dont je disais plus tôt qu’elle n’avait pas d’existence véritable a tout de même franchi un pas considérable au milieu des années 90 avec la création de la Cour criminelle internationale qui institue un juge au-dessus du souverain. La réalité de son fonctionnement lui retire, certes, une grande part de sa légitimité dans la mesure où beaucoup d’états majeurs de cette planète n’ont pas ratifié le traité qui fonde cette cour internationale et qu’elle s’est jusqu’à présent limitée à juger principalement des coupables africains. On ne peut abandonner, pour autant, au nom de la recherche de valeurs, la recherche d’institutions qui les font vivre.
La seconde concerne l’intégration régionale, comme processus d’agrégation des valeurs par la proximité. Qu’il s’agisse des sous-ensembles africains, de l’Amérique centrale, ou même des six pays de l’ASEAN, il y a là un pas intermédiaire vers le global prometteur, comme nous, Européens, le savons. Mais nous, Européens, savons aussi désormais que le plomb de l’économie ne se transforme pas aussi aisément en or de la politique que l’espéraient les Pères Fondateurs.
La troisième pour rappeler la raison d’être de cette éthique que nous cherchons: il s’agit de diminuer les tensions, les frustrations, les conflits. Commençons donc par le début, en reconnaissant que la source principale de la majorité des conflits et des tensions qui nous menacent, reste d’ordre économique, social et maintenant écologique. Ce sont ces réalités essentielles que nous devons prendre en compte avant d’entamer toute discussion philosophique.
Car, comme l’a écrit Stanley Hoffman, » la justice définit la condition sociale comme la mort définit la condition humaine ».
